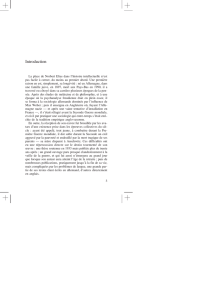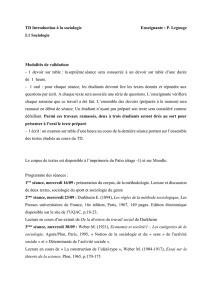UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE Etude des structures de

UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE
ÉCOLE DOCTORALE V
Laboratoire de recherche : GEMASS
T H È S E
pour obtenir le grade de
DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE
Discipline : Sociologie
Présentée et soutenue par :
Sylvain BESLE
le : 8 décembre 2015
Etude des structures de coordination entre soins
et recherche
Le cas des essais précoces en cancérologie
Sous la direction de :
Monsieur Philippe STEINER – Professeur à l’Université Paris-Sorbonne
Membres du jury :
Monsieur Philippe BATAILLE – Directeur d’étude à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales (EHESS)
Monsieur Alberto CAMBROSIO – Professeur à l’Université Mc Gill
Monsieur Michel DUBOIS – Directeur de recherche au CNRS
Monsieur Jean-Charles SORIA – Professeur à l’Université Paris-Sud

2
Cette thèse porte sur la relation entre soins et recherche dans le cas des essais cliniques
précoces en cancérologie. L’objectif principal est d’identifier les mécanismes sociaux qui
permettent aux patients d’être orientés vers une unité de recherche puis d’être inclus dans un
protocole d’essai. Ce travail s’inscrit dans le champ de la sociologie de la santé (Carricaburu
& Ménoret, 2004) et plus particulièrement dans le cadre des travaux qui portent sur la
cancérologie (Castel, 2005; Baszanger, 1986; Bataille, 2003; Ménoret, 2007) et la recherche
clinique (Keating & Cambrosio, 2012; Dalgalarrondo, 2004; Rabeharisoa & Callon, 1999;
Löwy, 2002; Fox, 1998). Il emprunte également des éléments de réflexion à la sociologie
économique, notamment avec la notion d’appariement (Steiner, A venir; Roth, 2010), ainsi
qu’aux études développées dans la lignée des analyses structurales (Simmel, 1999; Elias,
1991; Grossetti, 2006; White, 2011).
Les essais cliniques occupent depuis longtemps une place importante dans la prise en
charge des patients atteints de cancer. Cependant depuis une dizaine d’années, les liens
unissant traitements standards et recherche se sont largement complexifiés, notamment avec
l’arrivée des thérapies « ciblées » dont le fonctionnement est basé sur l’identification des
anomalies génomiques des tumeurs. Ainsi dans certaines situations, la participation à un essai
apparait comme une ressource supplémentaire pour les patients atteints de cancers avancés –
cancer métastatique ayant reçu plusieurs lignes de traitements (chimiothérapie, radiothérapie).
Ces changements sont d’autant plus visibles au niveau des premières phases de recherche
clinique – auxquelles les essais précoces correspondent – car celles-ci n’avaient
traditionnellement pas de visées thérapeutiques. Ces changements ont également entrainé une
réorganisation des étapes de recherche nécessaires à la commercialisation de nouveaux
médicaments, généralement divisés en quatre phases (I, II, III et IV), chacune répondant à des
objectifs précis (identifier les toxicités, les doses administrables, l’efficacité). Dans ce
contexte, la question de l’inclusion dans des essais précoces se situe à la croisée d’intérêts
autant médicaux – donner accès à des nouveaux traitements à des patients en situation d’échec
thérapeutique – que scientifiques – accélérer le développement de nouveaux traitements. Mais
la participation à ces essais est un processus complexe et cela pour plusieurs raisons. Tout
d’abord, le faible nombre d’essais et de places disponibles oblige les patients à se déplacer sur
de longues distances afin d’être inclus. Ensuite, les conditions de participation sont
particulièrement strictes, obligeant les unités de recherches à écarter un nombre important de

3
patients. De plus, des examens souvent contraignants sont mis en œuvre sans que la
participation ne soit toutefois assurée. Dans ce sens, prendre part au processus d’inclusion
n’est pas neutre et peut avoir des conséquences sur l’état de santé des patients. Enfin une fois
inclus, les patients doivent faire face à des conditions de participation astreignantes en raison
du nombre d’examens à réaliser, du rythme des traitements (consultations hebdomadaires) et
des éventuels effets secondaires.
L’étude sociologique de cette situation cristallise de nombreux enjeux qu’il convient
de détailler pour comprendre l’angle d’analyse adopté. Les patients inclus dans ces essais
peuvent présenter des profils très différents, que ce soit au niveau de la localisation tumorale
(sein, poumon, sang, etc.) ou de l’évolution de leur maladie (maladie incurable à court terme,
traitement alternatif à l’essai disponible, cancer récemment déclaré, récidive). Cette diversité
de profils a une influence importante sur la participation éventuelle des patients à ces essais ;
elle doit donc être prise en compte pour comprendre la manière dont les mécanismes
d’inclusion sont mis en œuvre par les unités investigatrices. A cela s’ajoute le fait que chaque
essai présente des conditions de participation qui lui sont propres, entrainant des situations
très variables au moment de la sélection des patients. Or, ces essais n’incluant qu’un nombre
restreint de patients, il n’est pas possible de se concentrer sur un cas particulier. Il est donc
nécessaire de considérer l’ensemble de l’activité de recherche malgré les disparités de
situation auxquelles cela renvoie. Pour dépasser ces difficultés, l’argumentation repart des
trajectoires de soins depuis le diagnostic du cancer afin d’identifier les principaux éléments
permettant d’expliquer l’arrivée jusqu’aux essais précoces. Pour cela, un modèle « structural »
a été adopté afin d’identifier les structures sociales stables nécessaires à la prise en charge des
patients. Il a ensuite été possible de considérer les dispositifs de sélection des patients mis en
place par les unités de recherche, qui peuvent être assimilés à des mécanismes
d’appariements. Enfin, nous nous sommes attachés à étudier l’impact des différents cadres
d’actions (économiques, politiques, médicaux) qui se croisent au niveau des essais afin
d’identifier comment ceux-ci influencent l’inclusion des patients.
Cette recherche s’appuie sur un travail de terrain réalisé principalement dans deux
unités de recherches – Unité 1 et Unité 2 – et constitué d’observations (réunions d’équipes,
consultations) et d’entretiens (patients, médecins). L’identification de ces deux unités a été
permise par un travail d’analyse exploratoire fait d’entretiens auprès des principaux acteurs
des essais précoces, à la fois institutionnels (INCa – Institut national du cancer, ANSM –

4
Agence nationale de sécurité du médicament, ministère de la santé), privés (entreprises
pharmaceutiques) et médicaux (unités de recherche clinique). Une enquête par questionnaires
auprès des médecins ayant envoyé des patients vers des essais précoces a également été
menée. Enfin, deux bases de données de patients correspondant à l’ensemble des inclusions
dans l’Unité 1 et l’Unité 2 respectivement entre 2007 et 2013 et entre 2005 et 2012 ont été
analysées.
Notre travail se divise en trois grandes parties. La première a pour objectif d’établir un
modèle d’analyse permettant de considérer la diversité des parcours de patients grâce à une
approche structurale. La deuxième partie est consacrée aux différents mécanismes servant à
l’inclusion des patients. Enfin, la dernière partie vise à élargir l’analyse en considérant les
dynamiques plus générales qui se croisent au niveau des essais précoces (économiques,
scientifiques, institutionnels) et qui influencent directement la frontière existante entre soins et
recherche et donc l’inclusion des patients.
Le premier chapitre est dédié à l’identification et la description des différents réseaux
jouant un rôle dans l’organisation des trajectoires de soins : le réseau médical composé de
l’ensemble des professionnels de santé, le réseau des institutions de santé (hôpitaux et
institution publiques encadrant les soins) et le réseau du patient. Cette étape vise à mettre au
jour tous les éléments ayant un rôle direct ou indirect dans l’organisation et l’orientation du
parcours des patients. Elle permet également d’identifier les difficultés méthodologiques
posées par l’adoption d’un modèle d’analyse structural (multiplexité des réseaux, évolution
temporelle).
Le deuxième chapitre s’appuie sur ces premiers éléments pour proposer un modèle
d’analyse de ces différents réseaux grâce à la notion de configuration, développée entre autre
par Norbert Elias (Elias, 1985a; 1991). Cette dernière fait référence à une structure triadique
dont la stabilité tient dans l’équilibre des forces entre les différents éléments mis en relation.
Dans notre cas, il s’agit des patients, des médecins et des institutions de soins. C’est cette
figure sociale particulière qui va nous permettre de comprendre l’évolution des trajectoires de
soins et l’arrivée jusqu’aux essais précoces.
Le troisième chapitre a pour objectif de confronter cette figure structurale au parcours
des patients rencontrés. La principale question étant de comprendre comment, à partir de la
diversité des situations d’annonce de la maladie, cette structure sociale particulière se met en

5
place. Plusieurs régimes de soins doivent être distingués en fonction de l’existence de
traitements curatifs et de la perspective temporelle (courte ou longue) dans laquelle se
trouvent les patients. Les passages d’un régime à l’autre sont des moments privilégiés de
recomposition des configurations de soins et de réorganisation de l’équilibre des forces entre
ses membres.
Ces éléments nous permettent d’aborder, dans une seconde partie, la question de
l’inclusion qui se situe précisément lors du passage à un nouveau régime, celui d’une maladie
aigüe-incurable (absence de traitement curatif et perspective temporelle courte). A partir de là,
il est possible de s’intéresser au processus d’inclusion en tant que tel qui se décline autour de
trois mécanismes sociaux distincts mais complémentaires : l’accès, l’engagement et
l’appariement.
Le quatrième chapitre est ainsi consacré à la question de l’accès aux essais précoces,
c’est-à-dire l’arrivée des patients jusqu’au centre investigateur. Pour comprendre les
contraintes pesant sur cette situation, un retour sur la nature de ces essais et leurs spécificités
face au modèle standard de recherche clinique est nécessaire. Cette première étape d’inclusion
est un préalable à toute sélection de la part des unités investigatrices mais également avant
l’expression d’un choix de la part des patients qui sont généralement peu informés de
l’existence de ces essais. Cette question de l’accès répond à de nombreuses contraintes,
notamment en raison de la singularité des essais, de leur rareté et de l’absence d’offre
explicitement établie.
Le cinquième chapitre est consacré à la question de l’engagement des patients dans le
processus d’inclusion puis lors de leur participation tout au long de l’essai. La particularité de
ces essais est d’être très lourds en termes d’organisation pour les patients et cela bien avant
que l’inclusion ne soit assurée. De plus, même lorsque des effets secondaires importants ont
été rencontrés, certains patients restent fortement attachés à poursuivre leur participation. Cela
pose donc la question des raisons qui poussent ces patients à prendre des risques malgré
l’incertitude de l’inclusion et des bénéfices thérapeutiques qui peuvent être obtenus.
Le sixième chapitre porte sur les formes de sélection mises en œuvre par les unités
investigatrices et qui peuvent être désignées comme un processus d’appariement dans lequel
deux éléments doivent être associés par paires : les patients et les essais. Il s’agit donc de
dévoiler l’ensemble des dispositifs sociotechniques servant à réaliser les meilleures paires
 6
6
 7
7
1
/
7
100%