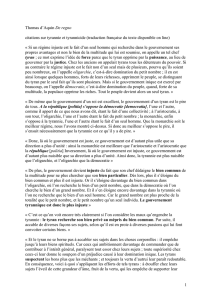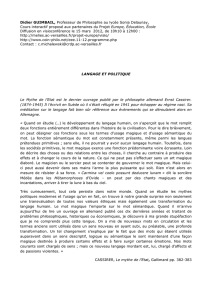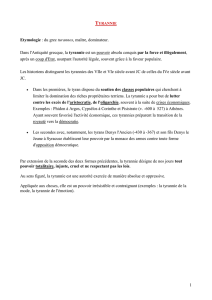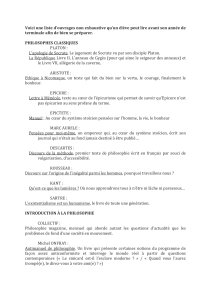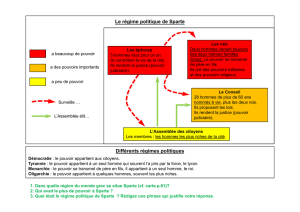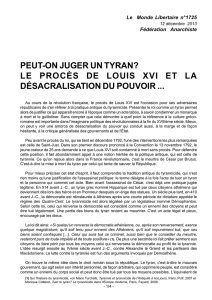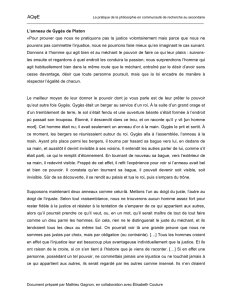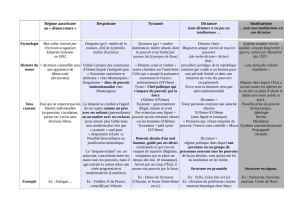PDF sample



Table
Remerciements
Introduction. – Ce qui fut et ce qui reste
PREMIÈRE PARTIE Légendes modernes, réalités antiques
l – Les origines de la tyrannie
2 – La crise de la cité
3 – La fin de la démocratie
DEUXIÈME PARTIE Les égarements de la raison
4 – Conseiller le prince
5 – Éclairer le despote
6 – Guider le guide
7 – Informer le tyran
TROISIÈME PARTIE Une politique pour la philosophie
8 – La violence du concept
9 – Ni trop près, ni trop loin
Épilogue
Post-scriptum. – Despotisme éclairé, théories du complot et fantasmes des Lumières

REMERCIEMENTS
Celui qui, depuis tant d’années, poursuit en marge de toute institution philosophique son travail
d’écriture, bénéficie au moins d’un avantage : il n’a personne à remercier. À l’exception, bien sûr,
des quelques proches dont la présence et l’affection l’ont aidé à maintenir, envers et contre tout, le
cap.
Je n’en ai que plus de plaisir à nommer, ici, Roland Jaccard, qui m’a très chaleureusement incité
à écrire ce livre, Paul Audi, dont le regard à la fois complice et critique m’a considérablement aidé
à l’améliorer, Marcel Detienne, qui a eu la gentillesse de me faire bénéficier de ses conseils, Victor
Gourevitch, qui m’a longuement parlé de Strauss et de Kojève, Robert Proctor, grâce à qui j’ai
découvert Coluccio Salutati, et Alain Brunet, qui m’a une fois de plus prouvé son amitié au cœur
d’un moment difficile – sans oublier, last but not least, Manuel, dont les questions ont la vertu de
me faire douter de mes réponses.
Je dédie cet essai à Ariane. À cause de notre amour, d’abord. Et parce que son sourire m’aide,
jour après jour, à ne pas prendre trop au sérieux les philosophes ni la philosophie.
Ch. D.
New York (New York), 23 avril 2000.

Introduction
Ce qui fut et ce qui reste
Tout petit, j’entendis des voix : la politique m’appelait.
On n’en parlait pas beaucoup à la maison, moins encore dans la cour de l’école. Mais les
journaux me fascinaient. J’en lisais ce que je pouvais, dès que j’avais fini mes devoirs. N’importe
quel article du Figaro (mon père refusait de lire Le Monde) me paraissait plus intéressant que
n’importe quel roman. Pour dire la vérité, un demi-siècle a passé depuis lors sans que j’aie changé
d’état d’esprit. Si ce n’est que j’ai remplacé Le Figaro par Le Monde. Et que tous les journaux
finissent par se ressembler.
L’expédition de Suez (octobre 1956 : je revois mes parents entasser, la mine sombre, des
provisions de sucre dans leurs cantines d’Afrique), le retour de De Gaulle au pouvoir (Noël 1959 à
l’Élysée, en compagnie des bons élèves de la ville de Paris, avec le général en uniforme me tapotant
la tête), la guerre d’Algérie (je me demandais si elle serait finie avant que j’aie l’âge d’être appelé),
la décolonisation (cette fois, c’est Mokhtar Ould Dadah qui me tapote la tête à la sortie de l’école),
le putsch des généraux (oreille collée au « transistor »), l’OAS (lueurs bleues des « plasticages »
dans la nuit), la crise de la baie des Cochons, la jupe de Marilyn, l’assassinat de Kennedy : voilà les
événements qui marquèrent mon enfance. Une enfance parmi d’autres, finalement bien tranquille
malgré le bruit du siècle.
Ensuite, ce fut la classe de philo. Là, commencèrent les choses sérieuses : Marx et Freud, bien
sûr, mais également les Grecs.
« Les Grecs, dit Cornelius Castoriadis, n’ont pas inventé le politique (c’est-à-dire l’institution de
la société, ni même celle du pouvoir explicite) ; ils ont inventé la politique (c’est-à-dire la mise en
question de l’institution établie de la société – ce qui présupposait, et cela est clairement affirmé au
V siècle, qu’au moins de grandes parties de cette institution n’ont rien de “sacré” ni de “naturel”,
mais qu’elles relèvent du “nomos”), en même temps que la philosophie et la démocratie (la
démocratie est le mouvement qui vise à ré-instituer globalement la société, et la philosophie,
l’instrument de réflexion critique qui doit permettre d’atteindre ce but) . »
Si cette phrase provient d’un texte publié en 1990, les définitions qu’elle propose correspondent à
ce que j’attendais, dès 1966, de la philosophie. Dès le début de mes études, en effet, je sus qu’écrire
et lire étaient des actes politiques – les seuls actes politiques qui en valaient la peine, ou les seuls,
en tout cas, dont je me sentais capable. Et, d’emblée, l’objectif ultime que j’assignai à cette activité
fut la ré-institution de la société – autrement dit, l’instauration d’une véritable démocratie (dont il
me semblait évident qu’elle était encore loin d’exister dans mon pays).
Sans que personne ne m’ait poussé, j’avais choisi ma voie.
e
1
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%