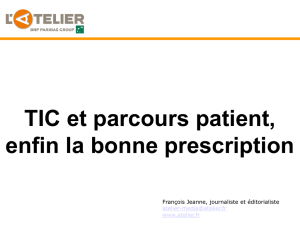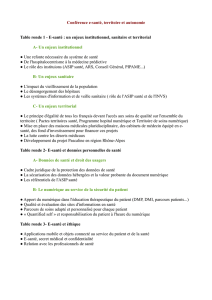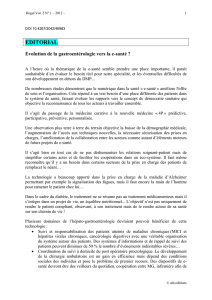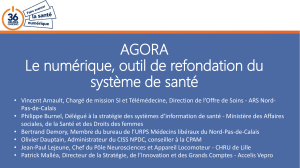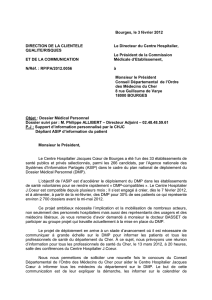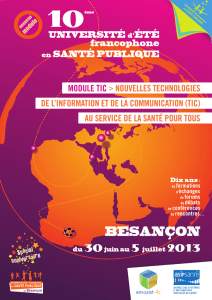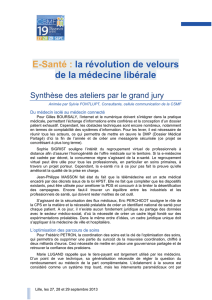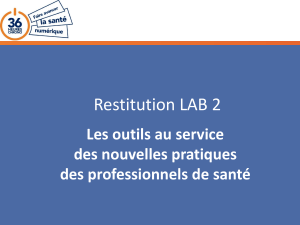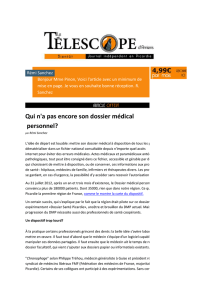Politique d`e-Santé

Délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé
1
Politique d’e-Santé
Point d’étape et nouvelles propositions d’orientations
en vue d’une feuille de route interministérielle
I. Enjeux et contexte
Notre système de santé est confronté à trois défis majeurs :
• La maîtrise de son financement
• Le maintien d’un accès de tous les citoyens à une prise en charge de qualité
• La réponse dans des conditions médicales, sociales et économiques
soutenables, au vieillissement de la population et à ses conséquences
(accroissement du poids des maladies chroniques et du nombre de personnes
en perte d’autonomie risques).
La réponse à ces défis passe notamment par :
• Une amélioration de la performance de l’offre de soins
• Une amélioration des organisations et des pratiques de nature à faciliter la
coordination et la continuité des soins dans une optique de décloisonnement
entre le secteur sanitaire et médico-social
• Une meilleure lisibilité du parcours des patients
• Une meilleure gradation des soins entre le premier et le second recours
• La mise en place de dispositifs permettant de prévenir la dépendance et de
faciliter le maintien en situation d’autonomie
• Une meilleure éducation et participation des patients à leur parcours de santé.
Dans cette perspective, les technologies contemporaines de l’information et de la
communication présentent de considérables potentialités pour améliorer l’efficience, la
qualité et la sécurité de notre système de santé. La complexité des organisations et des
processus de soins, la multiplicité des acteurs concernés, les résistances sociologiques aux
changements, la difficulté de l’offre de services et de produits numériques à répondre de
façon industrielle aux besoins du secteur, comme celle de faire émerger des modèles
économiques, sont autant de freins à la concrétisation de ces potentialités.
Les technologies et services numériques en santé seront un levier déterminant pour la
modernisation de notre système de santé. Leur développement constitue une priorité de la
politique de santé. Il requiert une politique globale qui est en voie de mise en œuvre et de
renforcement.
II. Mise en place d’une politique globale e-Santé
Divers rapports ont mis en évidence la nécessité de définir une stratégie nationale et de
mettre en place une gouvernance adaptée aux enjeux des systèmes d’information de santé
et, plus généralement, de la e-Santé (entendue comme l’application des technologies de

Délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé
2
l’information et de la communication à l’ensemble des activités en rapport avec la santé dans
son acception la plus large).
Un ensemble de réformes et d’initiatives concourent, dans cette perspective, à l’élaboration
et à la mise en œuvre d’une politique globale et coordonnée, à laquelle contribuent les
différents départements ministériels, autorités et opérateurs concernés.
1. La mise en place d’une gouvernance des systèmes d’information
dans le domaine de la santé
Le ministère de la santé a procédé à une refonte de l’organisation du pilotage de la politique
d’informatisation du système de santé en se dotant de structures spécifiques.
Ainsi, a été instituée, en octobre 2009, l’Agence des systèmes d’information de santé (ASIP
Santé), groupement d’intérêt public chargé de déployer le Dossier médical personnel (DMP)
et, de façon beaucoup plus large, de mettre en place les référentiels indispensables au
développement des systèmes d’information dans le domaine de la santé (en matière
d’interopérabilité, de répertoires et de sécurité).
Par ailleurs, en 2009, trois entités sont regroupées pour former l’ANAP (Agence Nationale
d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux). Forte des
expertises de celles-ci, l’Agence vient en appui des établissements de santé et médico-
sociaux pour améliorer leur performance dans le cadre de la réforme du système de santé
en France. A ce titre, elle définit sur le champ des systèmes d’information de santé les
organisations pérennes et performantes ainsi que les outils et la méthodologie associés.
Par ailleurs, au terme d’une phase active de préfiguration engagée en janvier 2010, a été
récemment créée (mai 2011) la Délégation à la stratégie des systèmes d’information de
santé (DSSIS). Placée auprès du secrétariat général des ministères chargés des affaires
sociales, la DSSIS aura notamment pour mission : d’animer les travaux d’élaboration
stratégique dans le domaine des systèmes d’information de santé ; d’orienter et superviser
l’action de l’ASIP Santé ; de coordonner les interventions des différents acteurs du secteur
sanitaire et médico-social en matière d’informatisation ; d’exercer, avec l’appui de l’ASIP
Santé, le pilotage des projets d’intérêt national concourant au développement de la e-Santé.
Les directions du ministère : DGOS, DGS, DGCS, DSS définissent et mettent en œuvre
dans leur champ de compétence les objectifs, les orientations, les programmes et plans
relatifs aux Système d’Information dans le cadre de la stratégie nationale.
Ces réformes seront prochainement complétées par la mise en place d’un conseil
stratégique des technologies de l’information en santé (actuellement en cours d’instruction),
appelé à constituer auprès des ministres chargés de la santé et des solidarités un organe
national de gouvernance permettant d’associer les professionnels et la société civile à
l’élaboration de la politique publique et de donner à celle-ci toute la cohérence et la lisibilité
nécessaires (cf. infra).
2. Les principaux chantiers mis en œuvre à l’initiative du ministère de
la santé
Dans le champ de compétences des ministères sociaux, un ensemble à la fois cohérent,
pragmatique et ambitieux d’actions a été engagé, dont les premières réalisations concrètes
apparaîtront dès 2011.

Délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé
3
Le dossier médical personnel
Une nouvelle stratégie de relance du projet de DMP a été élaborée et mise en œuvre depuis
mars 2009. Conformément à la feuille de route et au calendrier annoncés, les années 2009
et 2010 ont été consacrées à la conception du DMP et à la construction de son système
d’information.
L’année 2011 sera celle de son installation et de son amorçage. Livrée en janvier 2011, la
version 1 du DMP est actuellement en phase de tests techniques et d’usage dans cinq
régions pilotes (Alsace, Aquitaine, Franche-Comté, Picardie, Rhône-Alpes). Le déploiement
proprement dit du DMP auprès des professionnels de santé commencera à grande échelle
au second semestre 2011.
L’année 2012 sera l’année du plein déploiement du DMP et de l’évolution de ses services,
sur la base des résultats de la phase de test. Le DMP permettra la mise en partage et
l’échange, entre professionnels de santé d’une part et entre professionnels de santé et
patients, d’autre part, des données de santé de ces derniers : informations générales
(antécédents, allergies, etc.), liste des médicaments délivrés (via l’intégration du dossier
pharmaceutique et du DMP, qui sera effective au début 2012), comptes rendus
d’hospitalisation, comptes-rendus de radiologie, résultats de biologie. En 2012, le DMP et le
dossier communiquant de cancérologie ne feront qu’un.
Outil de partage entre les différents acteurs de l’offre de soins et situé au carrefour des
différents systèmes d’information (santé et assurance maladie, professionnels libéraux et
établissements de soins) le DMP, outre son intérêt propre pour la coordination des soins, est
un projet structurant pour l’ensemble du système de santé. Il est prérequis au
développement de la télémédecine et sa mise en œuvre a un effet accélérateur sur
l’adaptation des systèmes d’information et le développement de leur usage par les
professionnels de santé.
Les infrastructures immatérielles
Parallèlement à la fabrication du DMP, l’ASIP Santé a entrepris la mise en place des
infrastructures immatérielles et des référentiels indispensables au développement des
systèmes d’information partagés. En particulier :
- un cadre d’interopérabilité a été publié et intégré par les industriels ;
- le Répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) est en cours de
constitution en coopération avec les Ordres des professions de santé et sera
intégralement publié en 2011.
L’espace de confiance
Il ne pourra y avoir de développement des systèmes d’information de santé sans un espace
de confiance reconnu garantissant la sécurité des systèmes et la confidentialité des données
de santé.
Sous l’égide de la Délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé, une
politique générale de sécurité des systèmes d’information a été engagée et sera
progressivement publiée dès la fin de l’année 2011.
D’ores et déjà, sous l’impulsion de l’ASIP Santé :
- la préparation du DMP a été pour l’ASIP Santé l’occasion d’élaborer, en
concertation étroite avec les associations représentant les patients, les Ordres

Délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé
4
professionnels et la CNIL, un guide des bonnes pratiques en matière de recueil
du consentement du patient ;
- conformément aux préconisations de la CNIL, les dispositions ont été prises pour
qu’un identifiant national de santé (INS), distinct du numéro d’inscription au
répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR), soit engendré
lors de la création du DMP ;
- le processus d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère
personnel a été mis en œuvre en application du décret du 4 janvier 2006 ;
- le déploiement de la carte de professionnel de santé (CPS), instrument
d’authentification forte des professionnels leur fournissant un accès sûr aux
systèmes d’information de santé, a été engagé selon une configuration adaptée
aux différentes modalités d’usage aussi bien en établissements de santé qu’en
exercice libéral.
Le plan national de déploiement de la télémédecine et le soutien aux
projets
La France est le premier pays en Europe à s’être dotée d’une réglementation définissant et
encadrant l’activité de télémédecine : la loi HPST (article 78) et le décret du 19 octobre 2010
ont conféré une véritable assise juridique à la télémédecine permettant d’impulser et
d’organiser son déploiement sur les territoires de santé.
Le ministère de la Santé a lancé au début de l’année 2011, l’élaboration d’un plan
stratégique national de déploiement de la télémédecine. Ce plan a pour objet de déterminer
les axes prioritaires de déploiement de la télémédecine, d’identifier les freins, obstacles et
leviers à son développement afin de favoriser les usages sur le terrain.
Il est prévu de structurer ce plan autour de trois volets :
• Un document stratégique « stratégie télémédecine 2011-2015 », précisant la vision,
les enjeux et les grandes orientations stratégiques à moyen terme ;
• Un ensemble d’actions opérationnelles regroupées dans un plan d’actions ;
• Une « boîte à outils » recensant les éléments de méthodes existants ou découlant de
la mise en œuvre d’actions spécifiques du plan (réglementation, référentiels de
bonnes pratiques, guides, modèles contractuels, modèles d’évaluation médico-
économique…) ainsi que les dispositifs de gouvernance, de suivi et d’évaluation du
plan.
Dans une démarche de gouvernance collective, ce projet est conduit par un comité de
pilotage stratégique interministériel présidé et animé par la Direction générale de l’offre de
soins (DGOS), avec l’appui de la Délégation à la stratégie des systèmes d’information de
santé (DSSIS).
La composition du COPIL a été conçue de façon à intégrer les différentes dimensions de la
télémédecine, ainsi que l’ensemble des acteurs institutionnels concourant à son
développement (DGCIS, DATAR, DSS, DGCS, DGS, ANAP, ASIP, HAS, ARS…), les
usagers et des professionnels de terrain.
Indépendamment de la très large représentation institutionnelle au sein des différents
groupes de travail, le COPIL soumettra, en tant que de besoin, les principales préconisations
à un public plus large, professionnel de santé ou patient. Il est en effet essentiel d’associer et
de communiquer très largement au-delà des représentations institutionnelles classiques afin
d’emporter l’adhésion et la confiance des utilisateurs directs.

Délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé
5
La première pierre posée par le COPIL a consisté à sélectionner 5 chantiers prioritaires :
• Imagerie en termes de permanence des soins
• Prise en charge de l’AVC
• Accès aux soins des détenus
• Prise en charge d’une maladie chronique par région : insuffisance rénale chronique,
insuffisance cardiaque ou diabète
• Soins dans les structures médico-sociales et en HAD
Le COPIL a pour mission d’orienter le déploiement de la télémédecine, notamment en
élaborant des outils à disposition des ARS, qui assureront, selon les spécificités locales, le
déploiement opérationnel des activités de télémédecine. En effet, le développement de la
télémédecine a été explicitement inscrit dans le champ de compétence des ARS. Il sera
donc soutenu par une gouvernance territoriale forte.
Concrètement, chaque ARS doit élaborer un programme régional de développement de la
télémédecine, qui est une composante du projet régional de santé. Le COPIL mettra à
disposition des ARS dès le mois de juin un guide méthodologique d’aide à l’élaboration de
ces programmes qui devront être finalisés avant fin 2011. Les ARS pourront alors, sur la
base de ce programme, mettre en œuvre de manière opérationnelle les activités de
télémédecine.
Afin d’accompagner la mise en œuvre du plan stratégique, toutes les ARS bénéficieront de
moyens financiers destinés à la promotion de projets innovants et s’inscrivant dans les
grandes orientations fixées par le comité de pilotage :
- Pour l’année 2011, la DGOS a alloué une enveloppe de 26 millions d’euros aux
ARS dans le cadre du Fonds de modernisation des établissements de santé
publics et privés (FMESPP), en vue du développement des 5 chantiers prioritaires
dont 11,6 M€ ont été réservés à la prise en charge de l’accident vasculaire
cérébral (dans le cadre du plan national AVC) ;
- l’ASIP Santé a lancé en coordination avec la DSSIS et la DGOS, un appel à
projets destiné, d’une part à aider les ARS à se doter d’une structure de maîtrise
d’ouvrage apte à piloter le développement de la télésanté dans leur territoire,
d’autre part à appuyer la mise œuvre de projets matures : cinq projets ont été
retenus pour un montant global de 5,8 M€.
En outre, dans le domaine de la télécardiologie, la télétransmission des données des
défibrillateurs implantables a fait l’objet (arrêté du 17 mars 2011) d’une inscription à la liste
des produits et prestations permettant une prise en charge par l’assurance maladie. Dès
maintenant, plusieurs centaines de patients sont suivies par ces dispositifs
.
Le programme hôpital numérique
Le développement des systèmes d’information hospitaliers est indispensable à la fois pour
l’amélioration de la performance des établissements de santé et plus globalement pour le
système de santé.
Ainsi, la direction générale de l’offre de soins (DGOS) a engagé depuis avril 2010
l’élaboration d’un plan stratégique de développement et de modernisation des systèmes
d’information hospitaliers (SIH), baptisé « stratégie hôpital numérique ».
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%