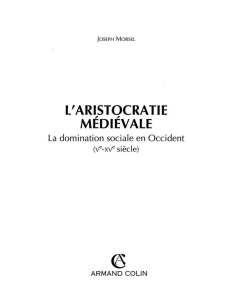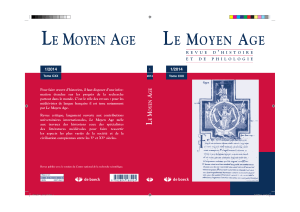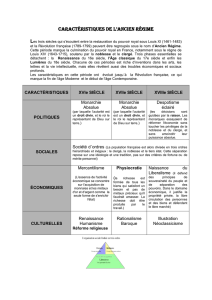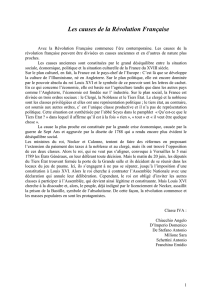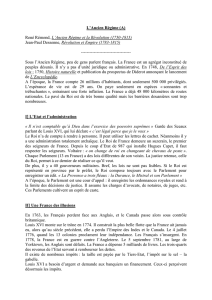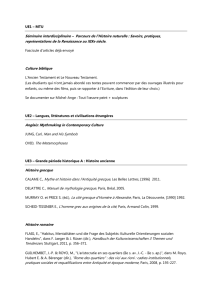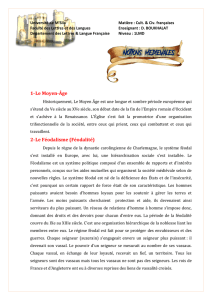sample - Fuller Sales Inc


Table des Matières
Page de Titre
Table des Matières
Page de Copyright
COLLECTION U • HISTOIRE
Introduction
Enjeux et problèmes d'une histoire de la noblesse médiévale
« Aristocratie » plutôt que « noblesse »
Démarche adoptée
Mises en garde
Chapitre 1 - Sénateurs et guerriers
La réorganisation de l'aristocratie romaine
La cristallisation des aristocraties germaniques
La définition d'un pôle clérical du pouvoir
La définition d'un pôle royal du pouvoir
La formation de nouvelles aristocraties
Chapitre 2 - Maîtres et fidèles
La légitimation du pouvoir par le service
L'évolution de la puissance parentélaire
L'évolution de la puissance domaniale
Chapitre 3 - Châtelains et chevaliers
La transformation du paysage fortifié
Une réorganisation de l'espace du pouvoir
Les acteurs de la dissémination castrale
Les chevaliers : guerriers ou aristocrates ?
Chapitre 4 - Prêtres et hommes d'armes
L'entrée dans l'Église : héritage ou conversion ?
L'enjeu des « rites de passage »
Régulation et légitimation de l'usage des armes
L'échec de l'appropriation laïque de dieu
Chapitre 5 - Seigneurs et vilains
Le contrôle de l'accès à la terre
Le contrôle des processus de travail
Le contrôle de la répartition du produit agricole

Chapitre 6 - Nobles et bourgeois
Dominer les villes
Dominer les citadins
Dominer comme les autres aristocrates
Dominer en tant que nobles contre les bourgeois ?
Chapitre 7 - Princes et gentilshommes
Genèse de la suprématie monarchique
La reproduction élargie du pouvoir seigneurial
La « noblesse », chose du prince
Conclusion
Bibliographie indicative

© Armand Colin/S.E.J.E.R., Paris, 2004
978-2-200-24257-2

Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous procédés, réservés pour tous
pays. Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit,
des pages publiées dans le présent ouvrage, faite sans l'autorisation de l'éditeur, est illicite et
constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d'une part, les reproductions strictement réservées
à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d'autre part, les courtes
citations justifiées par le caractère scientifique ou d'information de l'œuvre dans laquelle elles sont
incorporées (art. L. 122-4, L. 122-5 et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle).
ARMAND COLIN • 21, RUE DU MONTPARNASSE • 75006 PARIS
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%