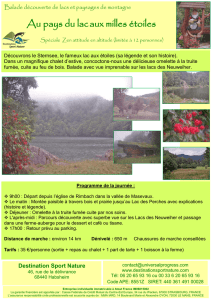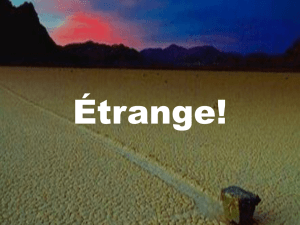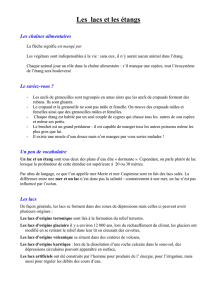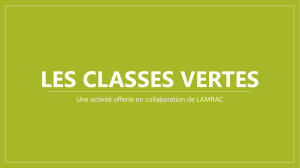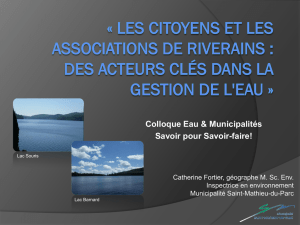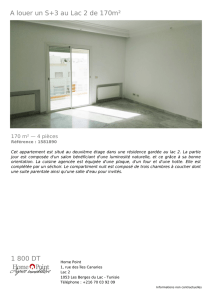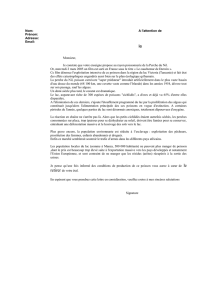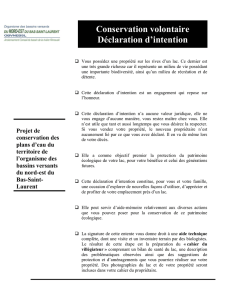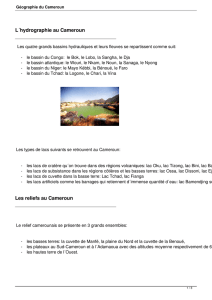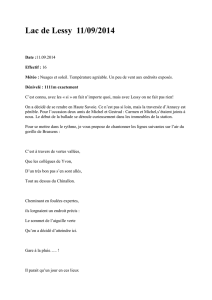PNMT priorites

PRIORITÉS ET POTENTIELS
DE RECHERCHE
-
1
-
PARC NATIONAL DU
MONT-TREMBLANT
PNMT-1 ➯
➯➯
➯
Le loup de l’Est
État de la situation
Le loup de l’Est : Des études d’ADN devraient apporter plus
d’information sur la génétique des loups du PNMT, mais il est
probable qu’il s’agisse du loup de l’Est (Canis lycaon), une
espèce présente dans le sud-est de l’Ontario et le sud-ouest du
Québec.
De récentes études ont démontré que le loup de l’Est, désigné
en 2001 par le Comité sur la situation des espèces en péril au
Canada (COSEPAC) comme une sous-espèce du loup gris au
statut préoccupant en raison de sa vulnérabilité face aux
activités humaines, est en fait une espèce indépendante du loup
gris. Les analyses d’ADN ont démontré qu’aucun des loups de
l'Est du Canada ou des loups roux échantillonnés ne comptait
de séquences d'ADN du loup gris (Canis lupus). Les chercheurs
ont confirmé la présence de séquences du coyote chez les deux
loups. Cependant, on a également trouvé des séquences qui
divergent de celles des coyotes par un écart de l'ordre de
150 000 à 300 000 années. Le loup roux et le loup de l’Est sont
deux espèces qui auraient évolué conjointement en Amérique
du Nord, suivant une lignée commune avec le coyote jusqu'à il y
a 150 000 à 300 000 ans (Wilson P. J. et al, 2000).
Bien que nous n’ayons aucune preuve que les loups du parc
soient des loups de l’Est pas plus que nous n’en avons qu’il
s’agit de loups gris, la logique va davantage dans le sens du
loup de l’Est. Le parc national du Canada de la Mauricie a
démontré que les loups de son territoire sont des loups de l’Est,
et les récentes analyses faites au parc Algonquin vont dans le
même sens.
Le loup de l'Est ressemble au loup gris, mais il est plus petit. On
le décrit comme un petit loup « mangeur de cerfs » qui s'hybride
avec le coyote (Canis latrans). Sa fourrure est de couleur fauve
et rougeâtre derrière les oreilles, et il a de longs poils noirs sur
le dos et les flancs. Les mâles adultes pèsent de 25 à 35 kg, et
les femelles, de 20 à 30 kg. (Dans la région du parc national du
Canada de la Mauricie, les mâles mesurent 80 cm à l’épaule et
pèsent environ 40 kg, tandis que les femelles mesurent 75 cm et
pèsent environ 30 kg. Source : site Internet de Parcs Canada)
Les meutes du parc : On observe des loups ou des indices
d’activités de loups en toutes saisons, et les meutes sont
réparties sur l’ensemble du territoire.
Dans la région naturelle des Laurentides méridionales, une
meute de loups occuperait un territoire d’environ 200 km²
(Potvin 1986, étude réalisée dans la réserve faunique Papineau-
Labelle). Bien qu’il puisse varier quelque peu, ce territoire est
généralement stable d’année en année. L’abondance des
principales proies peut influer sur la taille du territoire. De plus,
une meute qui se nourrit principalement de cerfs possède un
plus petit territoire qu’une meute dont la principale source de
nourriture est l’orignal. Au parc, la population d’orignaux semble
à la baisse; les castors et les cerfs de Virginie constitueraient les
principales proies des loups.
La taille des meutes du parc n’a pu être établie avec certitude.
Dans la réserve faunique Papineau-Labelle, une étude a
démontré que la taille moyenne des meutes, en hiver, est
d’environ six loups. Cette étude cite également d’autres auteurs
qui avancent que dans les écosystèmes loup-cerf, la taille des
meutes varie de deux à dix individus, avec une moyenne
globale d’environ quatre. Dans les écosystèmes loup-orignal, les
meutes comptent en général de sept à dix individus (Potvin
1986).
Depuis 2007, on organise à la fin de l’été une soirée d’appel
contrôlé du loup dans le but de localiser les meutes et d’en
estimer le nombre d’individus. Voici quelques données sur des
meutes vues ou entendues au parc national au cours des
dernières années : lac Obéron 2006, quatre adultes, cinq
louveteaux; lac en Croix 2007, quatre adultes et quatre
louveteaux; lac à l’Eau Claire 2007, sept adultes; lac de la
Fourche 2009, quatre adultes; lac Montcourt 2009, un adulte et
trois louveteaux. Deux observations hivernales rapportent la
présence de plus grosses meutes : un observateur estime avoir
vu et entendu une meute de douze loups au lac Lajoie à l’hiver
1997; deux skieuses ont rapporté l’observation de 15 à 20 loups
au lac Poisson à l’hiver 2008-2009 (leur séquence vidéo n’a pas
permis de valider le nombre exact).
À l’été 1996, on a procédé à un relevé d’indices de présence du
loup (pistes, crottins, écoute de hurlements, observations). Bien
que les résultats aient été difficiles à analyser, la cartographie
des données suggérait la présence de cinq meutes : meute des
lacs Mocassins, Albert et aux Herbes; meute de la zone de
préservation de la Cachée; meute des lacs Saint-Louis, Escalier

PRIORITÉS ET POTENTIELS
DE RECHERCHE
-
2
-
et des Sables; meute des lacs Mathias, Casse-ligne et Coderre;
meute des lacs des Cyprès, Bébé et du Diable (Egerton 1996).
La familiarisation : Le loup est reconnu comme un animal discret
qui craint l’homme et s’enfuit à sa vue. Or, depuis quelques
années, on assiste en Amérique du Nord à un nouveau
phénomène : celui des loups familiers. Ces loups ont perdu la
peur séculaire de l’homme et circulent dans les campings et le
long des routes et des sentiers. Ils chapardent aussi de la
nourriture et des objets appartenant à des campeurs. Cette
cohabitation loup-humain, lorsqu’elle est tolérée, pousse les
loups à devenir de plus en plus téméraires. Des cas de
morsures et d’attaques, parfois mortelles, ont été recensés au
Canada et aux États-Unis. Ce phénomène se produit surtout
dans des endroits où les loups sont protégés et où
l’achalandage humain est grand. Au Québec, le phénomène des
loups familiers est apparu pour la première fois au début des
années 1990, au parc national du Mont-Tremblant, et s’est
intensifié depuis.
Des lignes directrices pour prévenir et gérer les cas de loups
familiers existent maintenant.
Priorités de recherche
I – Loup de l’Est : identification génétique de l’espèce
présente au parc
Selon le comité sur le suivi des espèces en péril au Canada
(COSÉPAC), le loup de l’Est pourrait être une espèce distincte.
Son aire de répartition exacte n’est pas connue, en partie en
raison de l’hybridation avec le loup gris. Bien qu’il n’y ait aucune
preuve de diminution du nombre d’individus ou de l’aire de
répartition géographique depuis les 20 dernières années, il est
possible que l’espèce s’hybride avec les coyotes; phénomène
qui s’est peut-être aggravé par des changements de l’habitat et
de l’exploitation forestière massive. L’identification de ce taxon
exige une analyse moléculaire.
Le parc national du Canada de la Mauricie a démontré que les
loups sur son territoire étaient des loups de l’Est.
II – Loup de l’Est : écologie et conservation de
l’espèce au parc
Une des premières étapes de l’acquisition de connaissances sur
nos loups consiste à mieux connaître leur territoire et la façon
dont ils l’utilisent. Ceci permettra par la suite de mieux les
étudier. Dynamique de la population, reproduction et mortalité,
importance de la dispersion dans la dynamique, relation avec le
coyote, densité des populations, territoire (domaines vitaux,
tanières, sites des rendez-vous), régime alimentaire, relation
avec le cerf de Virginie, l’orignal et le castor, impact des activités
récréatives et des infrastructures du parc, impact des activités
périphériques (piégeage des animaux à fourrure, chasse aux
gros gibiers, villégiature, etc.).
III – Loup de l’Est : relation avec les proies,
dynamique des populations et capacité de support du
milieu
Le loup est considéré comme un régulateur des écosystèmes.
Quel impact a-t-il sur les populations d’orignaux, de cerfs et de
castors? Comment les populations évoluent-elles dans le
temps? Comment interagissent-elles entre elles. Peut-on
envisager définir la capacité de support du milieu pour un tel
carnivore?
IV – Loup de l’Est : familiarisation et conservation
Pourquoi est apparu ce phénomène dans le secteur sud-ouest
du parc? Est-ce une nouvelle meute de loups qui se serait
installée à proximité des installations? Est-ce lié au phénomène
de nourrissage des cerfs de Virginie à l’extérieur du parc? Est-
ce simplement à cause de la familiarisation des proies?
Comment éviter que ce phénomène ne se reproduise? La ligne
de Fladry est-elle un outil efficace?
V – Loup de l’Est : perception de la clientèle et des
riverains face à cette espèce
Comment les riverains du parc national perçoivent-il la présence
de loups dans le parc? Qu’en est-il de l’opinion des piégeurs et
des chasseurs (territoire libre, ZEC, Réserve faunique)? La
présence des loups au parc national a quel impact sur la
clientèle de la Sépaq? Comment devrions-nous aborder la
gestion de cet animal et de sa familiarisation face à la clientèle?
VI – Bonification de l’indicateur de suivi des
populations de loups (PSIE) du parc

PRIORITÉS ET POTENTIELS
DE RECHERCHE
-
3
-
Actuellement le repérage et le dénombrement des loups se font
par appel et écoute des hurlements en fin d’été. Il conviendrait
d’analyser les paramètres de la méthode de récolte de données
et de l’analyse des données afin de la rendre plus performante
(date, heure, fréquence, répartition sur le territoire, formation
des participants, ajout de compilation d’autres indices d’activités
telles que pistes, carcasses et autres). Une méthode de suivi
plus efficace et plus simple d’opération serait souhaitable.
VII – Évaluation de l’impact de l’appel du loup sur leur
comportement
Cette évaluation requiert une étude qui inclurait un suivi
journalier des comportements et des déplacements de quelques
loups. Le comportement de ces loups pendant et après l’appel
devra être comparé au portrait de base tracé précédemment.
Références
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec
(MRNF). 2002. Guide interprétatif des dispositions de la loi
sur les parcs et du règlement sur les parcs. Québec. 23 p.
Parc national de Yellowstone. 2003. Management of
habituated wolves in Parc national de Yellowstone. National
park service, Wyoming, USA. 17 p.
Parc national et réserve de Denali. 2007. Wolf - Human
Conflict Management Plan, National park service. Alaska,
USA. 85 p.
Parc provincial Algonguin. 2000. Fearless Wolf Policy for
Algonquin Provincial Park (draft). Ontario, Canada, 2p.
Parcs Québec. 2006. Protocole de gestion des déprédateurs.
Société des établissements de plein air du Québec, Québec.
5 p.
Douglas W. Smith, D.R. Stahler and D. S. Guernsey. 2004.
Yellowstone Wolf Project. Annual Report 2004, Parc national
de Yellowstone, Wyoming, USA. 18 p.
Egerton, M. 1996. Following the wolves of Mont Tremblant
provincial park. Université McGill. 18 p.
Hénault, M.ET Jolicoeur, H. 2003. Les loups au Québec :
Meutes et mystères. Société de la faune et des parcs du
Québec, Direction de l’aménagement de la faune des
Laurentides et Direction du développement de la faune. 129 p.
Jolicoeur, H. ET M. Hénault. 2002. Répartition géographique
du loup et du coyote au sud du 52e parallèle et estimation
de la population de loups au Québec. Direction du
développement de la faune - Direction de l’aménagement des
Laurentides, Société de la faune et des parcs du Québec. 45 p.
Linnell, J., R. Andersen, Z. Aandersone L. Balciauskas, J.C.
Blanco, L. Boitani, S. Brainard, U. Breitenmoser, I. Kojola, O.
Liberg, J. Loe, H. Okarma, H. Pedersen, C. Promberger, H.
Sand, E. Solberg, H. Valdmann, P. Wabakken. 2002. The fear
of wolves: A review of wolf attacks on humans. NINA
Oppdragsmelding: 731:1–65.
Mack, C. M. and J. Holyan. 2004. Idaho Wolf Recovery
Program: Restoration and management of gray wolves in
central Idaho. Progress report 2003, Nez Perce Tribe,
Department of Wildlife Management, Lapwai, ID. 47 p.
McNay, M. 2002. A case history of human-wolf encounter in
Alaska and Canada. Alaska department of fish and games,
Alaska, USA. 45 p.
Musiani, M. 2003. Conservation Biology and Management of
Wolves and Wolf-Human Conflicts in Western North
America. Faculty of environmental studies, University of
Calgary, Alberta. 133 p.
Musiani, M and E. Visalberghi. 2001. Effectiveness of Fladry
on Wolves in captivity. Wildlife Society Bulletin, Vol. 29. No 1
(spring 2001). pp 91-98.
SHIVICK, JOHN A. 2006. Tools for the Edge: What’s New for
Conserving Carnivores, BioScience, March 2006. Vol. 56, No. 3.
Tennier, H. 2008. Lignes directrices pour la prévention et la
gestion des loups familiers au parc national du Mont-
Tremblant. Parc national du Mont-Tremblant, Parcs Québec,
Société des établissements de plein air du Québec, Lac
Supérieur. 53 p.
Davidson-Nelson, S. J., 2005. Testing Fladry as a non-lethal
control tool for reducing wolf-human conflict in Michigan.
Progress Report: July-October 2005. Department of Biology,
Central Michigan University. 3 p.
Wilson P. J. et al. DNA profiles of the eastern Canadian wolf
and the red wolf provide evidence for a common
evolutionary history independent of the gray wolf. Can. J.
Zool. 78: 2156–2166.

PRIORITÉS ET POTENTIELS
DE RECHERCHE
-
4
-
Cadieux, L. 2010. Synthèse des connaissances, Parc
national du Mont-Tremblant. Parcs Québec, Société des
établissements de plein air du Québec (Sépaq), Lac Supérieur.
PNMT-2 ➯
➯➯
➯
Les autres mammifères
État de la situation
Le cerf de Virginie, l’orignal, l’ours noir et le castor figurent parmi
les animaux vedettes du parc national. Ces espèces sont bien
connues en général, mais nous avons peu d’information sur les
populations du parc. Localement ces espèces ont de grands
intérêts et vivent des problématiques bien particulières.
Orignal : L’orignal est présent sur l’ensemble du territoire. Les
études de 1977 en évaluaient la population à trois individus sur
10 km. En 2009, on n’a pas de données sur les orignaux du
parc, mais on sait que les observations ont considérablement
diminué au cours des derniers vingt ans (commentaires des
gardes-parcs, d’autres employés travaillant sur le terrain et des
habitués du parc). Selon le Service de la faune, le déclin de la
population est un phénomène généralisé dans le territoire hors
parc des Laurentides et de Lanaudière depuis les années 1990
(Lamontagne et Lefort, 2004). Les chiffres des zones de chasse
périphériques situent la densité à environ deux orignaux sur 10
km², plus précisément à 1,9 avant chasse dans la réserve
faunique Rouge-Matawin (RFRM) (résultat préliminaire de
l’inventaire aérien de janvier 2009). Bien qu’il soit ouvert à la
chasse et à l’exploitation forestière, ce territoire se compare à
celui du parc par son caractère sauvage et l’absence
d’occupation humaine permanente et de municipalité.
Cerf de Virginie : Le cerf de Virginie est à la limite nord de son
aire de distribution. C’est un élément représentatif des
Laurentides méridionales, et il joue un rôle clef dans
l’écosystème. Sa population s’est accrue au cours des derniers
trente ans et durant l’été, on l’observe à travers tout le parc. À la
fin des années 1970, l’observation de cerfs était occasionnelle
(André Caron). Vers 1990, il semblait plus présent dans le
secteur de la Diable. Actuellement, il s’observe également
régulièrement à l’est et au nord du territoire.
L’hiver, les cerfs se regroupent dans des ravages, des sites de
rassemblement situés dans les vallées où le mélange de feuillus
et de conifères assure leur survie en leur fournissant abri et
nourriture pendant la saison froide.
On rencontre de petits groupes de cerfs en quelques points du
territoire pendant l’hiver (exemple : environs du lac Monroe et du
poste d’accueil de Saint-Donat), mais on ne connaît pas de
ravages d’importance responsables de la survie des cerfs de la
moitié est du parc. Dans les années 1950 à 1960, un important
ravage de cerfs s’étendait tout le long de la rivière L’Assomption
à l’intérieur des limites actuelles du parc (Michel Riopel, agent
de protection de la faune).
La survie d’une bonne partie des cerfs du centre et du sud du
parc national du Mont-Tremblant dépend du ravage situé au
pied du mont Tremblant et aux abords du lac Tremblant. La
présence de conifères et l’exposition au soleil des versants sud
et sud-ouest de la montagne expliquent l’importance de ce
ravage. Entre 1969 et 1998, sa superficie est passée de 14 km²
à 139 km², et sa population s’est accrue de 350 à plus de 2 500
individus (densité d’environ 20 cerfs par km²). Cette expansion
serait reliée à une augmentation de la population à la suite
d’une série d’hivers doux qui sont responsables du haut taux de
survie des cerfs à l’hiver et qui ont par conséquent favorisé la
naissance de faons au printemps. Toutefois, la qualité de
l’habitat varie à travers le ravage, et le développement
récréotouristique local menace l’intégrité et le maintien de cet
habitat. À la suite des nouveaux inventaires, on parlait en 2003
de 1740 cerfs dans 140 km². 36,4 km² du ravage est situé dans
le parc, dont une partie en zone de préservation. La protection
d’une partie du ravage à l’intérieur des limites du parc national
du Mont-Tremblant contribue à la survie des cerfs de Virginie.
Depuis quelques années, la présence de cerfs familiers
constitue un problème de conservation dans le secteur de la
Diable. Des cerfs nourris par les visiteurs perdent la crainte des
humains et sont victimes d’accidents de la route. On soupçonne
également leur présence sur les campings d’être responsables
de la présence de loups sur certains sites.
Ours noir : Mammifère typique des Laurentides, l’ours noir
trouve au parc national du Mont-Tremblant un habitat idéal. Les
forêts de feuillus et de conifères, les abords boisés des lacs et
cours d’eau lui fournissent abri et nourriture. La densité de l’ours
noir, basée sur la densité régionale, est estimée à 2,5 / 10 km²
(Michel Hénault, biologiste au MRNF 2009). Ce qui chiffrerait la
population d’ours du parc national du Mont-Tremblant à quelque
375 individus. En 2007, 2008 et 2009, on a observé ici et là des
femelles avec trois oursons de l’année, ce qui laisse penser que
la population d’ours du parc se porte bien (quoique non

PRIORITÉS ET POTENTIELS
DE RECHERCHE
-
5
-
exceptionnelles, les portées de plus de deux petits ne sont pas
fréquentes).
Castor : L’abondance des essences feuillues du domaine de
l’érablière à bouleau jaune et l’omniprésence du réseau
hydrographique expliquent l’omniprésence du castor. La densité
de la population était évaluée à 3,9 colonies par 10 km² en
1988. Nous ne possédons aucune donnée plus récente. On
constate que le castor profite actuellement de la régénération en
bouleau blanc, cerisier de Pennsylvanie et peuplier faux-tremble
de divers secteurs touchés par les coupes forestières à la fin
des années 1980. On remarque que les colonies installées dans
de telles zones riches en arbustes et arbres de faible diamètre
peuvent utiliser le même étang pendant de nombreuses années.
Les castors qui vivent de forêts plus matures, moins riches en
jeunes feuillus, changent plus souvent de territoire.
L’habileté des castors à construire des barrages et à créer des
étangs entre régulièrement en conflit avec l’utilisation que nous
faisons du territoire : ponceaux obstrués, routes et sentiers
inondés, aires de pique-nique et sentiers déboisés. À la fin des
années 1980, on signalait en moyenne 25 sites problématiques
par année et 21 cas de déportation de castors par année
(Jacques Tremblay). Depuis, on a mis au point des techniques
d’aménagement visant à concilier accessibilité du territoire et
conservation de cette espèce caractéristique des Laurentides
méridionales. Par exemple, l’aménagement de prébarrages et
l’installation de grillages et de tuyaux de divers types en
plusieurs endroits préviennent l’inondation de routes et de
sentiers. On constate maintenant une nette amélioration de la
situation : en 2009, on a dû relocaliser quatre castors
seulement, et on a connu des années sans relocalisation.
Priorités de recherche
I – Cerf de Virginie : dynamique de population,
caractérisation d’habitats et évolution
comportementale
Le cerf de Virginie ne ravagerait qu’à l’extérieur du parc
national. A quelques exceptions, il séjourne dans le territoire
environ huit mois par année. Son comportement et sa
dynamique de population sont grandement influencés par les
mois d’hiver passés à l’extérieur du parc. Le phénomène du
nourrissage hivernal a un impact majeur sur la répartition de cet
animal en hiver, et des modifications comportementales ont été
observées au cours des dernières années dans la région. Les
animaux délaissent les ravages vers les sites de nourrissage
hivernaux. De générations en générations les patrons
comportementaux changent.
La familiarisation des cerfs de Virginie à l’homme que l’on
constate dans le parc, s’apprend-elle au cours de l’hiver à
l’extérieur du territoire ou plutôt en été, au contact avec les
visiteurs du parc? Il est souhaitable de définir la dynamique
migratoire des cerfs visitant le parc, de caractériser les habitats
dont ils dépendent et d’évaluer la dynamique des populations
(natalité, mortalité, etc.). Il est aussi souhaitable d’évaluer
l’apprentissage dispensé par les mères à leur progéniture afin
de clarifier la démarche de familiarisation actuellement en cours.
II – Orignal : diminution des populations, pourquoi?
L’orignal occupe la majeure partie du territoire. Au cours des
dernières années, on remarque une baisse de son abondance.
Pourquoi? Les inventaires aériens réalisés dans la réserve
faunique Rouge-Matawin (territoire adjacent), entre 1996 et
2008, ont démontré que le segment de la population constituée
des femelles, avait connu une baisse majeure. Le nombre de
faons par 100 femelles aurait diminué de manière importante se
situant en deçà du 30 faons/100 femelles. Le phénomène
observé dans la réserve faunique est fort probablement présent
aussi dans le parc national. Comment se portent les populations
d’orignaux du parc national? Quelles sont les causes de cette
baisse de population? La fécondité des femelles est-elle en
cause?
Quelle est la dynamique de la population (reproduction et
mortalité)? Quel rôle joue la migration des orignaux dans le parc
national compte tenu de la présence des différents territoires
adjacents exploités par la chasse? Quelle est la qualité actuelle
de l’habitat de l’orignal dans le parc? Au-delà de l’inventaire,
quel est la capacité de support du milieu?
III – Ours noir : dynamique de population
L’année 2009 a été une saison particulièrement éprouvante
quand aux problématiques de déprédation de l’ours noir dans le
parc national. En bordure du parc national, la problématique a
été encore plus évidente particulièrement dans les municipalités
avoisinantes. Différentes options ont été envisagées par les
autorités gouvernementales afin de gérer les cas d’ours
inopportuns. Au-delà de cela, plusieurs questions demeurent.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
1
/
26
100%