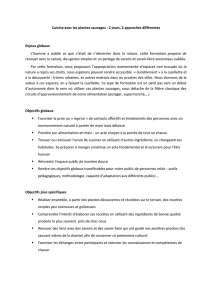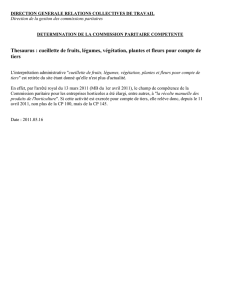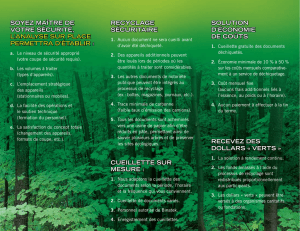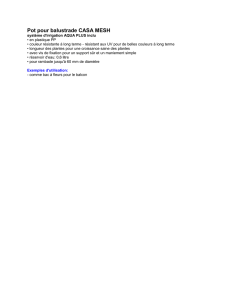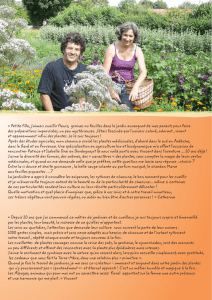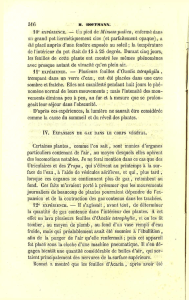La cueillette des plantes sauvages en Pyrénées Phase 2 : analyse

Rapport final
Raphaële Garreta, Béatrice Morisson
31 mai 2014
Syndicat mixte Conservatoire botanique pyrénéen
Vallon de Salut, BP 315 - 65203 Bagnères de Bigorre Cedex - Tél. : 05.62.95.85.30 - Fax : 05.62.95.03.48 –[email protected]
La cueillette des plantes sauvages en Pyrénées
Phase 2 : analyse et valorisation


1
Cueillir. Cueillettes. Citations… ............................................................................................................... 2
Introduction................................................................................................................................................ 3
I- Métier : cueilleur. Une profession en construction. ........................................................................... 6
A – L’AFC, l’Association française des professionnels de la cueillette de plantes sauvages ... 8
1- Présentation ............................................................................................................................... 8
2 - Bons et mauvais cueilleurs ; gestes et gestion ...................................................................... 11
3 - Quelques exemples de gestes gestionnaires. ..................................................................... 16
4 - Une pré-étude pour une charte de cueillette. .................................................................... 29
B. L’Association Interprofessionnelle de la Gentiane jaune, « Gentiana lutea » ..................... 31
C. De l’ombre à la lumière ; une visibilité en marche .................................................................. 32
1- Le projet FloreS ............................................................................................................................ 34
II. Cueillettes et cueilleurs en Pyrénées ; des types et des pratiques. ........................................... 37
A - Le cueilleur occasionnel. ............................................................................................................ 38
1- Une cueillette des petits plus. .............................................................................................. 38
2- Le cas du Muguet à Bagnères-de-Bigorre: des histoires de familles autour d’une
plante devenue « traditionnelle ». ............................................................................................... 40
B - L’artisan-cueilleur. ......................................................................................................................... 45
C. Le cueilleur pour l’industrie .......................................................................................................... 51
1 - Le cueilleur pour l’industrie affiliée à une coopérative ...................................................... 51
2 - Le cueilleur industriel indépendant ...................................................................................... 59
D. Le cueilleur saisonnier, « à la tâche ». ........................................................................................ 60
Conclusion .............................................................................................................................................. 67


2
Cueillir. Cueillettes. Citations…
« Au sens strict, la cueillette est définie comme l’acte par lequel on détache un fruit ou une fleur de sa tige,
c’est-à-dire comme un geste. En fait, toutefois, un tel geste n’est pas fait gratuitement : il tend à s’inscrire
dans une activité pratique destinée à récolter un bien déterminé en vue d’une utilisation précise. […]Celle-ci
ne saurait donc se réduire à un geste isolé, individuel et abstrait ; au contraire elle constitue une conduite
concrète qui s’inscrit dans des rapports sociaux dont elle tire sa place et sa signification. Conduite
d’appropriation des ressources d’un « territoire », la cueillette fait partie des « ces formes d’action sur la
nature (qui) sont toujours des formes sociales, qu’elles soient individuelles ou collectives ».
J.-L. Coujard, 1980, citant M. Godelier
Questionnant les activités de chasse et de cueillette en France, Christian Bromberger et Gérard Lenclud
remarquaient que ces deux domaines présentaient tous les signes de richesse d’un véritable domaine
d’étude anthropologique : « Il n’y manque ni profondeur historique, ni diversité des
espaces, ni variété des manifestations. Il y est question de l’homme et de la nature dans
toute leur gamme de relations : utilitaires, cognitives, symboliques. Il y est, par là-
même, question des rapports des hommes entre eux : pour organiser et réglementer les
activités, partager le territoire, en gérer les ressources ; mais aussi pour connaître et
se représenter les gestes, les animaux, les plantes, finalement établir des relations
symboliques, et ce faisant, énoncer des propositions sur eux-mêmes et le monde. »
Bromberger et Lenclud, 1982
Evoquant l’étude qu’ils menèrent en Margeride, Raphaël Larrère et Martin de la Soudière notaient que
« Malgré ces précautions méthodologiques, les difficultés restèrent nombreuses ; elles tenaient
principalement à la discrétion des cueilleurs sur leurs revenus, à l’irrégularité de leur pratique et à son
inégale diffusion d’un village à l’autre. Nous avions aussi parfois l’impression que l’essentiel nous
échappait et se situait au-delà de nos observations et de nos interprétations : les motivations les plus
profondes des cueilleurs, leur opiniâtreté, leur imaginaire. Plus que d’autres activités, la cueillette en
effet oppose une résistance à l’analyse, résistance qu’aucune discipline, économie, sociologie,
ethnologie…, ne parvient à contourner ni à surmonter complètement. » R. Larrère et M.de La Soudière,
1985
« Activité aléatoire et ambulatoire, la cueillette est difficile à
définir ; difficile aussi d’en classer les acteurs (Larrère et La Soudière,
1985). […] existe néanmoins […] un « esprit de cueillette », qui réunit ces
pratiques toutes géographiquement et socialement situées dans une marge :
marge de la ville ou des territoires cultivés ; marge des activités
économiques dominantes. »
M. de La Soudière et Védrine, 2003
« La cueillette est un geste simple d’appropriation qui transforme le végétal en ressource économique, en
manne inespérée, en trophée, en trésor, en symbole… Sous ses apparences anodines, dans la diversité de ses
manifestations, elle témoigne d’un rapport complexe et ancien au végétal, et de fait questionne notre
relation à la nature : une relation ambiguë – entre adoration et prédation amnésique. »
C. Julliand, 2008
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
1
/
135
100%