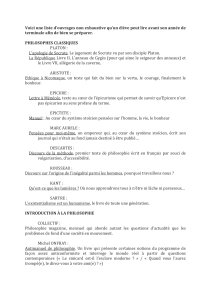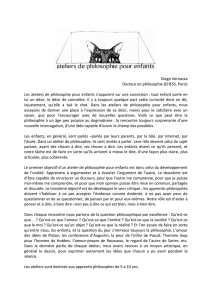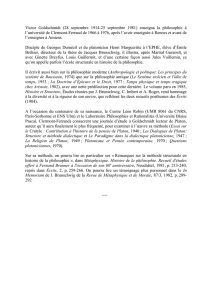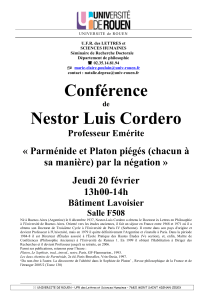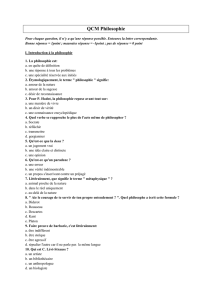Le voyage philosophique L`une des plus

21
Le voyage philosophique
L’une des plus réconfortantes découvertes que l’on
puisse faire est celle de l’autorisation d’accès. Nous autres
Occidentaux, sommes toujours prêts à proclamer des droits
de l’homme. Mais savons-nous autoriser ? On n’autorise
pas par des proclamations générales, mais en maintenant
des accès ouverts, en ne cachant jamais qu’il y a des accès.
À quoi me sert par exemple de savoir que j’ai un droit
au travail, que la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme me le garantit expressément, si l’accès au travail
m’est interdit ? L’accès au travail n’est pas interdit parce
qu’un droit serait suspendu ou bafoué, mais par un blocage.
L’entrée est bloquée. Qu’est-ce qui provoque cette obstruc-
tion ? Entre autres causes, le sentiment de ne pas être auto-
risé. Certains n’ont pas à vivre cette situation de blocage.
Des circonstances favorables, des incitations, des prédes-
tinations ont fait qu’ils sont nés autorisés. D’autres sentent
que les accès sont bloqués. Ils auraient besoin d’une poli-
tique qui ouvre pour eux des possibilités concrètes au lieu

22
de proclamer qu’elles sont ouvertes. Mais comment ouvre-
t-on des possibilités à celui qui ne voit devant lui qu’un
horizon bouché ?
On se souvient de la parabole du portier dans le Procès
de Kafka. Devant la loi, il y a un portier. Un homme de la
campagne arrive et sollicite d’entrer. Le portier lui répond :
« C’est possible, mais pas pour l’instant. » L’homme remar-
que pourtant que la porte est grande ouverte. Il se penche
pour regarder à l’intérieur. Le portier lui dit : « Essaie
d’entrer malgré mon interdiction. Mais attention : je suis
puissant. Et je ne suis que le dernier de tous les portiers.
Mais de salle en salle, il y a des portiers, chacun plus puis-
sant que le précédent. » L’homme décide donc d’attendre
l’autori sation d’entrer. Assis sur un tabouret, il attend des
jours, puis des années. L’autorisation ne vient toujours pas.
L’homme atteint l’extrême vieillesse. Près de mourir, dans
un dernier effort, il demande au portier : « Comment se
fait-il que personne, à part moi, n’ait sollicité l’entrée pen-
dant toutes ces années ? » Le portier lui répond : « Personne
d’autre ne pouvait obtenir l’autorisation d’entrer, car cette
entrée n’était faite que pour toi seul. Maintenant, je m’en
vais et je ferme. »
Que dit cette parabole ? En premier lieu, elle explique
ce qu’est une autorisation. Elle n’est jamais générale.
Elle s’adresse toujours à quelqu’un en particulier. Elle
le prend en compte, lui, et personne d’autre. Le droit, la
loi, concernent un humain abstrait, un X qui remplit des
conditions déterminées. La loi, le droit, peuvent autoriser,
mais toujours sous certaines conditions. On peut autoriser

23
quelqu’un à ouvrir un bureau de tabac, on peut lui dé li-
vrer un permis de port d’arme, etc. Cette autorisation est
conditionnelle : on délivre un permis si certaines con-
ditions réglementaires sont réunies. Mais il est possible
de concevoir une autorisation qui serait inconditionnelle.
Elle s’exprime ainsi : tu es autorisé, parce que c’est toi.
Une telle autorisation ne peut être qu’une grâce. Dans
cette parabole, le drame de l’homme est de n’avoir pas
su que l’accès lui était autorisé comme une grâce, c’est-
à-dire ouvert inconditionnellement et ouvert pour lui
seul. On peut songer à tous ceux qui sont passés à côté de
possibilités, simplement parce qu’ils ont cru qu’elles ne les
concernaient pas. Certains passent à côté de la musique,
de la littérature, des études, d’une spécialisation, d’une
aventure amoureuse, d’un mariage, parce qu’ils croient
que ces voies ne sont pas pour eux. Mais comment savoir ?
Comment l’homme aurait-il pu savoir que la porte lui
était ouverte, si précisément le portier lui en interdisait
constamment l’entrée ? Eh bien, il aurait dû être mis en
état de découvrir que la porte lui faisait signe. Quelqu’un,
quelque chose, aurait dû se présenter pour le conforter. Une
voix aurait dû se faire entendre.
La philosophie est cette voix qui autorise. En philoso-
phie, on est autorisé inconditionnellement, absolument. Ce
n’est pas l’impression que donnent beaucoup de livres et
de cours, qui paraissent interdire l’accès ou ne l’autoriser
qu’à certains prols intellectuels. Mais cette impression
est fallacieuse : en philosophie, un accès n’est ouvert que
pour moi et resterait ouvert pour rien si je ne l’empruntais

24
pas. Il faut juste ne pas se laisser impressionner par les
vigiles, examinateurs et autres physionomistes qui gardent
le temple.
Cet accès permet le voyage au pays de la philosophie.
On sait qu’il y a plusieurs types de voyageur. On peut en
distinguer au moins trois. Le premier commence par par-
courir les guides, par rêver de longues heures sur les cartes.
Il nit par choisir la formule du voyage organisé. Son péri-
ple sera un parcours balisé. Il se mettra entre les mains des
organisateurs et des hôteliers. Il mettra ses pas dans les pas
des auteurs de guides et des explorateurs qui ont dressé les
cartes. Il appréciera les sites et les paysages à travers le
commentaire des cicérones, il sera nourri d’adjectifs pour
exprimer ses sensations, éclairé d’informations et de réfé-
rences culturelles. En matière d’exotisme, on lui en don-
nera pour son argent, mais on fera tout pour lui éviter un
trop grand dépaysement.
Le second voyageur est le touriste désireux d’échapper
aux agences de voyages, mais pourvu malgré tout de quel-
ques bonnes cartes et guides recommandés. Son voyage
est marqué par l’esprit de la boussole. Ses pensées sont
constamment dirigées vers un nord et, symétriquement,
vers un sud. Le nord est celui de sa formation intellectuelle
et de ses préjugés, ainsi que le savoir des guides, des récits
de voyages, des repérages virtuels qu’il a faits sur le Net.
Le sud est le pays où il se rend. C’est le marcheur de la
tension constante, du conit entre deux tendances contra-
dictoires : une rationalité qu’il transporte comme bagage
et un besoin de lieux différents qui lui fassent vivre une

25
véritable expérience de l’altérité. Il marche avec son guide
à la main. Il consulte de temps en temps les cartes. Il
n’avance pas pour autant le nez collé sur les pages. Il est
d’abord fasciné par les paysages et les lieux. Il ne regarde
les guides que pour y retrouver les sensations qu’il éprouve
sur le terrain, curieux de voir comment les spécialistes
de la visite guidée en parleront. Il lui arrive d’éprouver la
pauvreté, la sécheresse des descriptions. Il note quelque-
fois des erreurs, il remarque que les auteurs deviennent
elliptiques ou négatifs dans certains passages comme s’ils
voulaient détourner l’attention, voire même interdire l’ex-
ploration. Il remet le livre dans sa poche et se contente
d’ouvrir simplement les yeux.
Le troisième voyageur est un explorateur qui n’a aucune
peur de l’aventure. Ce marcheur dans l’âme ne s’est
encombré d’aucun guide, d’aucune carte. Le voyageur
que fait vivre Jack Kérouac, dans Sur la route, se lance
au hasard des rencontres et des étapes en auto-stop, dans
les im menses plaines américaines. Pour un tel voyageur,
seul compte d’être sur la route. Seul lui importe d’aller tout
droit. Il n’a pas besoin de cartes parce qu’il ne bifurque pas,
ne fait pas de parcours touristiques, ne passe pas par des
étapes. On trouve quelquefois dans les lms un person-
nage qui arrête un taxi et ne donne au chauffeur aucune
destination. Il se contente d’un « Allez tout droit ». Peu
importe où il va, c’est l’impression d’aller, d’avancer qui
compte. Toutes les directions n’en sont plus qu’une quand
on se lance au hasard : droit devant. Il n’y a plus de sud,
de nord, d’occident, d’orient. Descartes incarne très bien
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%