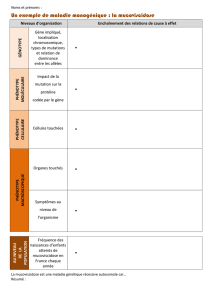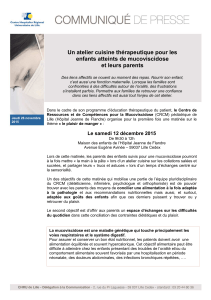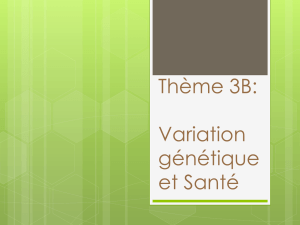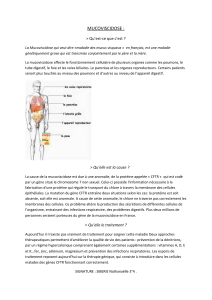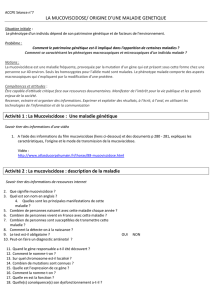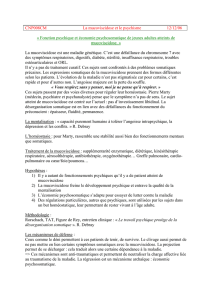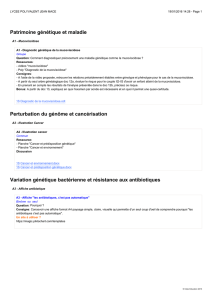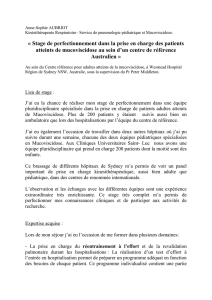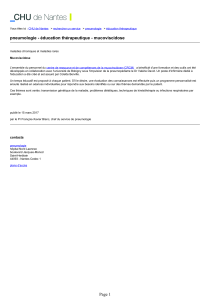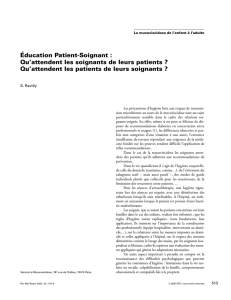L`analyse des comportements féconds dans un contexte

La fécondité – Représentation, causalité, prospective
Actes du XV
e
colloque national de démographie
22
L’analyse des comportements féconds dans un contexte de
maladie rare : l’exemple de la mucoviscidose
Gil
B
ELLIS
,
Marie-Hélène
C
AZES
,
Alain P
ARANT
Institut national d’études démographiques (Ined)
En Europe, sur 100 000 habitants, approximativement 12 sont malades de la
mucoviscidose, 8 sont atteints d’hémophilie et 6 ont la maladie de Huntington.
Mucoviscidose, hémophilie, maladie de Huntington sont des affections dites « rares », non
parce qu’elles sont peu nombreuses – on estime, actuellement, leur nombre total à près de
7 000 –, mais parce qu'elles ne concernent chacune qu’un nombre restreint de personnes, leur
prévalence étant inférieure à 50 pour 100 000.
Ces trois affections ont une origine génétique, origine la plus fréquente des maladies
rares qui peuvent également avoir une cause infectieuse, auto-immune ou cancéreuse. La
mucoviscidose est représentative des maladies à hérédité autosomique récessive : les
personnes atteintes sont indifféremment de sexe masculin ou féminin ; la mutation
16
responsable de la maladie leur a été transmise à la fois par leur père et par leur mère, ces
derniers ne présentant aucun des traits de la pathologie. Pour ce type d’hérédité, la probabilité
pour que le couple parental – couple de porteurs sains
17
– ait un enfant malade est de 0,25 à
chaque conception, les symptômes de la mucoviscidose se manifestant, le plus souvent,
durant la première année de vie, voire dès la naissance. L’hémophilie est une maladie
récessive liée au chromosome X : seuls les garçons sont atteints, la mutation
18
étant transmise
par les mères. La probabilité, pour un couple dont la femme est porteuse mais non malade,
d’avoir un garçon atteint est de 0,5 à chaque conception masculine, les premières
manifestations hémorragiques intervenant généralement durant l’apprentissage de la marche.
La maladie de Huntington est typique des maladies à hérédité autosomique dominante :
hommes et femmes sont indistinctement touchés ; ils ont reçu une mutation
19
transmise par
leur père ou par leur mère, le parent concerné étant lui-même malade. La probabilité pour un
couple dont un des membres est malade de donner naissance à un enfant atteint est de 0,5 à
chaque conception, les troubles de la maladie se manifestant à l’âge adulte, habituellement
entre 35 et 60 ans.
On retrouve chez nombre de maladies rares des caractéristiques identiques : elles sont
souvent graves, chroniques, évolutives et peuvent mettre en jeu le pronostic vital des
16
Le gène en cause est situé sur le chromosome 7, en position 7q31 ; ce gène comporte en fait plus de
1 600 mutations, toutes responsables de la mucoviscidose mais pouvant donner lieu à des formes plus ou moins
sévères de la maladie.
17
On estime que les porteurs sains de la mucoviscidose représentent, tous âges confondus, près de 3 %
de la population française, sous l’hypothèse d’une population en équilibre de Hardy-Weinberg pour le gène
responsable de cette maladie.
18
Sur le chromosome X, la mutation du gène en position Xq28 est responsable de l’hémophile A, la
mutation en position Xq27 est responsable de l’hémophilie B.
19
Pour cette maladie, la mutation est celle d’un gène situé sur le chromosome 4, en position 4p16.

La fécondité – Représentation, causalité, prospective
Actes du XV
e
colloque national de démographie
23
personnes atteintes ; elles s’accompagnent, dans de nombreux cas, de déficits qui peuvent être
sensoriels, moteurs ou mentaux ; en termes de qualité de vie, elles entraînent couramment une
restriction des activités de la vie quotidienne, une limitation de la participation sociale et
exposent les malades à une certaine vulnérabilité. Force est pourtant de constater que ces
maladies rares et les populations qu’elles affectent ne font l’objet, dans leur très grande
majorité, que d’une observation statistique très limitée, sinon inexistante, pour des raisons
tenant à l’extrême faiblesse du nombre de malades, à une insuffisante contribution des
praticiens ou encore à un déficit de coordination entre les différentes parties prenantes.
De ce point de vue, la mucoviscidose constitue, en France, une notoire exception. En
1965 fut, en effet, créée une association de malades, parents de malades, médecins,
chercheurs et sympathisants (successivement dénommée Association française de lutte contre
la mucoviscidose jusqu’en 2000, puis Vaincre la mucoviscidose) qui s’est dotée, depuis 1992,
d’une structure – l’Observatoire national de la mucoviscidose (ONM), auquel s’est substitué,
en 2006, le Registre français de la mucoviscidose (RFM) – procédant à un recueil annuel de
données évolutives médicales, sociales et familiales pour chaque patient consultant dans les
centres de soins agréés
20
. Cette structure a été progressivement enrichie par des enquêtes
thématiques complémentaires, dont une enquête « grossesses ».
L’existence d’une telle base de données justifie un essai d’analyse des comportements
féconds dans le cadre de la mucoviscidose, cette analyse pouvant être envisagée du double
point de vue de la population malade et de la population des parents des malades.
1. La fécondité des femmes malades de la mucoviscidose
Dans le cadre de l’ONM jusqu’en 2005, comme dans celui du RFM depuis 2006, les
questionnaires des enquêtes auprès des malades comportent un item relatif aux grossesses et
paternités survenues au cours de l’année. Pour les femmes ayant déclaré un test de grossesse
positif, un recueil complémentaire d’informations est réalisé au travers d’un questionnaire
thématique. Outre les données d’identification du clinicien et de la patiente, ces informations
concernent les circonstances de la grossesse et son issue, ainsi que les modalités de l’éventuel
accouchement et quelques caractéristiques de l’enfant né (annexe 1). Les renseignements
provenant de ce questionnaire thématique sont appariés à ceux du questionnaire général
(ONM ou RFM), puis intégrés à la base de données déjà constituée.
20
Dans le cadre du RFM, le recueil de données s’effectue auprès des malades des 49 centres de soins
agréés par le ministère de la Santé par l’intermédiaire de trois questionnaires : un questionnaire d’inclusion (pour
les patients dont le diagnostic de mucoviscidose est confirmé cliniquement selon les critères de diagnostic en
vigueur et également pour les patients dont le diagnostic de mucoviscidose est douteux et qui seront sortis du
registre si le diagnostic est infirmé) ; un questionnaire de mise à jour annuelle (pour les patients en phase de
suivi) ; un questionnaire de modification ou d’arrêt de suivi (pour les patients décédés, perdus de vue, émigrés à
l’étranger, transférés dans un autre centre de soins et pour les patients dont le diagnostic de mucoviscidose a été
éliminé).

La fécondité – Représentation, causalité, prospective
Actes du XV
e
colloque national de démographie
24
Les conditions paraissent, en théorie, réunies pour analyser la fécondité de la
population malade – féminine, plus particulièrement – et son évolution au fil du temps
21
.
Dans la pratique, cette analyse se révèle malaisée et incertaine.
Sur fond de hausse des effectifs de personnes malades, le nombre de paternités et de
grossesses déclaré tend lui aussi à augmenter depuis dix ans (tableau 1). Pour se limiter aux
déclarations de grossesses enregistrées par l’ONM sur la période 1999-2005 (la seule pour
laquelle, à ce jour, une exploitation des fiches grossesses a été réalisée
22
), il apparaît que cette
exploitation a été très irrégulière et partielle : 50 grossesses documentées seulement sur un
total de 141 grossesses déclarées sur la période 1999-2005 (soit à peine plus du tiers). Ces
lacunes de l’exploitation sont d’autant plus dommageables pour l’analyse de la fécondité
qu’une partie des grossesses documentées n’a pas pour issue une naissance vivante : sur les
50 grossesses documentées, une a été volontairement interrompue et 5 se sont terminées par
un avortement spontané (fausse couche)
23
.
La mise en rapport des naissances effectives d’une année à la population des patientes
en âge de procréer cette année-là induit une série de taux de fécondité générale et de taux par
âge très erratique.
T
ABLEAU
1 :
PATERNITÉS ET GROSSESSES DÉCLARÉES
,
NAISSANCES ET POPULATION FÉMININE
EN ÂGE DE PROCRÉER
(
DONNÉES D
’
OBSERVATION
,
1999-2009)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Paternités déclarées
dans l’année (1) 3 10 14 6 17 17 17 17 15 20 21
Grossesses déclarées
dans l’année (2) 23 10 10 25 21 27 25 24 33 36 34
– dont grossesses
documentées 12 4 3 9 9 7 6 - - - -
– dont issues naissances
vivantes 8 3 2 6 3 3 4 - - - -
Naissances vivantes de
l’année 5 3 3 6 10 7 13 - - - -
Patientes âgées de 15 à
49 ans
Effectifs à l’enquête 639 682 766 868 903 1 034 1 106 1 173 1 214 1 307 1 372
Effectifs théoriques à la
naissance (3) 3 203 3 192 3 187 3 181 3 177 3 173 3 167 3 162 3 153 3 142 3 129
(1) Test de paternité positif.
(2) Test de grossesse positif.
(3) Effectifs calculés en appliquant aux naissances de filles enregistrées en France un taux d’incidence à la
naissance de 1/4 348
24
.
Source : ONM, RFM.
21
Les données antérieures à 1999, date à laquelle la gestion de l’ONM et l’analyse de la base de
données furent confiées à une équipe de chercheurs de l’Ined, ne seront pas prises en considération ici. Depuis
2008, la gestion du RFM incombe à Vaincre la mucoviscidose mais l’analyse des résultats est toujours confiée à
l’Ined.
22
L’exploitation des questionnaires de l’enquête thématique grossesses est assurée par Isabelle Durieu,
professeur au centre hospitalier Lyon Sud.
23
8 % des 50 naissances effectives ont résulté d’une procréation médicalement assistée.
24
Anne Munck, Jean-Louis Dhondt, Élise Houssin et Michel Roussey, « Dépistage néonatal de la
mucoviscidose, mise en place, implication des laboratoires et résultats nationaux », Revue francophone des
laboratoires, 2007, 397, p. 67-72.

La fécondité – Représentation, causalité, prospective
Actes du XV
e
colloque national de démographie
25
2. Mucoviscidose et taille des fratries
Dans le contexte de la mucoviscidose, comme dans celui des autres maladies
génétiques, c’est le statut biologique de chaque membre du couple parental qui détermine la
probabilité d’avoir, à chacune des conceptions, un enfant sain ou un enfant malade. La
mucoviscidose étant une maladie récessive, c’est à l’occasion de la présentation des
symptômes chez l’enfant atteint – quel que soit le rang de naissance de cet enfant – que se
déduit le statut de porteurs sains des deux parents
25
. Sous réserve d’une connaissance
préalable de ce statut, un diagnostic prénatal peut être réalisé afin de déterminer si un enfant à
naître sera atteint de la maladie et en présentera les symptômes au cours de sa vie. Dans
l’hypothèse d’un diagnostic prénatal défavorable, la mère, sinon le couple, peut décider de
mettre un terme à la grossesse par avortement thérapeutique.
Une question qui se pose ici est de savoir dans quelle mesure la naissance d’un enfant
malade exerce, ou non, un effet sur la probabilité d’agrandissement de la famille.
Les modifications apportées aux questionnaires d’enquêtes annuelles lors de la
transformation de l’ONM en RFM font que tenter de lever cette interrogation n’est possible
que sur la période courant jusqu’en 2005. Le volet « Données sociales » des questionnaires de
l’ONM visait en effet à recueillir, pour chaque malade inclus, la taille de sa fratrie, le rang
dans sa fratrie, ainsi que le nombre de frères et sœurs (vivants ou décédés) atteints de
mucoviscidose, autant d’informations qui ne sont plus désormais collectées (annexe 2).
Le tableau 2 donne la répartition des patients présents dans la base ONM en 2005 selon
la taille des fratries, quand celle-ci est inférieure à 6
26
.
T
ABLEAU
2 :
R
ÉPARTITION DU NOMBRE DE MALADES PAR FRATRIE SELON LA TAILLE DE LA
FRATRIE
(
DONNÉES D
’
OBSERVATION
,
O
NM
2005)
Enfants atteints
dans la fratrie Taille de la fratire
1 2 3 4 5
1 966 (100) 907 (79,1) 454 (73,3) 120 (53,6) 40 (46,0)
2 240 (20,9) 141 (22,8) 79 (35,3) 32 (36,8)
3 24 (3,9) 23 (10,3) 13 (14,9)
4 2 (0,9) 2 (2,3)
5 0 (0,0)
Total 966 (100) 1 147 (100) 619 (100) 224 (100) 87 (100)
Note : les pourcentages (entre parenthèses) ne somment pas toujours exactement à 100 du fait des arrondis.
Champ : population des patients pour lesquels l’information sur la taille de la fratrie est disponible (3 043/4 744
= 64,1 % de la population de l’ONM en 2005).
Cette répartition observée peut être comparée à celle attendue en théorie, compte tenu
du mode d’hérédité de la maladie : sur
N
tirages au sort et si chaque tirage a une probabilité
25
Il pourrait en être autrement si les autorités compétentes décidaient d’instaurer un dépistage
systématique des porteurs dans une population.
26
En 2005, 87 patients appartenaient à des fratries de taille 6 ou plus. Cette faiblesse numérique et la
nécessité de constituer une classe unique « 6 enfants ou plus » se prêtant mal à une comparaison avec les
données résultant de la loi binomiale, ont conduit à l’exclusion des fratries les plus nombreuses.

La fécondité – Représentation, causalité, prospective
Actes du XV
e
colloque national de démographie
26
constante p = 1/4 de fournir le résultat
A
et une probabilité
pq
−
=
1
de fournir le résultat
alternatif
B
, alors la probabilité
xN
P
,
d’obtenir
x
fois le résultat
A
suit une loi binomiale de
formule :
xNx
xN
xNx N
P
−
−
=4
3
4
1
)!(! !
,
.
Ainsi, la fréquence des malades dans des fratries de taille
N
dont au moins un membre
a la mucoviscidose (le patient connu par l’ONM) est égale à :
0,
,
1
N
xN
P
P
F−
=, ce qui conduit à la distribution théorique suivante (tableau 3).
T
ABLEAU
3 :
R
ÉPARTITION ATTENDUE
(
EN
%)
DU NOMBRE DE MALADES PAR FRATRIE SELON LA
TAILLE DE LA FRATRIE
(
RÉPARTITION THÉORIQUE DÉDUITE DE LA LOI BINOMIALE
)
Enfants atteints
dans la fratrie Taille de la fratrie
1 2 3 4 5
1 100 85,7 73,0 61,7 51,9
2 14,3 24,3 30,9 34,6
3 2,7 6,9 11,5
4 0,6 1,9
5 0,1
Total 100 100 100 100 100
Note : les pourcentages ne somment pas toujours exactement à 100 du fait des arrondis.
Note de lecture : la probabilité d'avoir un seul enfant malade de la mucoviscidose, dans une fratrie de 3 enfants,
est de 73 % ; la probabilité d'avoir 2 enfants malades, dans une fratrie de 3 enfants, est de 24,3 % ; la probabilité
d'avoir les 3 enfants malades, dans une fratrie de 3 enfants, est de 2,7 %.
Les distributions observée et théorique du nombre de malades dans les fratries de taille
N peuvent être comparées, terme à terme, à l’aide du test du
2
χ
; on obtient les résultats et les
niveaux de signification suivants pour le nombre de degrés de liberté approprié :
– pour les fratries de 2 enfants : 096,41
2
=
χ
;
001,0
<
p
;
– pour les fratries de 3 enfants : 789,3
2
=
χ
; non significatif ;
– pour les fratries de 4 enfants : 791,7
2
=
χ
; non significatif ;
– pour les fratries de 5 enfants : 771,1
2
=
χ
; non significatif.
Dans les fratries de taille 2, le substantiel écart entre distribution observée et
distribution théorique ne relève pas du seul hasard, contrairement à ce qui prévaut pour les
fratries de taille supérieure.
Ce résultat, simplement descriptif, ne peut être interprété abstraction faite de la
constitution de la fratrie et du rang de naissance du malade, sa venue au monde ayant pu
pousser ses parents à adopter un comportement malthusien.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%