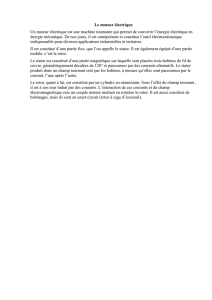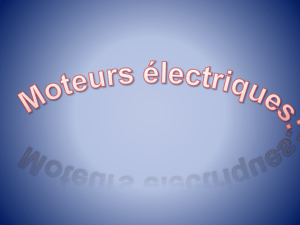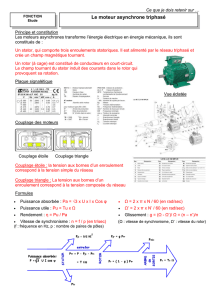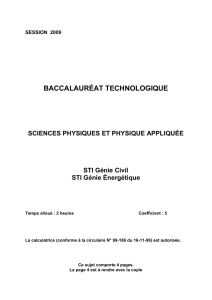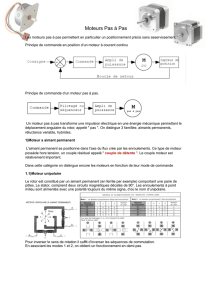La machine synchrone (mod`ele simplifié) - Institut Montefiore

D´
epartement d’Electricit´
e, Electronique et Informatique
(Institut Montefiore)
Notes th´
eoriques du cours ELEC0014
Introduction to electric power and energy systems
La machine synchrone
(mod`
ele simplifi´
e)
Thierry VAN CUTSEM
directeur de recherches FNRS
professeur adjoint ULg
Novembre 2016

La majeure partie de l’´
energie ´
electrique est produite `
a l’heure actuelle par les machines syn-
chrones des centrales thermiques et hydrauliques. Les machines synchrones jouent un rˆ
ole impor-
tant : (i) ce sont elles qui imposent la fr´
equence des tensions et courants alternatifs ; (ii) elles
mettent `
a disposition du r´
eseau un r´
eservoir d’´
energie (cin´
etique) permettant de faire face, dans
les premiers instants, aux d´
es´
equilibres entre production et consommation, et (iii) elles peuvent
produire et absorber de la puissance r´
eactive, n´
ecessaire `
a la r´
egulation des tensions.
Dans ce chapitre nous rappelons le principe de fonctionnement de ce composant important et nous
´
etablissons un mod`
ele simplifi´
e, valable pour une machine `
a rotor lisse. Nous nous int´
eressons
alors au r´
egime permanent pour ´
etablir le circuit ´
equivalent et dresser les bilans de puissance.
Nous consid´
erons enfin les limites de fonctionnement admissible.
1 Principe de fonctionnement
1.1 Champ magn´
etique cr´
e´
e par le stator
Une des motivations de l’emploi du syst`
eme triphas´
e est la production d’un champ tournant dans
les machines `
a courant alternatif.
Les machines ´
electriques tournantes, tels les g´
en´
erateurs des centrales ´
electriques, sont constitu´
ees
d’un stator, qui est la partie fixe, et d’un rotor, qui est la partie tournante, s´
epar´
ee de la premi`
ere par
un mince entrefer. Stator et rotor sont tous deux fabriqu´
es dans un mat´
eriau `
a haute perm´
eabilit´
e
magn´
etique.
Le stator d’un machine tournante triphas´
ee est ´
equip´
e d’un ensemble de trois enroulements, cor-
respondant chacun `
a une phase. Un de ces enroulements, que nous supposerons relatif `
a la phase
a, est repr´
esent´
e en coupe `
a la figure 1.
Si l’on injecte un courant continu dans l’enroulement en question, les lignes du champ magn´
etique
se pr´
esentent comme montr´
e`
a la figure 1. La perm´
eabilit´
e magn´
etique du mat´
eriau utilis´
e dans le
rotor et le stator ´
etant beaucoup plus ´
elev´
ee que celle de l’entrefer, les lignes de champ traversent ce
dernier radialement (c’est-`
a-dire perpendiculairement `
a la surface ext´
erieure du rotor et la surface
int´
erieure du stator).
Rep´
erons un point quelconque P de l’entrefer au moyen de l’angle φ, d´
efini `
a la figure 1 et
d´
esignons par B(φ)l’amplitude de l’induction magn´
etique en ce point.
B(φ)est une fonction p´
eriodique (de p´
eriode 2π) “en escalier”. Afin d’induire des f.e.m. si-
nuso¨
ıdales dans les enroulements statoriques, les constructeurs s’efforcent de rendre cette fonction
aussi proche que possible d’une sinuso¨
ıde, en r´
epartissant judicieusement les conducteurs d’une
mˆ
eme phase le long du stator. La distribution spatiale non uniforme des conducteurs est sugg´
er´
ee
`
a la figure 1.
2

stator
axe de la phase a
rotor
entrefer
(largeur exag´
er´
ee par rapport
φ
aux autres dimensions)
P
FIGURE 1 – ligne du champ magn´
etique cr´
e´
e par un courant continu parcourant la phase a
Supposant que la variation B(φ)est sinuso¨
ıdale et tenant compte du fait que l’induction est pro-
portionnelle au courant, on peut ´
ecrire pour la contribution de la phase a:
B(φ) = kiacos φ(1)
o`
u le facteur kd´
epend de la g´
eom´
etrie, de l’emplacement et du nombre de conducteurs.
L’enroulement de la phase b(resp. c) est d´
ecal´
e spatialement de 2π/3(resp. 4π/3) radians par
rapport `
a celui de la phase a1. La figure 2.a montre la disposition des trois phases, en repr´
esentant
symboliquement chaque enroulement par une seule spire, pour des raisons de lisibilit´
e.
L’induction totale cr´
e´
ee par les trois phases vaut donc, au point correspondant `
a l’angle φ:
B3ϕ=kiacos φ+kibcos(φ−2π
3) + kiccos(φ−4π
3)
et si l’on alimente l’ensemble par les courants triphas´
es ´
equilibr´
es :
B3ϕ=√2kI cos(ωt +ψ) cos φ+ cos(ωt +ψ−2π
3) cos(φ−2π
3)+
+ cos(ωt +ψ−4π
3) cos(φ−4π
3)
=√2kI
2cos(ωt +ψ+φ) + cos(ωt +ψ−φ) + cos(ωt +ψ+φ−4π
3)
+ cos(ωt +ψ−φ) + cos(ωt +ψ+φ−2π
3) + cos(ωt +ψ−φ)
=3√2kI
2cos(ωt +ψ−φ)(2)
1. la position relative des phases dicte le sens de rotation du champ et donc du rotor. Dans le cas pr´
esent, on
suppose que le rotor tourne dans le sens trigonom´
etrique
3

FIGURE 2 – disposition des enroulements statoriques triphas´
es : (a) machine `
a une paire de pˆ
oles
(p= 1) ; (b) machine `
a deux paires de pˆ
oles (p= 2)
2π0
ω
N
S
φ
FIGURE 3 – onde d’induction circulant dans l’entrefer (d´
eroul´
e)
Cette ´
equation est celle d’une onde qui circule dans l’entrefer `
a la vitesse angulaire ω, comme
repr´
esent´
e`
a la figure 3, dans laquelle l’entrefer a ´
et´
e “d´
eroul´
e”.
Les trois courants triphas´
es produisent donc un champ magn´
etique tournant, comme le ferait un
aimant tournant `
a la vitesse angulaire ω. Les pˆ
oles Nord et Sud de cet aimant co¨
ıncident avec les
extrema de la fonction B(φ)(cf figure 3).
4

1.2 Champ magn´
etique cr´
e´
e par le rotor
Le rotor d’une machine synchrone comporte un enroulement qui, en r´
egime ´
etabli, est parcouru
par du courant continu. Les lignes du champ magn´
etique cr´
e´
e par ce courant sont repr´
esent´
ees `
a la
figure 4, pour une position du rotor `
a un instant donn´
e. Dans cette figure, l’enroulement d’excitation
est repr´
esent´
e symboliquement par une seule spire.
stator
axe de l’enroulement
rotor
d’excitation
FIGURE 4 – lignes du champ magn´
etique cr´
e´
e par un courant continu Ifparcourant l’enroulement
d’excitation
1.3 Interaction entre champs et conversion ´
electrom´
ecanique
Une machine synchrone est caract´
eris´
ee par le fait qu’en r´
egime ´
etabli le rotor tourne `
a la mˆ
eme
vitesse angulaire que le champ produit par le stator. Cette vitesse est appel´
ee vitesse de synchro-
nisme. En cons´
equence, les champs statorique et rotorique sont fixes l’un par rapport `
a l’autre et
tournent tous deux `
a la vitesse de synchronisme.
Ces deux champs tendent `
a s’aligner `
a la fac¸on de deux aimants attir´
es l’un par l’autre. Si l’on
cherche `
a les ´
ecarter, un couple de rappel apparaˆ
ıt et s’y oppose. Ce couple `
a l’origine de la conver-
sion d’´
energie m´
ecanique en ´
energie ´
electrique et inversement.
Une analogie m´
ecanique est propos´
ee `
a la figure 5, o`
u les deux cercles en mouvement `
a la vitesse
angulaire ωcorrespondent aux champs rotorique et statorique, respectivement, et sont reli´
es par un
ressort exerc¸ant une force proportionnelle `
a son ´
elongation. Les deux situations repr´
esent´
ees sont
les suivantes :
•la figure 5.a se rapporte `
a un g´
en´
erateur synchrone. La turbine entraˆ
ıne le rotor en lui appliquant
un couple m´
ecanique Tmdans le sens de la rotation. Ceci tend le ressort qui applique au rotor
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%