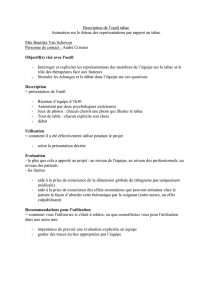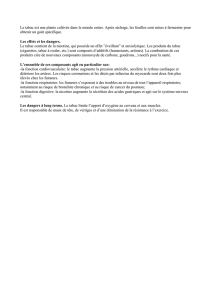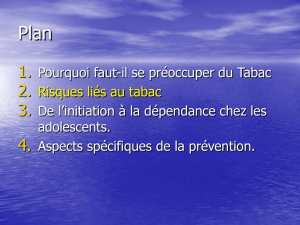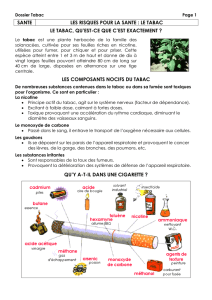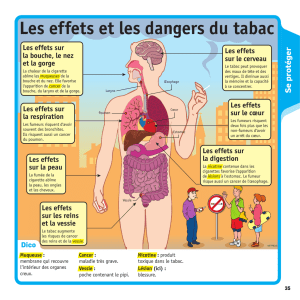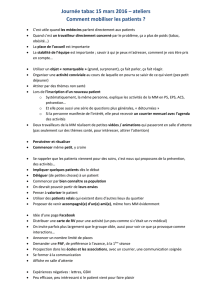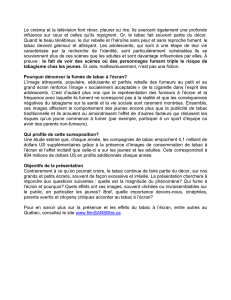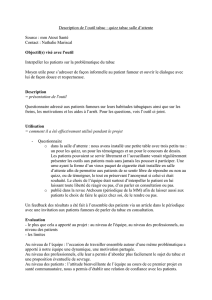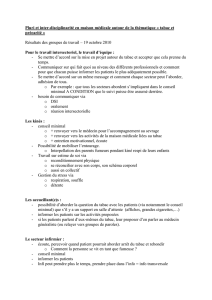ALCOOL ET AUTRES DÉPENDANCES

ALCOOL ET
AUTRES
DÉPENDANCES
L’usage concomitant d’alcool et d’autres substances psychotropes (tabac,
haschich, héroïne et autres produits illicites, médicaments détournés de leur
indication thérapeutique) est fréquent. Cette association est observée soit sur
un mode contrôlé, sans effets nocif ni dépendance (co-consommation), soit
sur le mode de dépendances multiples (co-dépendances), soit sur un mode
mixte (par exemple, dépendance à la nicotine et consommation d’alcool sans
mésusage, ou dépendance à l’alcool avec usage contrôlé de haschich).
En cas d’arrêt de la consommation d’un produit avec dépendance,
l’usage d’un autre produit est fréquent avec, souvent, apparition rapide d’une
nouvelle dépendance. Ainsi, la recrudescence de la consommation de tabac au
cours et au décours d’un sevrage de l’alcool ; un mésusage de l’alcool, avec
possible alcoolodépendance en cas d’arrêt de l’usage de l’héroïne sont fré-
quemment observés.
En pratique, le médecin qui a repéré un mésusage de l’alcool doit
faire préciser l’éventuel usage d’autres substances psychotropes.
85

Tabac
왎
Données épidémiologiques
Dans la population générale, en 1999, une enquête téléphonique a trouvé un
lien fort entre consommation d’alcool et consommation de tabac : les
consommateurs d’alcool réguliers, âgés de 20 à 75 ans, fument plus que les
autres fumeurs. Les consommateurs réguliers d’alcool (quotidiens ou hebdo-
madaires), âgés de 15 à 19 ans, sont deux fois plus souvent des fumeurs régu-
liers de tabac que les consommateurs d’alcool occasionnels. Les non-usagers
d’alcool fument beaucoup moins souvent que les usagers, tous modes
confondus *.
Dans la clientèle des médecins généralistes, une enquête, réalisée en
France en 2000, auprès de 1 840 généralistes libéraux a intéressé
50 000 patients de 16 ans et plus. Parmi ces patients, ceux qui sont repérés
comme alcoolodépendants sont trois fois plus nombreux à fumer que ceux
qui ont un usage « social » de l’alcool *.
Des alcoologues ont étudié chez leurs patients la relation entre
alcoolodépendance et usage du tabac. Une relation statistiquement très forte
a été trouvée entre le degré d’alcoolodépendance et le nombre de cigarettes
fumées dans la journée d’une part, et le degré de dépendance vis-à-vis de la
nicotine d’autre part *.
왎
En pratique
Faute d’essais cliniques randomisés, on ne peut que donner un avis d’experts.
Tout fumeur est considéré comme dépendant à la nicotine (ou à haut
risque de le devenir). De ce fait, l’OMS, l’Anaes et le livre d’enseignement de
la médecine générale recommandent de repérer les usagers de tabac, de les
avertir des risques encourus, de leur conseiller l’arrêt du tabac et, si besoin, de
les aider *. Que proposer en cas d’un mésusage d’alcool associé ?
Pour les fumeurs ayant une consommation d’alcool à risque, aucune
étude, aucune recommandation ne justifie ni ne récuse un conseil de consom-
mation en dessous du seuil de dangerosité.
ABORD CLINIQUE DES MALADES DE L’ALCOOL EN MÉDECINE GÉNÉRALE
86

Pour les fumeurs ayant une consommation d’alcool nocive, il est rai-
sonnable d’attirer l’attention des patients, en priorité, sur le produit immédia-
tement nocif.
Pour les fumeurs ayant une alcoolodépendance concomitante, la
priorité a longtemps été donnée à la prise en charge de la seule alcoolodépen-
dance (cf. p. 58). On sait maintenant que la prise en charge immédiate des
deux dépendances (préparation à la décision selon le schéma de Proschaka
(p. 59), arrêt des consommations et maintien prolongé du non-usage des deux
produits) est réalisable, acceptable par certains patients. Leur nombre et leurs
caractéristiques ne sont pas actuellement connus. Il est conseillé de faire pré-
ciser les souhaits, les appréhensions du patient et de les prendre en compte
pour le choix thérapeutique, cela parfois à l’occasion de consultations succes-
sives. Lorsque le patient souhaite, dans un premier temps, ne traiter qu’une
dépendance, le médecin mettra en avant celle qui est la plus nocive. Ainsi, on
donnerait la priorité au tabac chez un patient ayant une maladie cardiovascu-
laire ou broncho-pulmonaire ; à l’alcool chez un patient ayant une maladie
hépatique ou neurologique. Médecin et malade peuvent être confrontés à des
situations complexes : par exemple tel malade chez lequel l’état somatique
désigne le tabac, et les difficultés relationnelles (famille, travail, justice)
désigne l’alcool comme prioritaire. Raison de plus pour redire au patient que
le double sevrage est réalisable.
Souvent, les patients avec une double dépendance consultent avant
la survenue de maladie somatique qui orienterait le choix prioritaire d’un
sevrage. Si le patient ne se sent pas capable d’arrêter les deux drogues, laquelle
lui conseiller d’arrêter en premier ? Nous privilégions le sevrage de l’alcool,
immédiatement plus dangereux (accidents, problèmes sociaux, familiaux,
violence…). De plus, les effets bénéfiques en sont très rapidement perçus par
le malade, l’entourage et le médecin.
En cas de co-dépendance alcool et tabac :
– le traitement simultané des deux dépendances est possible ;
– si le patient est réticent pour ce traitement simultané, les
efforts se portent sur la dépendance la plus immédiatement
dangereuse ;
– en absence d’un danger immédiat (somatique, relationnel,
social…), nous proposons de débuter par l’alcool.
ALCOOL ET AUTRES DÉPENDANCES
87

Héroïne
L’usage de drogues illicites, en particulier de l’héroïne, varie beaucoup avec
l’âge (s’observant surtout avant 30 ans) et selon les zones géographiques
(maxima en région parisienne, sur la Côte d’Azur, dans les grandes villes). La
relation avec un patient usant de drogues illicites est difficile *. Certains
médecins généralistes, du fait d’une clientèle particulière et d’un intérêt per-
sonnel, ont une bonne expérience clinique de ce difficile problème. Les autres
se sentent souvent démunis face à ces patients. Ce peut être des patients habi-
tuellement pris en charge par un centre spécialisé de soins en toxicologie
(CSST) qui consultent pour une maladie intercurrente, ou qui, pour des ques-
tions d’horaires, ne peuvent ou ne souhaitent plus y être suivi.
L’usage concomitant ou successif d’héroïne et d’alcool cumule les
risques somatiques (portage chronique de virus : sida, hépatite B, hépatite C,
et nocivité somatique de l’alcool) et les difficultés relationnelles et sociales.
Aucun essai randomisé ne permet de recommander formellement telle ou
telle stratégie. Le médecin évalue le mode de consommation de l’héroïne et
l’importance de la dépendance. Si la voie intraveineuse est utilisée, elle
désigne l’héroïne comme toxique le plus dangereux. Dans le cas contraire, la
décision est issue de la concertation entre le patient et le médecin ou, idéale-
ment, le fruit d’une décision partagée entre le malade, les membres de
l’équipe du CSST et le médecin généraliste.
– En cas d’utilisation associée d’une drogue illicite par voie vei-
neuse, celle-ci est la première préoccupation des soignants.
– Dans ce cas, être très attentif au risque de substitution par l’al-
cool et de survenue rapide d’une alcoolodépendance.
ABORD CLINIQUE DES MALADES DE L’ALCOOL EN MÉDECINE GÉNÉRALE
88
1
/
4
100%