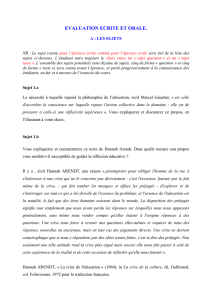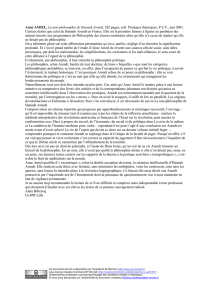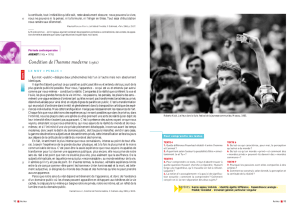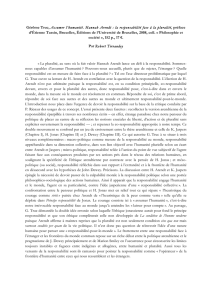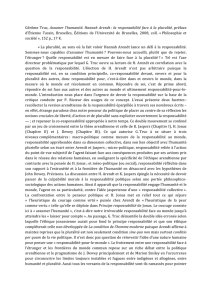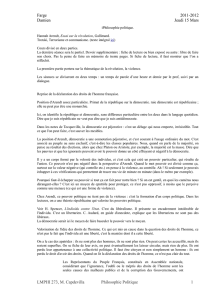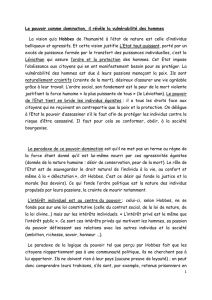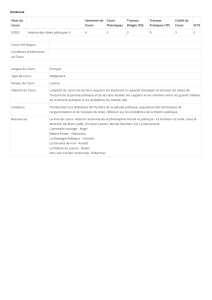Hannah Arendt lectrice de Montesquieu

Hannah Arendt lectrice
de Montesquieu
En notre matière le proverbe est aussi juste que fin: «dans l’arithmé-
tique politique, deux et deux ne font pas toujours quatre»
H a m i l t o n,Le Fédéraliste, n°, p., TM.
Il peut paraître singulier qu’un auteur tel que Montesquieu accompagne
une pensée politique essentiellement préoccupée des phénomènes les plus
contemporains, pensés comme irréductiblement nouveaux et inédits.
Pourtant force est de constater que Montesquieu figure dans toutes les
œuvres d’Arendt, des Origines du totalitarisme jusqu’au dernier chapitre
qu’elle put rédiger de La Vie de l’esprit.
Certes, l’on ne saurait attendre d’Arendt une lecture érudite et méticu-
leuse, soucieuse des articulations internes de telle ou telle œuvre, respec-
tueuse de leur littéralité et de leurs visées propres. Quelle que soit la très
réelle érudition d’Arendt à l’égard d’un certain nombre d’auteurs (et sa très
réelle désinvolture envers bien d’autres), sa lecture consiste toujours à
s’emparer de tel ou tel, à le retranscrire dans son propre lexique et à l’utili-
ser dans sa propre problématique, accentuant ainsi des effets de contresens
parfois plus apparents que réels.
Cependant, Montesquieu apparaît toujours en des points névralgiques
de la pensée arendtienne, et toujours à la fois comme témoin et comme
soutien de ce qu’elle-même veut énoncer;quand il s’agit de présenter et de
— —
. TM signifie ici traduction modifiée, ce sera toujours le cas pour Sur la révolution. Le
Fédéraliste (noté ici FP), Jay, Hamilton, Madison, Economica, .

justifier le concept de totalitarisme, ou encore sa conception du pouvoir et
de la loi, et donc de la liberté;de récuser la pertinence de la notion d’obéis-
sance dans les domaines politiques et moraux;d’expliquer ce qu’il en est de
la fondation et du «théologico-politique»; et parfois de justifier sa propre
méthode.
C’est que Montesquieu est rangé par Arendt dans la catégorie des «pen-
seurs politiques», expressément distingués des «philosophes politiques».
Parmi ceux traité [dans ce cours] […] deux sortes:les «p h i l o s o p h e s» et les écrivains. Parmi ces der-
niers Machiavel, Montesquieu, Tocqueville; ils écrivent à partir d’expériences politiques et en rai-
son de [for the sake of] la politique. Ils écrivent, comme Machiavel, parce qu’ils ont été exilés de la
scène politique […] Ils ne demandent jamais: quelle est la fin de la politique, quelle est la fin du
gouvernement, car ils prennent comme allant de soi que la vie politique est la vie la meilleure. Elle
n’a pas de «fin» , de but, qui soit plus haut qu’elle-même. Les autres sont totalement diffé r e n t s;i l s
écrivent du dehors et ils veulent imposer des critères non politiques à la politique […].
Si Arendt reconnaît le caractère simplificateur de la distinction, qui ne
saurait s’appliquer par exemple, ni à Hobbes, ni à Locke, cependant «je les
ai rangés parmi les philosophes parce qu’eux aussi raisonnent hors de
l’expérience et appliquent des critères dont l’origine n’est pas politique».
Arendt ne parle ici que des écrivains politiques «modernes»,et la séquence
devrait être complétée par des auteurs tels que Thucydide (et Hérodote) et
Cicéron, et peut-être Burke. Cependant, la triade Machiavel,
Montesquieu, Tocqueville, joue un rôle particulièrement important chez
notre auteur (et littéralement et implicitement) dans la mesure même où la
compréhension de la modernité, et d’une «science politique nouvelle» qui
puisse faire pièce à toute «philosophie de l’histoire »,est pour elle un enjeu
crucial. On peut encore remarquer que si Machiavel et Tocqueville,
constamment sollicités et loués, sont parfois explicitement critiqués, il
n’en va pas de même (du moins à ma connaissance) pour Montesquieu.
Certes, si Montesquieu avait un rival ici (et un rival complice), ce serait
Machiavel; pour eux comme pour Arendt, il va de soi que les Romains
représentent «le peuple le plus politique». Mais il semble que
Montesquieu jouisse aux yeux d’Arendt, d’un prestige sans égal.
R E V U E M O N T E S Q U I E U N°
— —
.Distinction que l’on peut retrouver chez Montesquieu lui-même, se disant «écrivain
politique».
.From Machiavelli to Marx, cours à l’université Cornell, automne , tapuscrit
inédit de la bibliothèque du Congrès, box , cité ici MM, p. (la pagination est
celle des manuscrits arendtiens). On retrouve ici la distinction arendtienne entre le «en
vue de» (in order to) qui appartient à la sphère de la fabrication et le «en raison de»for the
sake of appartenant à la sphère de la signification et, en un sens, de l’action.
.MM, p..
.Contrairement à deux erreurs connexes, souvent répétées;Arendt aurait pour
modèle la polis et hériterait d’Aristote.

Montesquieu est donc une pièce majeure du dispositif arendtien consis-
tant à questionner sans fin la possibilité même d’une philosophie poli-
tique, question qui organise toute une partie de son œuvre des Origines à
La Vie de l’esprit. Car on ne sait, in fine, si l’expression «philosophie poli-
tique»n’est qu’un oxymore ou si l’impossibilité n’est que de factoet non de
jure (à la fin de sa vie Arendt cherche une authentique philosophie poli-
tique chez Kant, là où, de son propre aveu, «elle n’existe littéralement
pas»). Son prestige inégalé tient peut-être à trois points. D’une part à ce
que sa réception est en partie médiée chez Arendt par les fédéralistes,
d’autre part grâce à une conception de la loi absolument originale, enfin à
la possibilité de questionner ce qu’il en est des mores, des mœurs, de la
morale, même si lui-même ne permet pas, selon Arendt, d’engager le ques-
tionnement plus avant.
Car il est deux passages qu’Arendt se plaît à citer:
L’homme, cet être flexible, se pliant, dans la société, aux pensées et aux impressions des autres, est
également capable de connaître sa propre nature lorsqu’on la lui montre, et d’en perdre jusqu’au
sentiment lorsqu’on la lui dérobe […].
La plupart des peuples d’Europe sont encore gouvernés par les mœurs. Mais si par un long abus
du pouvoir, si par une grande conquête, le despotisme s’établissait à un certain point, il n’y aurait
pas de mœurs ni de climat qui tinssent; et, dans cette belle partie du monde, la nature humaine
souffrirait, au moins pour un temps, les insultes qu’on lui fait dans les trois autres.
Or, des suites du procès Eichmann à LaVie de l’esprit incluse, Arendt se
préoccupe essentiellement de morale (c’est même cela, sans doute, le
contenu du «transpolitique» qu’elle entend traiter et qu’on interprète sou-
vent comme retour à la philosophie). En fait, tout se passe comme si elle
redécouvrait, derrière la question strictement politique des conditions
d’apparition du «totalitarisme», les questions morales qu’elle y avait déce-
lées. «[…] j’ai le sentiment que ces questions morales ont été laissés en
sommeil car elles étaient cachées par quelque chose dont il était bien sûr
beaucoup plus difficile de parler et presque impossible de venir à bout –
l’horreur elle-même dans sa monstrueuse nudité».«Le nouveau régime ne
nous posait rien de plus qu’un problème politique très complexe […]» et
non pas encore des questions morales. Ainsi les juges du procès Eichmann,
quand il s’agissait de la capacité à juger de la situation et du caractère cri-
minel du régime, «n’ont rien signifié de plus que:un tel sentiment pour de
telles choses, nous avait été inculqué depuis de si nombreux siècles qu’il ne
pouvait si soudainement se perdre. Et ceci, je pense, est très douteux».En
effet:
A N N E A M I E L
— —
.L’Esprit des Lois(cité ici EL), Paris, Gallimard, La Pléiade, t. ,, respectivement
Préface, p. et VIII, , p..

Ce fut comme si la moralité, au moment même de son total effondrement dans une vieille nation
hautement civilisée, s’était révélée dans son sens originaire, un jeu de mores, d’us et coutumes,
que l’on peut échanger contre un autre jeu sans plus de problème que si l’on changeait les
manières de table d’un peuple.
Or, de ce phénomène, ajoute Arendt, «[…] je pourrais ajouter un
nombre étonnant de citations qui renverraient au moins jusqu’au troi-
sième tiers du XVIIIesiècle. Mais ce qui nous importe, quoi qu’il en soit,
c’est que nous n’avons plus affaire à des prémonitions mais à des faits».
Montesquieu permet donc de penser politiquement, de penser en particu-
lier l’émergence d’un régime nouveau;il permet de saisir que les mœurs
sont en jeu, et du même coup, le statut même de la nature humaine, ou de
sa propre compréhension. Mais, dans la mesure où la question de
l’effondrement de la moralité, ou de la variabilité des mores, renvoie au
problème du jugement (plus exactement des rapports entre jugement et
pensée), et surtout, dans la mesure où le jugement ne peut être alors qu’un
jugement réfléchissant (aucun critère valide ne permettant un jugement
déterminant, bien à l’inverse), il ne peut plus être d’aucun secours. Si l’on
peut dire, il permet ainsi d’indiquer clairement un enjeu qu’il ne peut per-
mettre de thématiser et d’éclaircir.
La typologie des gouvernements
Le concept de totalitarisme (souveraineté, action)
La première utilisation massive de Montesquieu par Arendt se situe dans le
dernier chapitre actuel des Origines du totalitarisme «Idéologie et terreur»
et les conférences qui l’ont préparé et accompagné.Or l’on sait moins que
la première édition des Origines se terminait par un simple chapitre de
remarques finales, parfois décousues (ou, si l’on ose dire, rétrospective-
ment programmatiques). Arendt a donc eu besoin, pour justifier le
concept de totalitarisme, de la classification des régimes de Montesquieu.
Mais pourquoi en a-t-elle eu précisément besoin?C’est qu’il en va de bien
plus que de la simple question des régimes, il en va de la question des prin-
R E V U E M O N T E S Q U I E U N°
— —
. Ces citations sont extraites de deux textes corrélés: Some questions of moral philoso -
phy, oct. ,Social Research, ,⁄ (cité ici SQ) et Personal responsability under dicta -
torship, (cité ici PR), Bibliothèque du Congrès, box , partiellement traduit dans
Penser l’événement, Belin, (cité ici PE). On cite ici SQ, p., et PR, p.,,.
.En particulier Compréhension et politique, repris dans La Nature du totalitarisme,
Payot, (cité ici CP) et La Nature du totalitarisme (cité ici NT) repris dans le même
volume, et la réponse à Voegelin (Rejoinder to E. Voegelin’s Review of The Origins of
Totalitarianism, Review of Politics, janvier).

cipes, de la nature de la loi, de la prétendue immutabilité de la nature
humaine et, finalement, de ce que signifie comprendre en politique.
Dès la rédaction des Origines, Arendt voit naître un questionnement
qui va, comme nous l’avons souligné, sous-tendre une partie de son œuvre.
Je soupçonne que la philosophie n’est pas entièrement innocente de ce bric-à-brac. Non pas bien
sûr au sens où Hitler aurait à voir quoi que ce soit avec Platon (la raison primordiale pour laquelle
je me suis donnée tant de mal pour isoler les éléments des gouvernements totalitaires était de
dégager la tradition occidentale de Platon jusqu’à Nietzsche inclus de toute suspicion). Mais plu-
tôt, à l’inverse, au sens où la philosophie occidentale n’a jamais eu un concept clair de ce qui
constitue le politique, et ne pouvait pas en avoir, car, par nécessité, elle parle de l’homme au sin-
gulier et n’a affaire avec le fait de la pluralité que tangentiellement.
Le choix de Montesquieu est donc d’abord à la fois un choix dirigé
contre la philosophie et un choix méthodologique. Il participe du refus
arendtien de toute philosophie de l’histoire, et du type d’interrogation que
cela engage. Il s’agit pour Arendt de passer d’une description et d’une ana-
lyse historiques des régimes inédits que sont le nazisme et le stalinisme à ce
que celles-ci ne sauraient en aucun cas fournir:la compréhension de la
nature du totalitarisme.La compréhension, expressément distinguée de
la connaissance, refuse de se départir de l’intuition initiale, que permet
aussi de repérer le vocabulaire et le discours communs;un phénomène
inédit s’est produit, une singularité, dont il faut rendre raison, dont il faut
comprendre la signification. Comprendre comment des éléments préexis-
tants ont pu cristalliser en une occurrence singulière qui permet en retour
d’éclairer ses propres origines,et comprendre le sens de cette cristallisa-
tion sont donc les tâches qu’Arendt s’assigne. Or cette conception (que
l’on ne peut ici développer pour elle-même) engage le refus de toute pen-
sée de l’histoire comme processus, le refus de l’explication des régimes par
la singularité irréductible des histoires nationales, et le refus de l’assimila-
A N N E A M I E L
— —
.Lettre à Jaspers, n°, du mars – p. TM; voir aussi la lettre du
décembre ,Correspondance Hannah Arendt, Karl Jaspers, Payot, .
. «La description historique et l’analyse politique ne pourront jamais démontrer
l’existence d’une nature ou d’une essence du gouvernement totalitaire sous prétexte qu’il
y a une nature du gouvernement monarchique, républicain, tyrannique ou despotique»
(CP, p.), de même en NT, p.-. «[…] cette question relève à strictement parler des
sciences politiques qui, pour peu qu’elles se comprennent elles-mêmes, sont les véritables
détenteurs des clefs qui permettent d’accéder aux problèmes et aux énigmes des philoso-
phies de l’histoire» (NT, p.).
. Quand Arendt déclare: «C’est la lumière produite par l’événement lui-même qui
nous permet d’en discerner les éléments concrets (à partir d’un nombre infini de possibi-
lités abstraites), et c’est encore cet éclairage qui doit nous guider à rebours dans le passé
toujours obscur et équivoque de ces composantes» (NT, p.), on peut y lire une allusion
très discrète aux idéaltypes de Weber, qu’Arendt refuse de mentionner pour des raisons
que l’on verra; on peut aussi y voir le souci de rendre raison d’une totalité concrète en un
sens irréductible à ses composantes, ou encore, à ses origines.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%