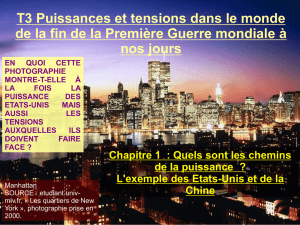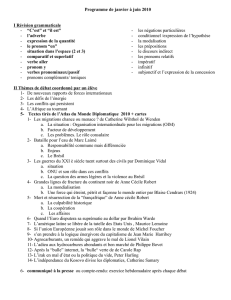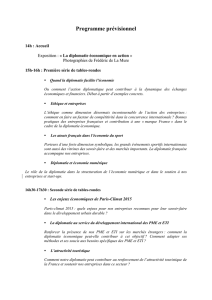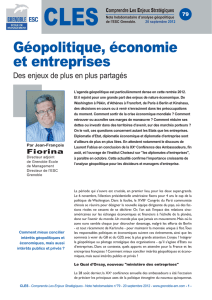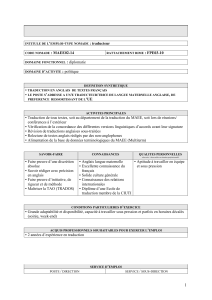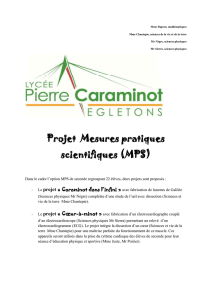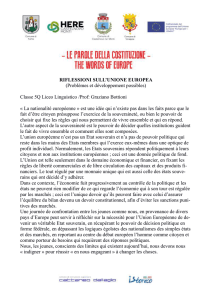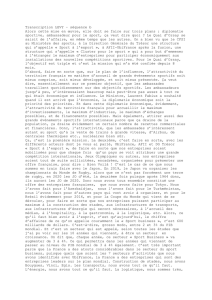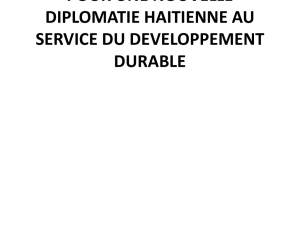En savoir plus sur le numéro 63 de Géoéconomie

revue
JEU VIDÉO, UNE ÉPOPÉE
INDUSTRIELLE
Géoéconomie
REVUE TRIMESTRIELLE - AUTOMNE HIVER 2012
Géoéconomie
JEU VIDÉO, UNE ÉPOPÉE INDUSTRIELL
DOSSIER
LES RÉVOLUTIONS DU JEU VIDÉO
Le marché mondial des jeux vidéo : vers une nouvelle phase de croissance
Laurent MICHAUD
Une benjamine devenue ainée : structures et mutations de l’industrie du jeu vidéo
Philippe CHANTEPIE
La France dans le marché mondial du jeu vidéo
Nicolas GAUME
Jeux vidéos et publicité : deux univers incompatibles ?
Antoine DUBUQUOY
Les enjeux d’une régulation juridique du jeu vidéo en France
Patrice MARTIN LALANDE
Les dispositions françaises en faveur du jeu vidéo
Valérie BOURGOIN
VARIA
La diplomatie économique marocaine en Afrique subsaharienne : réalités et enjeux
Amine DAFIR
Fonds souverains : comment repenser le capitalisme d’État ?
Yves JÉGOUREL
Un tour du monde géopolitique ou géoéconomique ?
Eugène BERG
Lectures
Géoéconomie
63 - Automne hiver 2012
20 euros
63 63

ÉDITORIAL
Didier LUCAS et Alexandre SHOEPFER
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont
parmi les instruments les plus décisifs du processus de mondialisation,
car en fluidifiant les frontières territoriales, elles incarnent son ambition
universaliste. La naissance du concept d’espace virtuel redéfinit les
relations entre puissances en les déplaçant dans une dimension nouvelle,
qui facilite la communication tout en lui donnant un accent d’irréalité. Si
la géoéconomie veut donc analyser les stratégies de puissance des États,
elle est amenée à prendre en compte ce nouveau terrain d’échanges et
de compétitions. Le jeu vidéo est une des expressions de cet univers, en
tant que lieu de croisement entre créativité et technologie, industrie et
culture.
En un peu plus de 50 ans, l’industrie du jeu vidéo, dernière-née des
industries culturelles et de communication, est devenue une référence sur
le marché des services numériques et un acteur majeur de l’économie de
la culture. Incarnant les tendances anthropologiques et sociales de notre
époque, son entrée dans le marché international des industries culturelles
a bouleversé les structures concurrentielles traditionnelles et inauguré
des nouvelles stratégies compétitives fondées sur l’alliance entre la
compétence technique et la créativité.
S’il a fallu des décennies avant que l’équilibre entre les différents acteurs
économiques se consolide, cette industrie connait désormais un véritable
succès, en proposant des produits allant même au delà des différences
générationnelles et de genre. Toutefois, les modèles économiques du
jeu vidéo poursuivent leur évolution, passant d’un type de distribution
essentiellement physique en magasins à une distribution dématérialisée,
ou d’un mode de jeu de salons ou d’arcade à un mode de jeu nomade à
travers des nouveaux supports de diffusion comme les tablettes et les
smartphones. Ce marché fortement dynamique et en constante évolution
s’impose donc comme un produit à forte valeur ajoutée pour les quelques
pays qui ont réussi à s’y imposer. Bien que la France soit mondialement
reconnue comme un des pays les plus créatifs en matière de jeux vidéo,
son déclin régulier sur le marché européen et mondial peut s’apparenter à
une menace pour l’un des fleurons de notre industrie culturelle.
Quels sont les enjeux et les tendances actuelles et à venir de ce marché ?
Comment la France se positionne-t-elle et saura-t-elle répondre aux
exigences de ce marché en pleine transition ?
Pour répondre à ces questions, la rédaction de Géoéconomie a sollicité
le meilleur expert de ce secteur d’activité en France pour coordonner ce
dossier spécial : Laurent Michaud, responsable du pôle « Loisirs numériques
et électronique grand public » à l’IDATE qui nous gratifie également de
l’article de cadrage de ce dossier sur les tendances actuelles et à venir de
cette industrie. Ce dossier unique en son genre a également reçu le concour
de Philippe Chantepie du ministère de la Culture et de la Communication,
pour nous rappeler la genèse de cette réussite industrielle, ainsi que celui
de Nicolas Gaume, président du Syndicat national du jeu vidéo, pour évoquer
la place et les opportunités de la France sur ce marché. Antoine Dubuquoy
nous présente quant à lui les enjeux et les perspectives de nouveaux
modèles économiques pour cette industrie avec un regard particulier sur
la place et l’avenir de la publicité dans les jeux vidéo. Face à la montée
en puissance de cette industrie et des enjeux qu’elle représente pour
la compétitivité de notre économie, un entretien avec le Député Patrice
Martin-Lalande (auteur en 2011 d’un rapport sur le régime juridique du jeu
vidéo) et un article de Valérie Bourgoin du Centre national du cinéma et de
l’image animée (CNC) nous permettent de mieux comprendre la position
et la stratégie de la France pour protéger et contribuer au développement
de ce secteur où la concurrence internationale fait rage.
Enfin, pour compléter ce numéro, nous vous proposons un article
d’Amine Dafir de l’université Mohammed V Souissi de Rabat sur la
diplomatie économique marocaine en Afrique subsaharienne, ainsi qu’un
article d’Yves Jégourel de l’université Bordeaux IV sur les fonds souverains
et les solutions pour repenser le capitalisme d’État.
Bonne lecture et bonne année 2013 !

DOSSIER
JEU VIDÉO, UNE ÉPOPÉE INDUSTRIELLE
Le marché mondial des jeux vidéos : vers une nouvelle phase de croissance
Laurent MICHAUD
Une benjamine devenue aînée : structures et mutations
de l’industrie du jeu vidéo
Philippe CHANTEPIE
La France dans le marché mondial du jeu vidéo
Nicolas GAUME
Jeu vidéo et publicité deux univers incompatibles ?
Antoine DUBUQUOY
Enjeux et perspectives d’une régulation juridique du
marché des jeux vidéo en France
Patrice MARTIN-LALLANDE
Les dispostions françaises en faveur du jeu vidéo
Valérie BOURGOIN
VARIA
La diplomatie économique marocaine en Afrique subsaharrienne :
réalités et enjeux
Amine DAFIR
Fonds souverains : comment repenser le capitalisme d’État ?
Yves JÉGOUREL
Un tour du monde géopolitique ou géoéconomique ?
Eugène BERG
Lectures
SOMMAIRE

La France dans le marché mondial du jeu vidéo
De la télévision et téléphone fixe à l’internet et au mobile, notre rapport au
temps et aux autres n’est plus le même. Notre façon de nous divertir a été
marquée par l’essor considérable de la pratique du jeu vidéo. D’un marché
balbutiant il y a quarante ans, le jeu vidéo représente cette année en France le
premier marché du divertissement pas son chiffre d’affaires.La France, pays
de consommation indéniable, est également un pays de production. Quel est sa
place dans la compétition mondiale ? Quelles aventures entrepreneuriales ont
su y prospérer ? Quels sont les leviers et freins propres à notre pays?
Nicolas GAUME
Jeu vidéo et publicité, deux univers incompatibles?
L’intégration des marques dans les univers virtuels des jeux vidéo est un thème
qui revient régulièrement hanter les rêves des experts média. Pour autant, peu
de success stories permettent de valider définitivement l’entrée du jeu vidéo
dans la sphère des médias. Et si la monétisation des audiences captives des
jeux vidéo n’était qu’une illusion? Et s’il fallait considérer la problématique
sous un autre angle? Le jeu ne serait-il finalement qu’un prétexte pour diver-
tir le consommateur et attirer son attention sur une marque? Advergame, in-
game, social game... État des lieux.
Antoine DUBUQUOY
Enjeux et perspectives d’une régulation juridique du
marché des jeux vidéo en France
Certes, en France, le jeu vidéo est reconnu comme étant une « œuvre de l’es-
prit » depuis 25 ans et, à ce titre, protégé par le droit d’auteur. Mais la qualifi-
cation juridique du jeu vidéo, que ce soit selon sa nature (œuvre logicielle, base
de données, œuvre audiovisuelle ou œuvre multimédia) ou selon ses conditions
d’élaboration (œuvre collective ou œuvre de collaboration) reste ballottée entre
textes lacunaires, jurisprudences contradictoires et doctrines divergentes.
Entretien avec Patrice MARTIN-LALANDE
Dossier
Le marché mondial des jeux vidéo : vers une nouvelle
phase de croissance
En 2012, le marché mondial du jeu vidéo (équipements & logiciels) s’élèvera à
53.3 milliards euros, contre 51.1 euros en 2011. Cette légère croissance entre
2010 et 2011 est imputable au dynamisme des segments de marché du jeu en
ligne et du jeu sur téléphone mobile, qui compense une baisse des revenus du
segment des jeux sur consoles de salon.À partir de 2012, le chiffre d’affaires
global du secteur devrait à nouveau enregistrer une croissance significative
(+5.2%) et une croissance à deux chiffres en 2013 et 2014, grâce à la commer-
cialisation des consoles de salon nouvelle génération.
Laurent MICHAUD
Une benjamine devenue aînée : structures et muta-
tions de l’industrie du jeu vidéo
Dernière-née des industries culturelles et de communication, l’industrie des
jeux vidéo, mondiale et numérique d’origine, a construit un écosystème éco-
nomique alliant les principes de l’économie de la culture et ceux de l’économie
numérique à travers des dynamiques concurrentielles porteuses de transfor-
mations régulières mais aussi d’une logique d’intégration puissante de l’aval
vers l’amont, entre industries des technologies de l’information et processus
créatifs.
Philippe CHANTEPIE

Présentation des dispositions françaises en faveur du
jeu vidéo : la stratégie de la France
Dans le domaine du jeu vidéo, l’action du CNC vise à soutenir la diversité de
la création, en accordant des aides à la conception ou à la production via des
aides sélectives et un dispositif de défiscalisation : le crédit d’impôt, complétés
par un soutien à la recherche et au développement, enjeu particulièrement
important pour le secteur. Il s’agit d’encourager les entreprises à développer
des créations originales qui trouveront leur place sur un marché en pleine mu-
tation.
Valérie BOURGOIN
Varia
La diplomatie économique marocaine en Afrique sub-
saharienne : réalités et enjeux
La diplomatie économique est de plus en plus associée à la stratégie globale de
développement, notamment dans les pays en voie de développement. À l’instar
de ces pays, le Maroc mise sur sa diplomatie économique pour réduire le
déficit structurel de sa balance commerciale et accompagner les investisseurs
marocains dans leur quête des marchés étrangers. Quelles sont les missions
actuelles de la diplomatie économique ? Tant au niveau bilatéral que régional
ainsi que quelques outils susceptibles de permettre une redynamisation de la
diplomatie économique marocaine dans un continent en transition.
Amine DAFIR
Fonds souverains : comment repenser le capitalisme
d’État ?
Désignés sous le terme générique de « fonds souverains », les véhicules d’in-
vestissement publics offrent une grande disparité, tant dans leurs stratégies
et objectifs financiers que dans leur fonctionnement institutionnel. Les consi-
dérer comme une classe d’investisseurs homogènes n’a, en conséquence,
pas de sens. L’importance de la question des ressources naturelles, rarement
définies comme stratégiques par les pays susceptibles d’accueillir des fonds
souverains, apparaît largement sous-estimée. Une vision précise des risques
géostratégiques que pourraient faire peser le développement de ces acteurs
publics impose d’éviter un tropisme excessif qui conduirait à ne pas accorder
suffisamment d’intérêt à la problématique des pays « tiers », fortement dotés
en ressources naturelles et objet de nombreux investissements des fonds ou
entreprises d’État.
Yves JÉGOUREL
Un tour du monde géopolitique ou géoéconomique?
Aujourd’hui, le terme géopolitique a envahi tous les champs du savoir et de
l’action. Il n’est guère d’événement, de quelque nature qu’il soit, en quelque
lieu que ce soit de notre « village planétaire » qui ne soit qualifié de « géopoli-
tique » ou n’ait des répercussions géopolitiques. Beau succès pour un terme
forgé en 1905 par le professeur de sciences politiques suédois Rudolf Kjellen,
comme « la science de l’État en tant qu’organisme géographique, tel qu’il se
manifeste dans l’espace ».
Eugène BERG
 6
6
1
/
6
100%