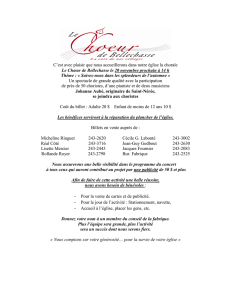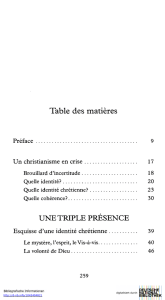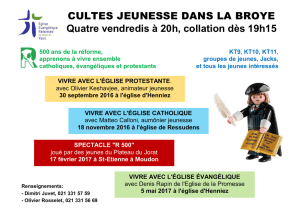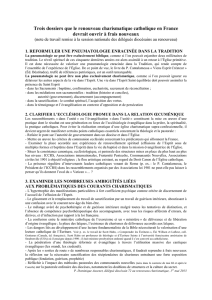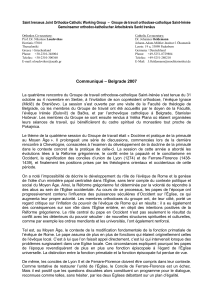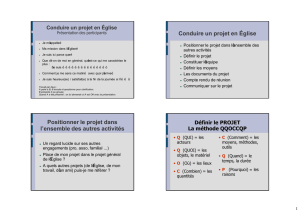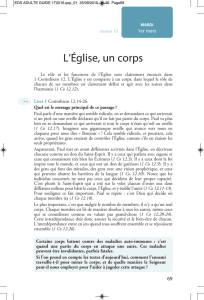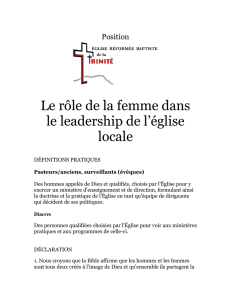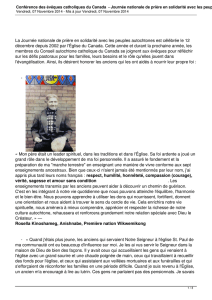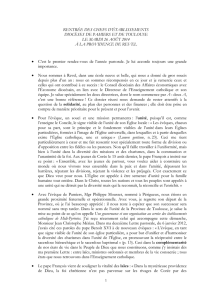Position de thèse - Université Paris

UNIVERSITÉ
PARIS-SORBONNE
École doctorale I :
Mondes anciens et médiévaux
INSTITUT
CATHOLIQUE
DE
PARIS
Theologicum, Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses
Cycle des Études du Doctorat
Thèse pour l’obtention du Doctorat conjoint
en histoire des religions et anthropologie religieuse (Paris-Sorbonne)
et en théologie (I.C.P.)
Présentée et soutenue par :
Amphilochios-Thomas MILTOS
le 20 mai 2017
COLLÉGIALITÉ CATHOLIQUE
ET SYNODALITÉ ORTHODOXE
Recherches sur l’ecclésiologie du Concile Vatican II, ses sources,
sa réception et son rôle dans le dialogue entre les Églises
Directeur de thèse pour Paris-Sorbonne : Professeur Jean-Marie SALAMITO
Directeur de thèse pour l’I.C.P. : Professeur Laurent VILLEMIN
Membres du jury :
Professeur Joseph FAMERÉE, Université catholique de Louvain (Belgique)
Professeur Alberto MELLONI, Université de Modena et Reggio Emilia (Italie)
Professeur Grigorios PAPATHOMAS, Université d’Athènes (Grèce)
Professeur Michel STAVROU, Institut de Théologie orthodoxe Saint-Serge, Paris

2
« La multitude qui ne se réduit pas à l’unité est confusion.
L’unité qui ne dépend pas de la multitude est tyrannie »
1
.
Cette étude porte sur un thème actuel du dialogue entre les Églises orthodoxe et
catholique, la synodalité. Il a été dit que si le XX
e
siècle est caractérisé comme « le siècle de
l’ecclésiologie », le XXI
e
pourrait être celui de la synodalité
2
. Cette remarque correspond
étonnamment à la vision du Pape François, exprimée plus récemment : « Le chemin de la
synodalité est justement le chemin que Dieu attend de l’Église au troisième millénaire »
3
. En
effet, le développement de l’ecclésiologie au cours du dernier siècle a permis, entre autres, de
mettre en relief l’importance de la synodalité, non seulement en rapport avec la structure
hiérarchique de l’Église (l’institution des conciles ou des synodes des évêques), mais aussi en
ce qui concerne l’Église elle-même. Dans ce sens, nous pouvons d’emblée définir la
synodalité (ou conciliarité), à la fois comme un principe de l’organisation de l’Église
(synodalité des évêques) et comme une caractéristique inhérente à la vie de l’Église ; pour
Jean Chrysostome le mot synode est synonyme du mot Église
4
.
L’intérêt pour la synodalité ne cesse de croître, semblant apte à éclairer les questions
ecclésiologiques d’aujourd’hui. Au niveau œcuménique, la plus épineuse de ces questions est
sans doute celle de la primauté du pape, qui demeure la pierre d’achoppement, en matière
d’ecclésiologie, pour le rapprochement entre les Églises catholique romaine et orthodoxe.
Ainsi, si la question de la primauté, ou encore celle de l’épiscopat, a fait couler beaucoup
d’encre, la synodalité, elle, est tout aussi importante, car c’est en elle que s’articulent les
questions de la primauté et de l’épiscopat.
Notre travail de Master de recherche sur le ministère épiscopal
5
nous a incité à
approfondir davantage les notions de primauté et de synodalité dans les ecclésiologies
catholique et orthodoxe, à travers leur conception respective du rôle de l’évêque. Afin
1
Blaise P
ASCAL
, Pensées, (604) Paris, Éd. du Seuil, 1962, p. 269.
2
C
HARKIANAKIS
Stylianos, « Synod and "Synodality" » dans Phronema, 23, 2008, p. 1: « Just as the 20
th
century
has rightfully been characterised as "the century of the Church", given that it was the century in which the
ecumenical movement was established and developed worldwide among "divided Christians", it would be a
blessing for the 21
th
century also soon to emerge and be named "the century of the SYNOD and
SYNODALITY" ».
3
P
APE
F
RANÇOIS
, « Le chemin de la synodalité est celui que Dieu attend de l’Église au troisième millénaire »,
Discours à l’occasion de la commémoration du 50
e
anniversaire de l’institution du synode des évêques, Rome, le
17 octobre 2015, DC, n
o
2521, 2016, p. 76.
4
J
EAN
C
HRYSOSTOME
, Explication in Ps 149, PG 55, p. 493. Le mot synode, σύνοδος, peut désigner chez les
Pères l’Église elle-même : voir
L
AMPE
Geoffrey W. Hugo, A Patristic Greek Lexicon, Oxford, Oxford University
Press, 1961, p. 1334-1335.
5
M
ILTOS
Amphilochios-Thomas, La notion de « personnalité corporative » et son application possible à
l’évêque : Recherches sur l’ecclésiologie de Jean Zizioulas et ses fondements patristiques, Master de recherche
en Histoire des faits culturels et religieux, Université de Paris-Sorbonne, et en Théologie dogmatique et
fondamentale, Institut catholique de Paris, 2013.

3
d’explorer ce vaste thème, la collégialité épiscopale, doctrine promulguée par le Concile
Vatican II, nous a paru être une porte d’entrée particulièrement intéressante. Cette doctrine,
qui semblait exprimer la réalité de la synodalité des évêques, fut critiquée par les théologiens
orthodoxes, dont l’analyse fut également partagée par des théologiens catholiques. Le sujet du
présent travail est d’explorer comment la critique de la collégialité épiscopale éclaire des
questions qui sont communes aux deux Églises et d’autres qui sont propres à chacune.
En effet, le problème de l’articulation entre l’évêque, la synodalité épiscopale et la
primauté, notamment au niveau de l’Église entière, n’est pas seulement une question du
dialogue bilatéral (catholique-orthodoxe) mais touche à des problèmes propres à chaque
Église. Nous pourrions dire – bien que de manière très caricaturale – que si les catholiques
peinent à vivre vraiment la collégialité épiscopale ou la synodalité au niveau régional (à
savoir entre le niveau du diocèse et de l’Église universelle), les orthodoxes de leur côté
peinent à se mettre d’accord sur l’exercice d’une primauté sur le plan universel.
Le problème ecclésiologique (de nature également œcuménique) qui a motivé cette
recherche est à la fois simple et complexe. En un mot, les ecclésiologies catholique et
orthodoxe ne comprennent pas la synodalité de la même manière. Tant les théologiens
orthodoxes que des théologiens catholiques
6
soulignent que la doctrine de la collégialité
épiscopale ne coïncide pas avec la synodalité orthodoxe. Ensuite, le problème est complexe
dans ses différentes formes. Au sein de l’Église catholique, on constate que la réception de la
doctrine de la collégialité était difficile, voire très problématique. La notion de la collégialité,
qui devait rapprocher les deux Églises, a été critiquée dès sa promulgation par les théologiens
orthodoxes. Le cinquantième anniversaire de la clôture du Concile Vatican II (1962-
1965) offre une bonne occasion d’évaluer sa doctrine sur l’épiscopat et sa réception, et peut-
être de revenir aux critiques orthodoxes. Ces dernières révèlent des questions que
l’ecclésiologie orthodoxe doit se poser sur sa conception de la synodalité et son rapport à la
primauté. Devant donc cette quête commune de deux ecclésiologies pour un équilibre
pertinent entre les évêques et le primat, notre recherche a tenté de répondre à la question
suivante : Quelle compréhension commune de la notion de synodalité épiscopale, entre
catholiques et orthodoxes, peut éclairer les différents problèmes autour de l’articulation entre
l’évêque, la synodalité et la primauté ?
Pour répondre à cette question, on pourrait considérer que les deux ecclésiologies sont
deux approches complémentaires. Certes, il faut avant tout souligner que nous admettons en
principe la fécondité d’une considération des deux ecclésiologies, occidentale et orientale,
6
Voir p. ex. « Tanto i non specialisti quanto gli specialisti sanno bene che al Vaticano II i dibattiti più vicini al
nostro argomento si cristallizzano intorno alla collegialità, realtà che differisce significativamente dalla
sinodalità » : L
EGRAND
H., « La sinodalità al Vaticano II e dopo il Vaticano II », p. 68 et D
E
H
ALLEUX
André,
« La collégialité dans l’Église ancienne » dans Revue théologique de Louvain, 24, 1993, p. 436.

4
comme complémentaires sur plusieurs points. Il est absolument vrai que chacune a mis des
accents différents, en partie en raison aussi de son contexte historique. Les traditions peuvent
incontestablement s’enrichir mutuellement et doivent impérativement œuvrer ensemble non
seulement pour leur réconciliation, mais aussi pour éclairer des questions théologiques
propres à chacune.
Néanmoins, il nous semble que, au sujet de la collégialité, l’hypothèse de la
complémentarité des deux approches n’apparaît pas opératoire afin d’arriver à une
compréhension commune. Sans exclure une convergence salutaire entre les deux
ecclésiologies, il nous paraît que pour atteindre un consensus sur la question de la synodalité
des évêques (et sur d’autres comme celle de la primauté), il ne faut pas partir de leur
complémentarité mais d’une tradition d’origine supposée commune, en éclaircissant les
fondements théologiques et les présupposés de chaque approche par rapport à cette tradition
d’origine. En même temps, pour ne pas rester uniquement au plan des idées théologiques, il
faut prendre en considération les réalités ecclésiales qui expriment en Orient et en Occident
cette tradition commune. Ces présupposés touchent principalement la conception de l’Église
locale, et de son rapport à l’Église entière, et celle du ministère épiscopal. Force est de
souligner qu’il ne suffit pas de signaler une certaine complémentarité des deux approches sans
avoir examiné leurs fondements théologiques.
Nous avons donc fait l’hypothèse qu’une compréhension commune doit se fonder non
pas sur une complémentarité a priori des deux approches, mais sur la reconnaissance
commune de la tradition originelle que partagent les deux ecclésiologies. Afin de vérifier
notre hypothèse, nous avons étudié si la collégialité est une manière légitime d’exprimer ce
qu’est la synodalité épiscopale dans la tradition commune. Pour cette raison, la doctrine de la
collégialité, et plus précisément ses fondements scripturaires, patristiques et dogmatiques,
constitue donc le domaine dans lequel nous posons notre question. En d’autres termes, notre
recherche s’interroge sur les présupposés ecclésiologiques ou les conditions indispensables à
une compréhension commune de l’articulation entre l’évêque, la synodalité et la primauté.
L’exploration de notre sujet nécessite une approche historique au moins à deux égards.
D’abord, la doctrine de la collégialité est un fruit du Concile Vatican II (1962-1965),
événement emblématique du renouveau théologique qui a marqué non seulement l’Église
catholique mais aussi l’œcuménisme. Il ne s’agit pas seulement de situer la doctrine dans
l’histoire des idées théologiques, mais surtout de retracer d’une manière synthétique son
évolution et ce que la théologie appelle « réception », durant les cinquante ans qui se sont
découlés depuis ce Concile. En même temps, nous suivrons, comme un autre fil historique, les
réactions des théologiens orthodoxes à la doctrine de Vatican II, qui traversent en partie la
même période.

5
Ensuite, faisant un saut historique considérable, nous laissons la théologie
contemporaine pour remonter aux premiers siècles chrétiens. Comme l’a évoqué le Pape
François, une telle réflexion commune qui porte sur la collégialité ou la synodalité ne peut
négliger « la manière dont l’Église était gouvernée dans les premiers siècles »
7
. De fait, si tant
l’ecclésiologie catholique que l’ecclésiologie orthodoxe se prétendent fidèles à la tradition du
premier millénaire de l’Église indivise, la collégialité nous impose encore davantage un tel
recours. D’une part, la doctrine du Concile Vatican II sur l’épiscopat est considérée comme le
fruit d’un « ressourcement » patristique, et d’autre part l’élément central des critiques
orthodoxes de la collégialité était l’absence de cohérence entre cette idée et la tradition
patristique. D’où surgit la nécessité d’une recherche qui serait fondée sur les sources
historiques et patristiques du premier millénaire de l’Église. En effet, c’est dans cette histoire
et cet héritage communs que nous rechercherons des réponses à la question fondamentale de
cette thèse.
D’après les résultats de cette recherche, nous pouvons soutenir que non seulement les
fondements étudiés éclairent les problèmes communs, mais qu’ils appellent de plus à une
révision tant de l’énoncé de la doctrine de la collégialité de l’Église catholique que de la
pratique synodale dans l’Église orthodoxe d’aujourd’hui.
La doctrine de la collégialité épiscopale est au fond un fruit de Vatican I. Nous avons
constaté que, d’une part, l’idée de la succession du collège des évêques à celui des apôtres
existait déjà à l’époque de Vatican I (dans le schéma de Kleutgen), et, d’autre part, que la
sacramentalité de l’épiscopat, si solennellement enseignée dans la Constitution sur l’Église de
Vatican II, Lumen gentium, n’a point déterminé la perception de la collégialité. C’est cette
dernière qui reste, selon nous, le fil rouge de la théologie de Lumen gentium sur l’épiscopat,
exposée dans le troisième chapitre. Ensuite, nous avons présenté les critiques de la réception
de cette doctrine par des théologiens catholiques, évaluations qui peuvent être ramenées à
l’observation d’une mise en pratique restreinte de la collégialité, qui n’a pas essentiellement
modifié le problème de la centralisation romaine ou de l’exercice monarchique de la primauté
papale.
Les critiques orthodoxes nous ont fourni le cahier des charges de notre recherche, dont
les axes étaient la collégialité et la succession apostoliques, l’importance fondamentale de
l’Église locale, la corrélation entre primauté et synodalité. Nous avons proposé une typologie
des arguments orthodoxes contre la collégialité, qui se regroupent autour de ces sujets et nous
avons particulièrement souligné la contribution du théologien orthodoxe J. Zizioulas. Ce
dernier a notamment mis en exergue le lien constitutif entre l’évêque et son Église, qui rend
7
P
APE
F
RANÇOIS
, « Entretien accordé aux revues jésuites » dans Études, octobre 2013, p. 18.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%