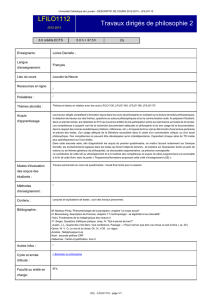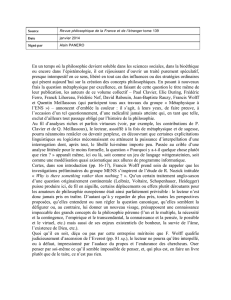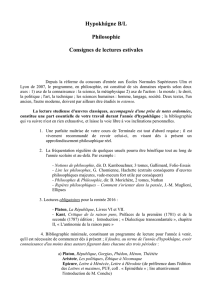ci-jointe - Ambassade de France au Japon

MASTER Erasmus mundus Europhilosophie
Mobilité à l’université de Hosei (Japon)
cf. http://www.europhilosophie.eu/mundus/spip.php?rubrique105
◆Aperçu
Tous les ans, 5 étudiants européens Erasmus Mundus peuvent bénéficier d’une bourse de la
Commission Européenne de 1700 euros pour un stage intensif d’étude de 1 mois à l’université de
Hosei au Japon.
Le stage intensif à Hosei donne lieu à une évaluation et est validé par l’obtention de 10 ECTS à valoir
auprès de l’université européenne dans laquelle l’étudiant séjourne ordinairement au moment du stage
dates de la mobilité : 22 mars-16 avril
période de la mobilité : Semestre 4 de la formation EuroPhilosophie
responsable de la mobilité à Hosei : Prof. Shin Abiko
responsable EuroPhilosophie de la mobilité à Hosei : Arnaud François
site web :
http://www.hosei.ac.jp/english/
L’université de Hosei réserve une chambre individuelle à chaque étudiant dans un foyer proche de
l’université
Elle offre une aide au logement à chaque étudiant Erasmus Mundus EuroPhilosophie
◆Mobilité en 2010
►L’offre de cours de mars-avril 2010 consiste dans 3 modules représentant en tout une douzaine de
séances de cours de 120 min, dispensés en français par trois ou deux enseignants japonais et un
enseignant européen. Les 3 modules sont intitulés respectivement : « Métaphysique » ,
« Phénoménologie » et « Philosophie des sciences ».
►Les universitaires européens boursiers EuroPhilosophie qui accompagneront les étudiants en 2010
sont :
Paul-Antoine Miquel (maître de conférences, Université de Nice-Sophia-Antipolis)
Pierre Montebello (professeur, Université Toulouse II-Le Mirail)
Pierre Rodrigo (professeur, Université de Bourgogne)

► Les universitaires japonais qui participent à l’enseignement de la mobilité à l’Université de Hosei en
2010 sont :
Shin Abiko (professeur, Université de Hosei),
Osamu Kanamori (professeur, Université de Tokyo)
Izumi Suzuki (professeur associé, Université de Tokyo)
Yasuhiko Murakami (professeur associé, Université d’Osaka)
Hisashi Fujita (maître de conférence, Universite de Kyushu Sangyo)
Masato Goda (professeur, Université de Meiji)
Kazuyuki Hara (professeur associé, Université de Tokyo)
Tetsuya Kono (professeur, Université de Rikkyo)
► Les noms des quatre ou trios enseignants qui se chargent de chacun des trois modules sont
respectivement :
« Métaphysique » : Pierre Montebello, Hisashi Fujita et Izumi Suzuki
« Phénoménologie » : Pierre Rodrigo, Kazuyuki Hara, Yasuhiko Murakami et Masato Goda
« Philosophie des sciences » : Paul-Antoine Miquel, Osamu Kanamori, Shin Abiko et Tetsuya Kono
◆Syllabus de cours du module « Métaphysique » : « La philosophie contemporaine de la nature »
▶
▶▶
▶Pour une métaphysique de la nature (Pierre Montebello) (6 cours)
Pourquoi une métaphysique de la nature est-elle nécessaire ? L’explication de la nature par la
science a fait au XIXe et XXe siècle d’immenses progrès, dans tous les domaines, physique et
biologique en particulier, mais sur la base de postulats finalement méta-physiques implicites et jamais
remis en cause (monisme matérialiste, unidimensionnalité, réductionnisme…). Ce sont ces postulats
métaphysiques qui ont dominé sans réserve la plupart des théories « physiques » de la nature.
La philosophie, au fait des découvertes majeures des sciences, informée et nourrie des théories
modernes, n’a pas suivi le même chemin. L’avancée des sciences a été pour elle l’occasion de reposer
la question « d’une théorie de la nature » sans épouser pour autant une métaphysique moniste et
matérialiste. Bien des philosophies se sont engagés dans la « refonte » du concept de nature et par là
même vers une cosmologie. Pourquoi une métaphysique de la nature ? On peut discerner quatre
raisons qui reviennent presque chez tous les auteurs : est métaphysique toute tentative de penser la
multiplicité des échelons de la nature qui fondent notre expérience plurivoque (physique, vital,
psychique, collectif) comme autant de dimensions d’un même univers ; est métaphysique toute
nouvelle réflexion qui prend en considération la nature même de « l’être » et ne pense pas que la
philosophie puisse s’affranchir de la question de l’être (quitte à bouleverser radicalement l’ontologie
substantialiste) ; est métaphysique toute tentative de surmonter le dualisme de la connaissance en
direction d’une « participation » au réel qui conditionne l’éthique (vivre, percevoir, penser…ne sont ni

des données objectives ni des activités purement subjectives, mais des mises « en relation dans
l’être », des « tensions », des « actions », des « manières d’être ») ; est métaphysique toute entreprise
qui explore la nature du point de vue de son processus créateur, de son inventivité, de son élan, de sa
durée, de son activité immanente…
Ce sont quelques philosophies engagées dans ce chemin que nous examinerons dans ces
cours.
23/03[16h30-] Introduction : les enjeux de la philosophie de la nature
29/03[14h00-] La philosophie de la nature de Simondon
30/03[14h00-] La philosophie de la nature de Simondon
31/03[14h00-] La philosophie de la nature de Nietzsche
08/04[16h30-] La philosophie de la nature de Deleuze
13/04[16h30-] La philosophie de la nature de Deleuze et conclusion
▶
▶▶
▶Deleuze ou Bergson : deux voies de la philosophie de la vie (Hisashi FUJITA) (4 cours)
On a beaucoup parlé de l’affinité ou communauté des deux philosophes qui représentent la
philosophie vitaliste au XXe siècle : Bergson et Deleuze. Une tâche reste d’éclaircir les différences ou
divergences fondamentales. Mes deux séances se consacreront à cet éclaircissement tant dans la
dimension théorique que pratique :
24/03[14h00] Qu’est-ce que le vitalisme moderne ?
25/03[11h00] Deux vitalismes (divergence métaphysique)
01/04[11h00-] Deux théories de l’image(divergence esthétique)
01/04[14h00-] Désir et joie (divergence politique)
[bibliographie]
J.-L. Vieillard-Baron, Bergson, PUF (Que sais-je ?).
H. Bergson, L’évolution créatrice (en particulier, ch.2, pp.162-186), PUF.
H. Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (ch.3. pp.255-282), PUF.
G. Deleuze, Qu’est-ce que la philosophie ? (conclusion, pp.189-206), Minuit.
G. Deleuze et F. Guattari, Anti-Œdipe (ch.4, pp.336-352), Minuit.
▶
▶▶
▶Izumu Suzuki (2 cours)
(Le contenu des cours sera communiqué ultérieurement)
Dates et horaires :
05/04 [16h30-]
07/04 [16h30-]

Syllabus de cours du module « Phénoménologie »
Le module de Phénoménologie, composé de 12 séances de 120 minutes, développera plusieurs
approches de la phénoménologie. Un dialogue entre pensée européenne et pensée japonaise sera
tout d’abord ouvert par la confrontation de Heidegger et Derrida, d’un côté, avec Tanabe et Tsurumi, de
l’autre côté. La fécondité de ce que l’on pourrait appeler l’héritage critique, au Japon, de la
phénoménologie classique sera ainsi établie. L’approche psychopathologique sera ensuite soumise à
examen, que ce soit par le biais d’une interrogation portant sur la notion de « désir » chez Lacan et
Hegel, ou par celui de l’étude de la mise en jeu (et en question) de l’« intersubjectivité » par l’autisme et
la schizophrénie. On reviendra enfin à un texte fondamental de la tradition phénoménologique, la Krisis
de Husserl, pour en scruter la structure argumentative et pour mettre en évidence ses apports, aussi
bien dans la théorie des idéalités mathématiques ou physiques que dans celle de l’histoire proprement
dite.
▶
▶▶
▶Masato GODA (2 cours) :
1. Martin Heidegger et Hajime Tanabe : la ‘‘Logique de l’espèce’’ et sa confrontation avec l’‘‘ontologie’’
Étant ‘‘notre deuxième philosophe’’ (selon l’expression d’un de ses disciples), Hajime Tanabe
(1884-1962) constitue, avec Nishida (qui est, quant à lui, ‘‘notre premier philosophe’’), le fondement sur
lequel s’est formée l’‘‘École de Kyoto’’. Dès les années trente, Tanabe, après avoir étudié auprès de
Martin Heidegger à Fribourg, commence à élaborer une théorie qu’il appellera lui-même la ‘‘Logique de
l’espèce’’. Pour ce faire, il s’est choisi Heidegger pour ‘‘rival’’ et il s’est imposé de lutter contre
l’‘‘ontologie heideggerienne’’ jusqu’à la fin de sa vie.
L’espèce se situant entre le ‘‘genre’’ et l’‘‘individu’’, la ‘‘Logique de l’espèce’’ ne pouvait pas ne
pas se développer en une théorie des communautés qui, à l’approche de l’éclatement de la Grande
Guerre, s’est spécifiée en une ‘‘ontologie étatique’’. C’est avec cette théorie que Tanabe a incité les
étudiants à se sacrifier pour leur patrie ; pour cette raison il est resté, pendant une trentaine d’années
après sa mort, un philosophe tabou.
Dans ce cours, il s’agira d’abord d’éclaircir la genèse et la structure de la ‘‘Logique de l’espèce’’ à
partir d’un petit texte sur l’interprétation heideggerienne de Kant : ‘‘Synthèse et transcendance’’.
Ensuite, nous suivrons la transformation de cette Logique jusqu’à la parution de ‘‘La philosophie de la
metanoia’’(1946). Pour finir, nous analyserons les critiques de Tanabe à l’encontre de Heidegger,
parallèlement à la formation et à la déformation de sa théorie.
2. Une autre phénoménologie et sémiotique: Derrida, Peirce et Shunsuke Tsurumi

Shunsuke Tsurumi (né en 1922), très connu au Japon en tant que philosophe de la
‘‘désobéissance civique’’, est allé aux États-Unis en 1938 pour étudier la philosophie à l’Université de
Harvard. Il y a assisté aux cours de B. Russell, d’A. Whitehead, etc. Il a achevé son mémoire en 1942
dans la prison de L’Office national de l’immigration à Boston. Huit ans après son retour au Japon il a
publié, en 1950, son premier livre intitulé : La philosophie de L’Amérique, dans lequel il questionnait la
nature du ‘‘pragmatisme’’.
Selon Tsurumi, le fondateur du pragmatisme est, sans aucun doute, Charles Sanders Peirce
(1839-1914), qu’on connaissait alors très peu au Japon et en France. Philosophe méconnu pendant
toute sa vie, Peirce a élaboré, dans le sillage de Ralph Waldo Emerson (1803-1882), une sémiotique
(semiotics) en avance sur la sémiologie de F. de Saussure. À cet égard, on pourrait dire que Peirce est
le ‘‘jumeau’’ de Nietzsche.
D’après Tsurumi, la sémiotique de Peirce se compose de trois termes : le Designatum,
l’Implication et l’Interpretant. C’est cet Interpretant qui renvoie un signe à un autre signe, à l’infini, sans
jamais aboutir à un dernier terme. De là l’in-quiétude du signe. C’est dans cette dernière que Tsurumi a
trouvé une sorte d’arme contre la ‘‘fixation du sens’’, phénomène extrêmement néfaste aux yeux de
Tsurumi pour qui l’avenir politique du Japon, de l’Asie, et par conséquent de ce monde, dépendait de la
manière dont on faisait usage des signes.
Tsurumi ne parle que rarement de la philosophie française du 20
ème
siècle, ce qui
vraisemblablement faisait partie de sa stratégie. Pourtant on peut, selon moi, trouver une réplique de
sa tentative dans celle de Jacques Derrida dans De la grammatologie ’(1967), qui consiste à
dé-construire la notion de ‘‘signifié transcendantal’’, voire celle de ‘‘signe’’ en général. Ce qui est ici
étonnant est d’ailleurs que Derrida mentionne lui-même Peirce et fait de lui son grand prédécesseur.
Ce cours tentera donc de donner un aperçu général de l’œuvre de Tsurumi, tout en essayant de la
comparer à la grammatologie de Derrida.
Dates et horaires des séances:
09/04 [14h00-]
10/04 [11h00-]
▶
▶▶
▶Kazuyuki HARA (2 cours) :
La stratégie de l'advocatus diaboli : l'élaboration de la notion de « désir » chez Jacques Lacan
Dans ce cours nous nous proposerons d'examiner les discussions que J. Lacan développe,
jusqu'au début des années 1960, afin d’analyser comment la notion lacanienne de « désir » s'est
formée, au contact, certes, mais finalement à une certaine distance de Hegel et de Saussure.
Dans la première partie, nous démontrerons qu'il existe une conception spécifique du désir du
désir chez Lacan, avant même sa rencontre avec la philosophie hégélienne ; une conception qui
oriente ses interrogations ultérieures vers l'origine même de cette philosophie.
La deuxième partie sera consacrée à l'examen de l'influence qu'il a subie de la part de la
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%