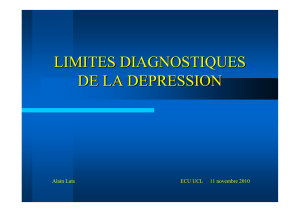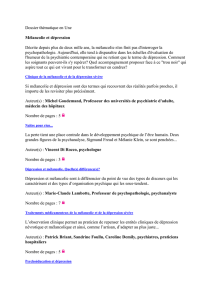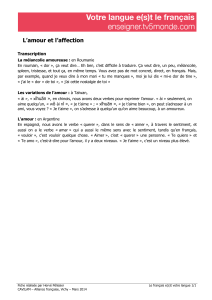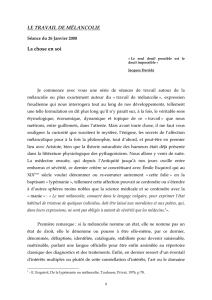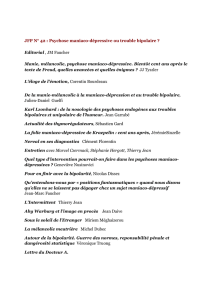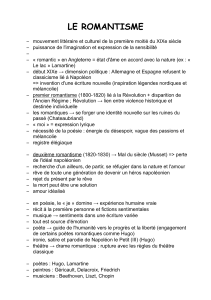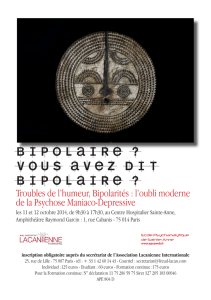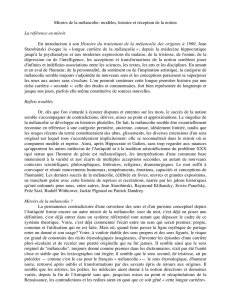Infinitisation et démocratisation de la mélancolie

Cette inflation culturelle, n’est-ce pas aussi parce que la
mélancolie a disparu de la nosographie standard, alors
que les entités descriptives qui prétendent la remplacer ne
parviennent pas à répondre à la complexité de l’humeur
noire, à son malaise basal, à la mise en cause de l’audace
de vivre, de toucher, de prendre contact avec l’entourage,
d’entendre sa voix, sa rumeur profonde ?
Sans doute la mélancolie est-elle liée à une polysémie imper-
tinente pour un diagnostic ou un protocole thérapeutique.
Au sortir de la modernité, elle nous arrive tendue entre une
symptomatologie assez schématique tout au long de son
histoire (avec des traits ressassés, devenus des lieux communs
d’une clinique codifiée) et une expérience de la culpabi-
lité subjective – précisément différenciée d’une culpabilité
culturelle ou du ressort d’une symbolique institutionnelle
ou artistique.
Or, cette subjectivation radicale de la tristesse – distinguée
de l’ordre social et culturel – est une des racines de la dispa-
rition nosologique de la mélancolie. Le sentiment de culpa-
bilité individuelle et le travail de deuil (face à la perte d’un
être cher ou à un échec) prennent le relais de la mélancolie,
parfois déjà chez Burton. L’élément cultuel et culturel est
réduit à l’extrême. L’institution est remplacée par l’accès au
symbolique, à la reconnaissance de l’altérité, à la crise du
réel et de l’imaginaire d’une expérience immortelle. Mais
comment tenir compte de l’affectivité elle-même et de la
volonté libre dans cette logique d’allure tragique ? Certes,
il y a un vecteur logique et singulier dans l’émotion, mais
l’émotion n’est en elle-même ni langage ni libérale.
En outre, la mélancolie antique est bien un concept médical
renvoyant à une dimension physiologique et notamment
au remède alcoolique (le vin), avec des effets sur le com-
portement et l’humeur, mais elle avait essentiellement une
dimension sociale : elle affecte de manière privilégiée les
experts, qu’ils ressortent du domaine de l’art, de la politique
ou de la science (en contrepoint à la manie poétique, rituelle,
divinatoire ou érotique de Platon).
L’acédie chrétienne (a-kèdia, absence de soin, de cure,
négligence), par contre, n’est pas un concept médical et ne
désigne pas une compétence sociale, mais, avant tout, une
ambition spirituelle confrontée à des axiomes (logismoi)
qui l’entravent. Cette vocation n’est pas encore identifiée
à une profession ou à une ambition professionnelle (et son
burn out) ! C’est une affection idiorythmique qui touche
le solitaire confronté à un désir d’excellence spirituel dont
le modèle est tantôt angélique, tantôt christomorphique.
Certes, la dimension corporelle, sociale et même d’expertise
(dans le discernement des esprits) est loin d’être absente,
mais la causalité n’est pas directement physiologique, sociale
ou noétique.
L’élément subjectif ne fera que s’accentuer. Toutefois, dès
l’urbanisation de l’Europe, une certaine contamina-
tion explicite, notamment pour des raisons pastorales, va
s’opérer entre la mélancolie médicale et l’acédie spirituelle
étendue désormais au monde laïc et citadin, et non plus
seulement au monde monastique, érémitique ou rural. Et
la paralysie de l’action religieuse, sociale (travail) ou mo-
rale ne sera plus seulement une entrave à l’acte, mais une
tristesse en voie de sécularisation. La mélancolie n’est plus
le propre d’un dieu (Saturne) ou d’un héros (Hercule), ni
d’une sainte (Marie-Madeleine), du patriarche des ermites
(Antoine d’Égypte) ou du moine agrégé (Cassien interpré-
tant Évagre).
Au sortir de la période médiévale, la sécularisation de toute
l’existence apparaît parfois une mesure de protection contre
la mélancolie liée à l’effritement du vieux cosmos et de la
via antiqua dans le rapport à Dieu : la théologie médiévale
nominaliste devenant de plus en plus critique au regard de
ses propres présupposés. D’autant plus que la mélancolie
antique s’était déjà fort aggravée par son inscription dans le
pathétique chrétien, paulinien et augustinien par excellence.
La théologie réformée a encore accentué cette gravité de la
mélancolie comme insondable sentiment de culpabilité,
d’impuissance des possibles (Kierkegaard), comme mal
sans remède dans la souffrance humaine. La mélancolie
Infinitisation et démocratisation de la mélancolie
Franciscain (Ordre des Frères Mineurs),
Professeur au Centre Sèvres (Paris VI)
Par Bernard FORTHOMME
Ces derniers temps, de nombreuses expositions ayant pour thème la mélancolie ont rappelé la dimension puissamment
culturelle de la mélancolie. Cette inflation artistique et littéraire trahit à la fois l’insuffisance de la médicalisation
du malaise humain, de sa réduction à une maladie chronique, à la tristesse inadéquate ou à des idées dévalorisantes.
La culture sous forme artistique ou littéraire n’est-elle pas la plus apte à sonder l’angoisse humaine face à la mort ou à
rejoindre la douleur face à la vie si grave ; vie à laquelle la mort peut sembler une forme de remède désirable ?
En conférence le 6 décembre
6
cycle raison, folie, déraisons / LNA#58LNA#58 / cycle raison, folie, déraisons

s’éprouve face à l’infini, mais ne peut être résolue par les
œuvres, même caritatives (les possibles), les exercices corporels,
les souffrances voulues, ascétiques, voire conformées à la
Passion du Christ. Elle est infinie en tant que les actes finis
ne peuvent la résoudre et, en ce sens, n’est pas encore sécu-
larisée. La mélancolie comme sentiment de culpabilité ne
peut être dépassée que par la foi, et non par l’effort, l’acte
charitable ou par le masochisme (toujours insuffisants).
Simultanément, malgré tout, pour guérir de sa tristesse de
vivre, l’alléger, il faut le courage d’affronter la mort, d’où le
risque de jouir d’une existence ainsi écourtée. Alors qu’on
ne peut guérir de l’angoisse révélatrice de l’être comme finir !
Et que la charité n’est pas d’abord sa propre passion mortelle,
mais hospitalité à la mort et au mourir d’autrui, au sein de
son propre temps ainsi dilaté et moins oppressant.
Toujours est-il que la souffrance comme mélancolie ou
comme remède hypothétique sont mis hors jeu par la
théologie réformée. Cette tendance a été préparée par la
théologie universitaire médiévale dans la mesure où elle
excluait de considérer comme objet théologique l’expérience
subjective des sentiments, les réservant à la dévotion ou à
l’expérience mystique (Gerson), voire ensuite à la possession
diabolique subjective (distincte de la sorcellerie sociale). Même
le mystère du corps ressuscité pose problème à la théologie
de la vérité (universelle). D’où l’importance des arts et
de la littérature de la Renaissance pour traiter des corps
(Sixtine), de la mélancolie, des anges et des démons de
l’homme. Mais aussi l’émergence d’un renouvellement du
discours médical à ce sujet, car la philosophie et la théologie
semblaient laisser le champ libre à la médecine pour faire du
corps ou des larmes un objet scientifique plus précis, mobi-
lisant l’œil et la technique artistiques en anatomie (voir la
Fabrica de Vésale).
Toutefois, l’humanisation n’est pas directe. Elle est oblique,
car elle passe par le modèle christique et angélique. Le mé-
decin garde encore l’image du christus medicus – jusqu’au
XVIIIème siècle, sans parler des romans populaires à médecin
ou à chirurgien comme Healer – et même du christus psy-
chiatrus (expression qui apparaît à la fin du XVIème siècle).
En outre, l’homme se conçoit lui-même sur le paradigme de
l’ange immobile (Dürer) : autrement dit, comme une vitesse
bloquée, un rire arraisonné par la colère sourde et muette,
cet allègement du corps aggravé, appesanti. Mieux : ce qui
sert à la vitesse, les ailes, pétrifiées, empêtrent le mouvement
et le temps vertical, obscurcissent la lumière solaire.
Et, en même temps, cette tendance contribue à une valori-
sation nouvelle du pathos. Il paraît un relais entre le monde
et la science, entre le corps et la science. La souffrance et
la mort anticipée deviennent des liens entre le corps et la
science. Car la souffrance n’est jamais simplement le cosmos,
mais s’enracine bien dans l’élément corporel de la douleur.
Et parce que la souffrance n’est jamais simplement le corps,
à cause de son élément sémantique, elle s’expose au logos
scientifique. Ce qui ne signifie pas aussitôt une reprise
de la souffrance par la science. Certes, le corps est repris
plus directement dans le champ scientifique. Mais comme
anatomie ou médecine légale, sans le pathos, la souffrance
directe. Même la médecine aliéniste du XIXème siècle met-
tra du temps avant de prendre en compte explicitement la
souffrance, sa sémantique singulière et verbalisable, dans le
« traitement moral », comme traitement médical (non une
morale faite au patient).
En réalité, il faut penser la conjonction entre l’élimination du
pathos sotériologique (ce qui sécularise radicalement l’affectivité
humaine) par la théologie réformée (du moins celle qui exclut
le piétisme affectif) et l’élimination méthodologique du pathos
par le déisme des Lumières, y compris dans le champ de la
théologie catholique (du moins celle qui anesthésie la Bible) : il
faudra attendre le romantisme, et Chateaubriand notamment,
pour réintroduire le pathos : j’ai pleuré et j’ai cru ! Mais les
pleurs sont explicitement liés à la foi, pas au corps ou à l’exer-
cice ascétique, aux mérites d’une pratique corporelle. En outre,
la mélancolie passe du substantif au verbe actif, à un néolo-
gisme : mélancoliser, avec sa variable réflexive.
http://www. bernard -forthomme.com
cycle raison, folie, déraisons / LNA#58
7
1
/
2
100%