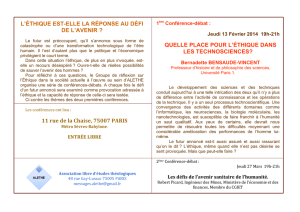L`éthique médicale peut elle être indépendante de la

L’éthique médicale peut elle être indépendante de la politique
économique ?
Philippe ABECASSIS (GEAPE, Université D’Angers)
Philippe BATIFOULIER (FORUM, Université Paris X-Nanterre)
Résumé
En économie de la santé, l'éthique est souvent l'argument principal opposé aux
régulations comptables du système de soins. Cette communication relativise cette
l'opposition pour montrer que l'éthique, en tant qu'ensemble sémantique,
s'approprie le référentiel de politique publique pour se colorer d'une teinte
marchande.
1. INTRODUCTION
Les considérations éthiques sont omniprésentes en matière de santé. Chaque
profession médicale est dotée d’un code de déontologie et de références morales,
comme le serment d’Hippocrate, qui orientent les agents, et les médecins tout
particulièrement, dans une position éthique. Le Conseil de l’Ordre constitue
également une autorité incontournable en la matière. Les professionnels de santé
affichent cette composante éthique de leur activité à la façon d’un emblème, voire
d’une décoration. C’est pourquoi, le recours à l’éthique fait parfois office de
plaidoyer militant. Dans ces conditions, on peut considérer que les professionnels
sont spontanément capables d’orienter leurs actions dans un sens profitable aux
patients. Ils sont soucieux du bien-être de ce dernier et n’ont nul besoin d’être
contraints ou incités à le faire.
En effet, une contrainte imposée au médecin n’est d’aucune utilité puisqu’il
s’impose lui même une telle attitude. L’intervention publique, soucieuse d’équité et
de justice, trouve dans le médecin un allié naturel et un relais parfait. L’éthique est
un remède naturel à l’opportunisme et on ne voit pas dans cette perspective en quoi
la contrainte tutélaire pourrait permettre de faire ce qui se fait déjà spontanément.
De même, un contrat incitatif qui viendrait embellir un monde "enlaidi" par
l’asymétrie d’information n’a aucune raison d’être. Dans la mesure où les médecins
sont animés de motivations intrinsèques et non extrinsèques (KREPS, 1997), il est
inutile de les recadrer par un contrat qui postule des comportements déviants.
On comprend alors que l’affirmation de valeurs éthiques conduise les
professionnels de santé à revendiquer une certaine autonomie et des droits
d’autorégulation. Cette communication relativise cette affirmation pour souligner

L’éthique médicale peut elle être indépendante de la politique économique ? 2
le lien existant entre l’éthique et la politique économique. La première n’est pas
autonome par rapport à la seconde.
L’éthique est souvent mobilisée comme fer de lance de la contestation à une
régulation comptable des dépenses de santé. Or l’opposition entre considérations
éthiques et considérations marchandes n’est pas aussi tranchée qu’il n’y paraît au
premier abord : l’intervention publique, soucieuse d’équité et de justice, trouve
souvent dans le médecin un allié naturel et un relais parfait (2). Cette alliance
repose sur un « référentiel sectoriel de politique publique » qui conduit les acteurs à
formuler les problèmes auxquels ils sont confrontés et les solutions qu’ils
proposent. Le référentiel, inspiré du paradigme libéral, conduit à mettre au premier
plan les comportements opportunistes et les logiques de bonus malus. L’éthique
médicale, pour rester le socle de la profession, doit alors se modeler pour s’adapter
à ce référentiel marchand. Les considérations comptables, les logiques incitatives
ne conduisent pas à abandonner l’éthique qui reste une référence essentielle aux
yeux des médecins mais à la colorer pour la teinter de logique marchande. Ceci
n’est compréhensible que parce que l’on considère que l’éthique n’est pas un
ensemble de textes rigides et immuables (une syntaxe) mais une façon d’interpréter
toutes les pratiques (une sémantique) (3).
2. ÉTATISATION, POUVOIR POLITIQUE DES MÉDECINS ET
ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE
Un système de protection sociale qualifié de "corporatiste conservateur" n’est a
priori pas le mieux placé pour se réformer. Le discours sur la réforme "nécessaire"
transite souvent par la dénonciation des blocages et obstacles institutionnels qui
étouffent toute tentative de changement. Ce discours prend une teneur particulière
en matière de santé où le conservatisme doit être tempéré par l’existence de
nombreuses mesures de politique économique qui doivent composer avec un
corporatisme puissant d’essence libérale, celui des médecins.
L’évolution récente du système de santé français témoigne en effet de
nombreuses et importantes transformations. Celles-ci s’inscrivent dans la logique
d’ensemble du système de protection sociale français telle qu’elle a été souvent
décrite, notamment par PALIER et BONALI (1995) : des moyens bismarckiens au
service d’objectifs de plus en plus beveridgiens. Mais, elles exacerbent aussi cette
évolution. Le système de santé constitue l’une des formes les plus expressives de
mutation beveridgienne de la protection sociale française. Au niveau des objectifs
mais aussi au niveau des moyens qui sont également de plus en plus beveridgiens.
On est alors fondé à parler « d’étatisation » du système de santé (2.1). C’est cette
étatisation qui est dénoncée par le corps médical, qui lui oppose l’argument
éthique, présenté comme le rempart libéral nécessaire à la qualité des soins. Le
pouvoir d’opposition politique des médecins est en effet légitimité par la
composante éthique de leur activité (2.2). Ce pouvoir n’est toutefois pas la simple
expression de l’originalité de l’activité médicale. Il se nourrit de l’intervention
publique. L’éthique professionnelle et les droits d’autorégulation afférents sont
intimement liés au mandat donné par l’État à la profession médicale (2.3).

L’éthique médicale peut elle être indépendante de la politique économique ? 3
2.1. Une « Étatisation » du système de santé français ?
Plus que tout autre secteur de la protection sociale française (celui des retraites
notamment), les réformes récentes soulignent une évolution beveridgienne du
système. Au niveau des objectifs, l’indicateur le plus visible en est la CMU qui
conduit le système de soins à offrir aujourd’hui une couverture quasi universelle,
indépendamment de la position de l’individu sur le marché du travail. Au niveau
des moyens, le développement de la CSG, fixée par le législateur, conteste la
primauté de la cotisation sociale. Des points de CSG en plus se substituent à des
cotisations d’assurance maladie en moins1. La CSG finance une part grandissante
de la protection sociale et tout particulièrement la santé. 58 % de la CSG sont
affectés à l’assurance maladie.
Au-delà de ces traces les plus visibles, d’autres évolutions de fond viennent
renforcer ce constat. La politique visant à influer sur les négociations entre
partenaires sociaux et à les orienter vers la "maîtrise médicalisée" des dépenses a
laissé place à l’intervention plus directe de l’État, surtout depuis le plan Juppé de
1995 et les ordonnances de 1996 à sa suite2.
Le parlement se substitue –constitutionnellement- aux partenaires sociaux pour
fixer l’évolution annuelle des dépenses de santé. Il vote le projet de loi de
financement de la sécurité sociale (PLFSS) qui fixe l’objectif national d’évolution
des dépenses d’assurance maladie (ONDAM). La loi se substitue ainsi à l’accord
négocié par la CNAM et les syndicats médicaux.
La réforme est aussi celle de la composition des conseils d’administration des
caisses d’assurance maladie. L’introduction de personnalités "ès qualités",
nommées par l’État affaiblit le paritarisme originel de ces institutions. Dans le
même temps, des organismes de contrôle nouveaux, sous l’égide de l’État,
apparaissent. Ils sont chargés d’administrer, de coordonner voire de regrouper les
hôpitaux ou les services, au niveau régional (Agences régionales de
l’hospitalisation, ARH), ou encore de définir les critères de qualité et de bonnes
pratiques médicales –les références médicales opposables- (Agence nationale
d’accréditation et d’évaluation de la santé, ANAES). Ces organismes se substituent
aux partenaires conventionnels (CNAM et syndicats médicaux).
La régulation administrée remplace ainsi, pour une part, la régulation par
« conventions médicales ». L’État devient maître d’œuvre du système de santé au
détriment des partenaires sociaux. Cette étatisation ou tentative d’étatisation est
dénoncée régulièrement par ces derniers pour l’ensemble des secteurs de la
protection sociale française, mais avec une vigueur toute particulière pour le
système de santé. Alors que la plus importante organisation patronale (le MEDEF)
est sortie du conseil d’administration de la CNAM, les organisations syndicales
attachées à la défense de la médecine libérale soulignent le rôle négatif de l’État
dans la détérioration du dialogue social et des comptes sociaux. Le corporatisme
1 Un point de CSG contre un point de cotisations maladie en 1996 (gouvernement JUPPE) et 4.1
points de CSG contre 4.75 points de cotisations maladie pour les salariés en 1998 (gouvernement
Jospin).
2 Pour des présentations synthétiques, voir PALIER (2002) et BARBIER et THERET (2004).

L’éthique médicale peut elle être indépendante de la politique économique ? 4
syndical s’insurge contre la progression de la régulation étatique et fait valoir des
arguments influents au premier rang desquels figure l’éthique.
2.2. L’éthique comme porte-voix de la contestation médicale
L’évolution beveridgienne du système de santé et l’amoindrissement
concomitant du rôle des conventions médicales affaiblissent de fait la puissance
des syndicats médicaux. L’étatisation du système érode le pouvoir médical en
transférant la compétence décisionnelle des partenaires sociaux vers l’État.
Cependant le pouvoir politique des médecins demeure. La profession médicale est
en effet capable de construire un rapport de forces favorable. La faculté des
médecins à défendre l’intérêt professionnel n’est plus à démontrer. En ce sens, on
peut parler de véritable pouvoir politique des médecins (HASSENTEUFEL, 1997).
L’étendu d’un tel pouvoir permet de contrer l’évolution beveridgienne du
système. Ainsi, pour citer quelques exemples, la mobilisation politique des
médecins a conduit le gouvernement en 1992 à retirer un texte conduisant à
encadrer l’évolution des dépenses de santé en médecine ambulatoire. Les syndicats
médicaux ont, dans ce cas, fait appel aux députés et le gouvernement ne disposant
pas d’une majorité suffisante dans un contexte politique général difficile
(référendum sur le traité de Maastricht) a préféré renoncer3. De nombreux aspects
du plan JUPPE ont également fait l’objet d’une vive opposition et n’ont pas été
suivis d’effet4. De fait, le vote du parlement sur un objectif de dépenses (PLFSS) a
bien lieu chaque année mais n’est pas astreignant. Enfin, le plan JOHANET présenté
en 1999 par l’ancien directeur de la CNAM présentait des mesures contraignantes
pour les médecins (sur le conventionnement, la couverture sociale, le prix des
médicaments, etc.). Il n’a pas obtenu la nécessaire traduction législative qui lui
aurait permis d’être appliqué.
On comprend difficilement cette capacité remarquable d’une profession à
s’opposer puis à orienter la politique publique dans un sens qui lui soit favorable si
on ne fait pas référence à l’argument éthique. La profession médicale dispose d’un
pouvoir phénoménal totalement original, imputable à la nature charismatique de
l’activité liée, d’un prime abord, aux questions de vie et de mort. La reconnaissance
sociale de la profession et le prestige dont jouit le médecin sont également liés à la
scientificité de la pratique5. Mais cette spécificité, gravité et scientificité,
indéniables de l’activité n’expliquent pas totalement la portée de la parole médicale
dans le champ politique.
Le pouvoir politique de la corporation se nourrit également du rôle d’expert que
joue le médecin. Le savoir médical est mis au service du patient. Le médecin est
non seulement le mandataire du patient mais ce dernier ne voit généralement pas
3 Voir HASSENTEUFEL (1997, p. 288 et 295) pour un développement.
4 Ainsi en est-il des pénalités prévues en cas de dépassement de l’objectif quantifié national voté
par le parlement, par une profession médicale dans sa globalité. Les sanctions consistaient à la
dévalorisation de l’acte. Cette mesure n’a d’abord pas été appliquée et les dépassements du plafond
n’ont pas été suivis de « malus », avant d’être déclarée inconstitutionnelle par le Conseil d’État
5 Véhiculée par des études très longues avec une rude sélection et un jargon difficilement
accessible au profane.

L’éthique médicale peut elle être indépendante de la politique économique ? 5
d’inconvénient à ce qu’il en soit ainsi. La délégation n’est alors pas un problème si
le médecin est l’agent parfait du malade.
Le terme "éthique" résume l’attention que le médecin prête au patient. Soucieux
des intérêts de son patient, le médecin ne va pas exercer son pouvoir
discrétionnaire, qu’il bride lui même, faisant de la relation médicale une relation de
confiance (BATIFOULIER, 1999, BATIFOULIER et GADREAU, 2003). La moralisation
de l’exercice médical place le bien-être du patient au dessus de l’intérêt personnel.
Il y a donc bien puissance de la profession médicale mais cette puissance est
canalisée par une responsabilisation du médecin. C’est en ces termes qu’est définie
l’éthique par le rapport “Éthique et Profession de santé” : « Dans ce rapport, nous
comprenons l’éthique comme la mise en question du pouvoir et de la puissance par
la responsabilité pour autrui…En d’autres termes, il s’agit d’interroger le pouvoir
par le devoir » (CORDIER, 2003, p.18).
La mise en scène de cette bienveillance intrinsèque du médecin pour le patient
est assurée par les textes de la déontologie (codes et serment) et par les institutions
(conseil de l’Ordre).
L’éthique permet ainsi non seulement d’effacer les risques potentiels de la
délégation et de reconnaître la représentativité du médecin. Le médecin ne
représente pas que lui même ou sa corporation ; il représente aussi le patient
Dès lors, les contestations à la politique publique et actions menées (jusqu’aux
mouvements de grève) sont systématiquement justifiées au nom de l’intérêt du
patient6. L’affichage militant de modalités éthiques qui encadrent la profession
médicale permet ainsi de s’opposer à la perspective comptable. La légitimité de
l’État ou des organismes de tutelle à vouloir soigner à moindre coût et à organiser
la recherche "d’économies" est confrontée à la légitimité éthique du comportement
médical qui cherche au contraire à s’affranchir de considérations économiques. La
bonne pratique professionnelle s’oppose ainsi à la bonne gestion économique et les
deux types de légitimités s’affrontent.
Le médecin ne lutte pas contre la politique publique et notamment contre les
politiques d’enveloppe globale et de restriction des dépenses en son nom propre. Il
le fait toujours pour le bien être du patient. Le besoin du malade prime sur le PIB et
c’est la santé du patient et non les avantages de la profession qui sont en danger.
Les arguments de la défense du statut de la profession, du maintien voire de la
progression du revenu sont rarement des mots d’ordre syndicaux. Alors que les
conflits du travail ont fréquemment pour justification la revalorisation des salaires
dans de nombreuses activités, il n’en va pas du tout de même pour la profession
médicale. La légitimité de la contestation vient d’ailleurs. Elle transite par une
position éthique qui conduit le médecin à se présenter comme le garant des intérêts
du patient.
6 Qui en fait ne dit pas grand-chose sur ce terrain et, quand c’est le cas, exprime des positions
contradictoires. Ainsi, l’association de patients LIEN, qui lutte notamment contre les infections
nosocomiales, défend la fermeture de services ou d’unités jugées à risque voire dangereuses. En
opposition parfois avec les actions visant à défendre l’établissement local menacé de fermeture ou de
regroupement.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%