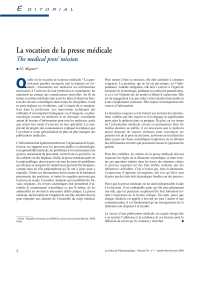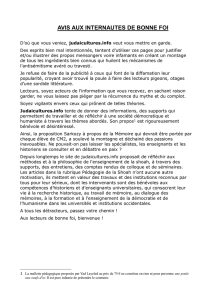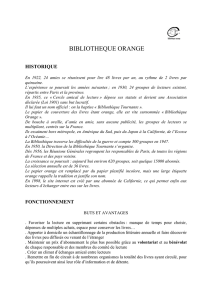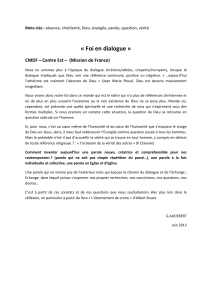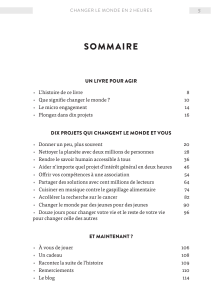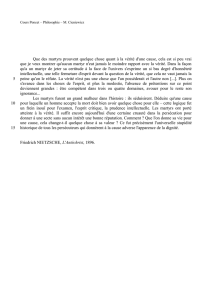Article

/// 05
Dans ce numéro, Mains Libres publie, en première franco-
phone, la liste d’items TIDIeR qui vise à améliorer la descrip-
tion des traitements dans les articles scientifiques. Notre revue
ayant de tout temps été attachée à servir les praticiens, nos
fidèles lecteurs ne seront pas surpris qu’elle s’engage pour que
les traitements évalués dans les études soient plus aisément
transférables en pratique.
Plus surprenant, Mains Libres publie pour la première fois un
article sur les méthodes statistiques. Paul Vaucher y explique
de manière didactique quel est le sens de la valeur P dans la
différence entre deux groupes. Pourquoi cette nouvelle ouverture
à une thématique qui n’a pas d’emblée les faveurs de la cote
auprès des cliniciens ? Pour deux raisons essentiellement.
Premièrement, pour aider nos lecteurs à mieux comprendre le
contenu des articles qu’ils lisent. En effet, l’abord des notions
statistiques est parfois difficile, surtout si l’on n’a pas de pré-
dispositions particulières pour les mathématiques. Pourtant, si
les subtilités du calcul ne sont accessibles qu’à une minorité
des professionnels de santé, les principes qui régissent les sta-
tistiques courantes sont finalement assez simples, et tout à
fait à la portée de tous. Si le chercheur et le réviseur d’article
doivent être capables d’évaluer le bienfondé des statistiques
utilisées, le lecteur a avant tout besoin d’en saisir l’objectif et
le sens général.
Deuxièmement, nous souhaiterions améliorer par ces tutoriels
le regard critique que nos lecteurs peuvent porter sur les articles
que nous publions, et ceux des autres revues par la même oc-
casion. On entend et ré-entend qu’« on fait dire aux statistiques
ce qu’on veut bien leur faire dire ». Ceci peut être vrai… à deux
conditions. Tout d’abord, il faut que celui qui fait appel aux
statistiques ait l’intention de les détourner. Churchill disait « Je
ne crois jamais une statistique à moins de l’avoir moi-même
falsifiée ». Sa citation montre bien que le problème ne vient
alors pas de la statistique elle-même, mais de l’usage qu’on
en fait. Il en va de même de tout outil puissant que l’on peut
détourner à mauvais escient. Pour qu’un falsificateur réussisse
à détourner une statistique, il faut également qu’il puisse tirer
profit de l’ignorance de l’interlocuteur. C’est précisément ce
que nous voulons éviter à nos lecteurs, et c’est pourquoi nous
envisageons de publier – en parallèles aux articles qui consti-
Mains Libres / 2016 / 4
tuent le cœur de Mains Libre – d’autres articles qui mettent les
statistiques à la portée des cliniciens.
Vous y verrez que les statistiques visent finalement un ob-
jectif fort louable : s’approcher de la vérité. Cependant, s’en
approcher ne signifie pas la détenir. Les statisticiens sont les
premiers à le reconnaître, et comme dans nos professions, les
controverses sur la meilleure manière de procéder vont bon
train dans leur domaine de compétences.
Les statistiques nous rendent néanmoins un énorme service :
elles permettent de déterminer, avec une certaine marge d’in-
certitude, ce qui se passe dans l’ensemble de la population à
partir d’un petit nombre de personnes. La seule alternative
pour s’approcher de la vérité serait de mesurer l’ensemble de
la population concernée pour connaître la réponse. Ce serait
tellement compliqué, long, cher et fastidieux, que c’en est in-
concevable.
Les praticiens reprochent souvent aux statistiques, de ne pas
dire grand-chose du patient qu’ils ont en face d’eux, et ceci est
vrai ! Savoir qu’une approche est juste en général ne signifie pas
qu’elle s’applique avec certitude à la personne que l’on traite.
Un traitement généralement efficace ne l’est pas pour tout le
monde, et son degré d’efficacité est variable chez chacun. Il y
a donc quelque chose qui relève du pari, lorsque l’on utilise les
statistiques en clinique. Tel un joueur de poker professionnel,
le clinicien averti utilise des résultats issus des statistiques pour
orienter son approche avec les meilleures chances de réussites
a priori. Le pari est sensé, car en l’absence de certitude absolue,
opter en première intention pour le « best bet » est le mieux que
nous puissions offrir aux patients.
Face à eux, le praticien cherche avant tout à agir de la manière
la plus juste possible. Le bon usage des statistiques va dans
ce sens. Elles ne sauraient suffire à toucher du doigt la vérité,
mais elles contribuent à s’en approcher, ou du moins à estimer
avec quel degré d’incertitude on agit. L’écoute, le ressenti, le
raisonnement et l’expérience sont des sources d’information
tout aussi valables, et complémentaires des savoirs quantitatifs
issus des statistiques. Face à la complexité des situations que
nous rencontrons dans les milieux de la santé, comment pour-
rions-nous nous passer ne serait-ce que d’un seul de ces piliers ?
Editorial
Claude Pichonnaz
Claude Pichonnaz, PT, MSc, PhDc
Rédacteur de Mains Libres
(Lausanne)
Le patient, le clinicien et les statistiques
1
/
1
100%