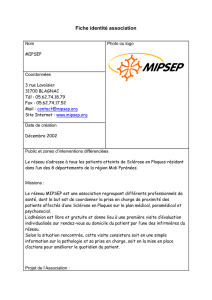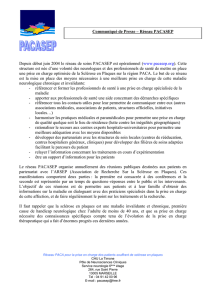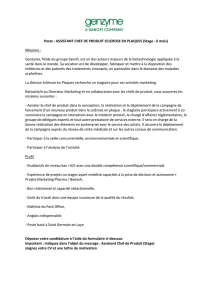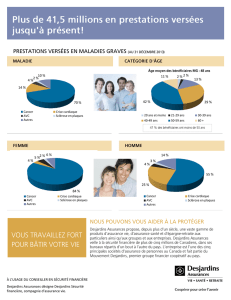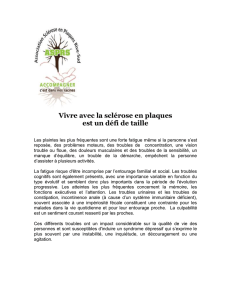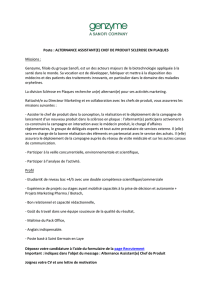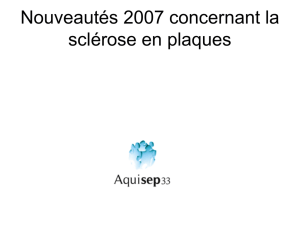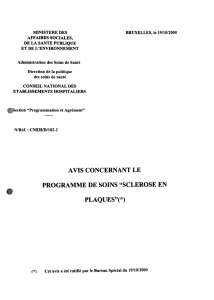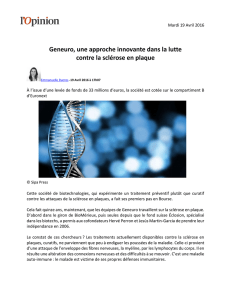Points forts

POINTS FORTS
DU CONGRÈS SCIENTIFIQUE 2016
REMYÉLINISATION
des avancées importantes
NMO SPECTRUM
le spectre des anticorps
LES PRIX ARSEP
2 jeunes chercheurs
primés lors du congrès

La Conférence François Lhermitte organisée par la Fondation ARSEP est destinée aux professionnels de la
santé et de la recherche qui s’intéressent à la sclérose en plaques. Elle réunit près de 200 participants. Ce
rendez-vous annuel, unique en France, permet en une journée d’aborder deux thématiques spéciques dans
lesquelles les avancées de la recherche dans le domaine de la SEP et des maladies apparentées sont les plus
pertinentes.
C’est l’occasion pour les plus grands spécialistes français et étrangers de se réunir pour partager avec les
chercheurs français et européens leurs récentes découvertes et leurs objectifs.
Cette journée permet également aux nombreux chercheurs, doctorants et post-doctorants soutenus par la
Fondation ARSEP de présenter l’avancée de leurs travaux par des communications orales courtes ou des posters
achés. Enn, cette journée permet à tous les participants d’échanger leurs connaissances, de partager leurs
expériences, d’énoncer de nouvelles hypothèses et d’établir des collaborations.
La 25ème Conférence François Lhermitte de la Fondation pour la recherche sur la sclérose en plaques, réunissant
cliniciens et chercheurs fondamentaux, s’est tenue le 27 mai dernier à l’institut des Cordeliers à Paris. Lors de
cette journée, 2 thèmes majeurs ont été abordés : les mécanismes de la remyélinisation dans la sclérose en
plaques et la neuromyélite optique de Devic.

CONGRÈS
SCIENTIFIQUE SEP 2016
PRÉSENTATION DES SPEAKERS
Robin Franklin :
Chercheur et professeur, dirige le Centre sur la SEP
à Cambridge (Angleterre). Il étudie la réparation
de la myéline et travaille sur les mécanismes de la
régénération du système nerveux central dont la
remyélinisation.
Ari Green :
Directeur clinique adjoint du centre SEP à l’université
de San Francisco (USA), étudie le nerf optique et les
relations entre inammation, démyélinisation et
neurodégénérescence sur les atteintes des bres
nerveuses du cerveau dans la SEP.
Valentina Fossati :
Chercheure au New York Stem Cell Foundation. Elle
utilise des fragments de peau issues de personnes
atteintes de sclérose en plaques an d’étudier les
oligodendrocytes aectés par la maladie. Elle s’est
aussi intéressée au développement du système
immunitaire et aux cellules souches embryonnaires.
Bernard Zalc :
Chercheur en neurosciences, ancien directeur du
centre de recherche de l’Institut du cerveau et de la
moelle épinière à Paris, il étudie le développement
des oligodendrocytes et en particulier la migration
des cellules précurseurs d’oligodendrocytes dans
diérents modèles animaux.
Robin JM FRANKLIN
(Cambridge, United Kingdom)
Remyélinisation et système immunitaire
La remyélinisation peut être un proces-
sus de réparation très ecace.
Il est dirigé par une population de
cellules précurseurs nommées oligo-
dendrocytes précurseurs (OPCs pour
"Oligodendrocyte Precursor Cells") lar-
gement distribuées dans le système
nerveux central mais dont la capacité à
se diérencier et à migrer dépend aussi
de leur localisation dans le cerveau.
Au cours de la sclérose en plaques, la remyélinisation
est inconstante et la perte de l’intégrité et des capacités
fonctionnelles de l’axone démyélinisé fait du processus de
remyélinisation un objectif thérapeutique majeur.
Les travaux menés ces dernières années démontrent le rôle
majeur des macrophages, cellules du système immunitaire
inné, dans le processus de remyélinisation. Un certain nombre
d’arguments plaide en faveur du vieillissement (l’avancée en
âge) comme facteur limitant les capacités de remyélinisation.
Cet eet est en partie dû à une perte des capacités d’élimination
des débris de myéline lors de la démyélinisation, débris
contenant des substrats qui bloquent la diérenciation des
oligodendrocytes précurseurs.
Une remyélinisation ecace chez le jeune animal est associée
à l’activité spécique de certaines cellules immunitaires qui
induit la disparition des débris de myéline. Cette activité est
très diminuée chez l’animal âgé.
Diérents facteurs exprimés par les cellules de l’immunité
innée ou impliqués dans la biologie des cellules souches
interviennent dans la régulation de la diérenciation des
cellules précurseurs d’oligodendrocytes. La diminution des
capacités à éliminer la myéline par les macrophages de l’animal
REMYÉLINISATION
Réparation de la myéline
dans la SEP :
L’espoir de nouvelles voies
thérapeutiques.
Robin FRANKLIN

âgé est associée à une diminution d’expression
des gènes impliqués dans la transformation de la
vitamine A. Si cette transformation est bloquée chez
l’animal jeune, l’élimination des débris de myéline
diminue. Elle peut être augmentée chez l’animal âgé
en utilisant des molécules spéciques redonnant aux
macrophages un prol de sujet jeune.
Ces résultats ouvrent la voie à de nouvelles
approches thérapeutiques. Un essai clinique
utilisant cette molécule spécique a été initié
chez 50 patients avec une SEP rémittente sous
traitement par interféronß an d’en évaluer
l’ecacité et la tolérance.
Ari GREEN
(San Francisco, USA)
Clémastine : de la découverte aux essais
cliniques.
Restaurer la gaine de myéline est un objectif
thérapeutique important pour la prévention
du décit fonctionnel et du
handicap à long terme.
Un système d’étude utilisant
des microbres de verre de
forme conique comme leurre à
la présence de l’axone a pu être
automatisé pour fournir un test
permettant le tri à grande échelle
de molécules potentiellement
ecaces pour promouvoir la remyélinisation. Ce
test a permis d’identier des composés capables de
stimuler la diérenciation des cellules précurseurs
d’oligodendrocytes et la remyélinisation. Parmi ceux-
ci, la clémastine a montré la meilleure ecacité. Après
conrmation de ces eets bénéques chez l’animal,
cette molécule a été utilisée dans un essai clinique
randomisé de phase II chez 50patients atteints soit
de SEP soit de neuromyélite optique.
Dans cet essai croisé comparant en parallèle
clémastine et placebo, la clémastine s’est révélée
ecace pour la remyélinisation et la fonction
visuelle, en revanche, il n’a pas été mis en évidence
d’eet sur les données de l’IRM.
Valentina FOSSATI
(New-York, USA)
SEP progressive et cellules souches
pluripotentes induites.
Les causes de la neurodégé-
nérescence dans la SEP sont
encore mal connues, en
particulier parce qu’il est
dicile de mener des études
sur les cellules neuronales ou
gliales humaines.
Des avancées concernant les
cellules souches ont permis de
reprogrammer des cellules somatiques (constituant
l’immense majorité des cellules d’un organisme à
l’exception des cellules germinale) vers un état dans
lequel les cellules sont capables de donner naissance
à toutes les variétés cellulaires de l’organisme, sans
pouvoir donner un individu entier. En utilisant un
système robotisé, il est possible de produire des cel-
lules souches pluripotentes de manière rapide et très
reproductible et de les reprogrammer en diérents
types cellulaires (astrocytes, microglie, précurseurs
d’oligodendrocytes).
Des cellules provenant de personnes atteintes de SEP
progressive ou rémittente ont été reprogrammées
en cellules souches pluripotentes et utilisées
pour étudier les mécanismes qui sous tendent la
neurodégénération et le potentiel de remyélinisation
Ari Green
Valentina FOSSATI

de ces cellules souches issues de biopsies de
personnes atteintes de SEP.
Ces cellules permettront également de tester
les molécules favorisant la remyélinisation avec
le système d’étude utilisant des microbres de
verre et des cellules de patients.
Bernard ZALC
(Paris, France)
Un autre modèle de remyéli-
nisation utilise des têtards
modiés génétiquement pour
permettre l’ablation condi-
tionnelle des oligodendro-
cytes myélinisants.
La remyélinisation peut être
grandement accélérée en ajou-
tant des molécules actives dans
l’eau, ce qui fournit un test de screening à grande
échelle in vivo.
Plusieurs molécules ont ainsi été testées, notam-
ment celles citées au cours des présentations pré-
cédentes, mais aussi des immunomodulateurs qui
interagissent avec des récepteurs présents sur les
lymphocytes T et B.
par Martine SINET
chercheur ScienSAs
Bernard ZALC
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%