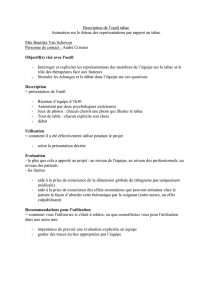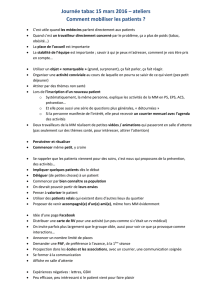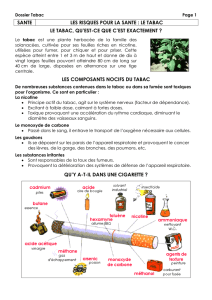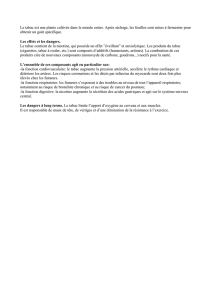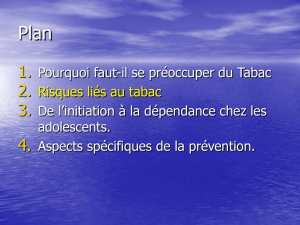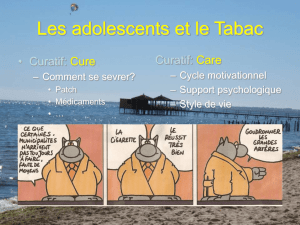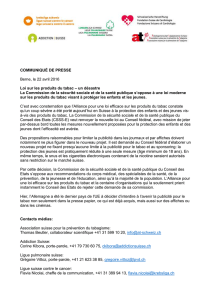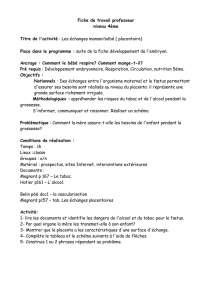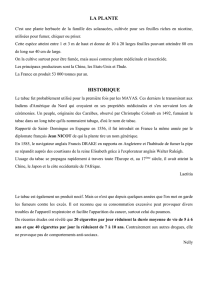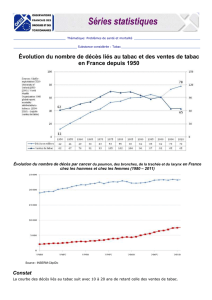Plan ISA - ASS-NC

ALCOOL, TABAC ET AUTRES DROGUES EN NOUVELLE-CALEDONIE
ALCOOL, TABAC ET AUTRES DROGUES EN NOUVELLE-CALEDONIE
PLAN
2012-2016 INFORMER
SENSIBILISER
AGIR
AGENCE SANITAIRE ET SOCIALE
de la Nouvelle-Calédonie
ASSNC

3
ALCOOL, TABAC ET AUTRES DROGUES EN NOUVELLE-CALEDONIE
HISTORIqUE DE LA SITUATION
Toutes les sociétés sont confrontées à l’usage de produits psycho actifs. S’il n’y a pas
de société sans drogues, cela ne signifie pas que les pouvoirs publics sont totalement
désarmés pour en limiter les dégâts et pour en contrôler voire en interdire les usages.
La Nouvelle-Calédonie s’est trouvée confrontée dès le 19ème
siècle à la consommation d’alcool, les baleiniers et les san-
taliers en faisaient le troc dès le début de leur présence
dans toute la zone du Pacifique Sud. Le cannabis, pour sa
part, n’a connu une progression de sa consommation que de
façon assez tardive, dans les années 70, avec les premières
plantations locales. Dans les deux cas, contrairement aux
idées reçues, il est nécessaire de rappeler qu’il ne s’agit pas
de produits ancrés dans une consommation traditionnelle
en Nouvelle-Calédonie. Quant aux habitudes de consomma-
tions du kava, elles sont aussi très récentes.
Face aux dégâts provoqués par ces consommations, diffé-
rentes mesures ont été envisagées et mises en place. Force
a été de constater à la fin du 20ème siècle, qu’elles n’étaient
pas parvenues à endiguer une progression inquiétante en
termes de santé et de sécurité publique.
Même si la population calédonienne a globalement marqué
peu d’appétence vis-à-vis de la cocaïne et de l’héroïne, il
faut relever que les politiques de lutte contre l’entrée et le
trafic de stupéfiants se sont avérées très efficaces, il n’en
va pas de même pour les politiques visant l’alcool, le tabac
et le cannabis.
Au tournant du 21ème siècle, l’ensemble des services de
l’Etat comme de la Nouvelle-Calédonie se sont emparées
de ces questions de façon plus globale en commençant par
la problématique d’abus d’alcool avec notamment un effort
dans le cadre de la sécurité routière, la réalisation de cam-
pagnes de prévention et une évolution de la réglementation.
En 1992, à l’initiative du haut-commissaire de la République,
une journée territoriale se tenait sur cette problématique et
l’association de lutte contre les abus d’alcool voyait le jour.
Dès 1994, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a placé la
lutte contre les abus d’alcool comme l’une des premières
priorités de prévention.
A compter de 2005, le gouvernement de la Nouvelle-Calédo-
nie a décidé de créer au sein de l’agence sanitaire et sociale
un centre d’addictologie prenant en compte non seulement
l’alcool mais aussi le cannabis, le tabac et l’ensemble des
consommations ou comportements à risque. Il s’agit d’une
approche conforme aux évolutions nationales et internatio-
nales qui situent la question des usages de drogues dans le
cadre plus global des comportements de dépendance avec
ou sans produit et qui privilégient une approche de réduc-
tion des dommages et des risques.
Voir l’historique détaillé en ANNEXE 1
La volonté exprimée par le Président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie, dans sa déclaration de politique générale
du 28 novembre 2011, vise à réaliser un nouveau plan posi-
tionné comme « une priorité du gouvernement : la cohésion et
la sécurité de notre société sont en jeu ». Il place dans cette
perspective la lutte contre l’alcool et le cannabis au centre de
cette priorité.
Le présent projet de plan a été élaboré à la suite de multiples
entretiens avec les responsables des services de la Nou-
velle-Calédonie, le représentant de l’Etat, le Procureur de la
République, certaines communes et associations.
Il fait suite à l’évaluation du plan précédant et au travail réalisé à
l’occasion du séminaire d’élaboration et de planification du plan
à moyen terme de mai 2010.
Compte tenu de la multiplicité des secteurs concernés, un
grand nombre de services seront mis à contribution pour la
mise en œuvre des grands axes qui sont ici tracés. Les trois
provinces, les associations de maires ainsi que les institutions
calédoniennes telles que le Sénat Coutumier ou le Conseil
Economique et Social seront également associés à sa mise en
œuvre. Il en va de même pour les principaux acteurs écono-
miques et sociaux.
Après son adoption au congrès, les mesures règlementaires
que le plan comporte seront déclinées en arrêtés du gouver-
nement, lois de pays et délibérations du congrès, des assem-
blées de provinces et des conseils municipaux. Les actions
proposées, quant à elles, seront mises en œuvre.
Avant de développer les axes du plan, il convient au préalable
de définir les concepts utilisés et de présenter un état des lieux
sur:
- la réglementation
- les connaissances épidémiologiques de consommation et les
dommages associés.
Sur la base de ce constat et des orientations stratégiques
fixées par le gouvernement, un certain nombre de propositions
sont ici formulées dans un plan d’actions articulé autour des
axes suivants :
• Moderniser la réglementation
• Accroître la formation des acteurs
• Développer les actions de prévention
• Améliorer l’offre des soins
• Renforcer l’application de la loi
• Amplifier la communication et améliorer
les connaissances
• Organiser la coordination

4 5
PLAN 2012-2016 •ISA•INFORMER•SENSIBILISER•AGIR ALCOOL, TABAC ET AUTRES DROGUES EN NOUVELLE-CALEDONIE
SOmmAIRE
4. Structurer un réseau de prise en charge
addictologique avec l’ensemble des partenaires
du système de soins
5. Développer les consultations décentralisées du centre
de soins en addictologie
B / En termes d’accompagnement et de réinsertion
1. Harmoniser le dispositif actuel en s’inspirant
de l’activité réalisé en province Nord en lien
avec les autres provinces.
2. Soutenir les actions de santé communautaire
5 / Renforcer l’application de la loi (page 20)
1. Elaborer une convention Justice-Santé
2. Intensifier des opérations de contrôles
3. Renforcer la lutte contre la production du cannabis
Accentuer la lutte contre la vente illégale d’alcool
6 / Renforcer les connaissances et accentuer
l’effort de communication (page 21)
1. Mise en place d’un observatoire permettant de mieux
appréhender les évolutions
2. Organiser des enquêtes sur les produits
et les comportements.
3. Concevoir des campagnes de communication
et d’information adaptées à la Nouvelle-Calédonie
4. Adapter les messages en fonction des typologies
et référentiels socio culturels et géographiques.
5. Développer des communications spécifiques au milieu
de l’entreprise.
6. Communiquer régulièrement avec cohérence
et en variant les cibles
7. Faire connaitre à la population adulte les normes
OMS de consommation d’alcool et les risques liés
aux différentes consommations notamment celles
des antidépresseurs
8. Pérenniser la campagne autour de la JMST
qui mobilise un réseau important et qui rassemble
les acteurs et institutions des trois provinces
9. Créer une campagne spécifique à l’alcool regroupant,
sur le modèle de la JMST, les différents acteurs
de terrains
7 / Structurer la coordination (page 21)
Constat
Nécessité d’organiser une véritable coordination
Au niveau décisionnel
Au niveau technique
Créer une cellule légère de coordination
CONCLUSION (page 22)
ANNEXES (page 23)
ANNEXE 1 HISTORIQUE RECENT (page 23)
ANNEXE 2 REGLEMENTATION NATIONALE SUR
L’ALCOOL (page 24)
ANNEXE 3 DONNEES ET RECOMMANDATIONS DE
L’OMS SUR LA CONSOMMATION D’ALCOOL
(page 29)
ANNEXE 4 REGLEMENTATION SUR LE TABAC (page 31)
ANNEXE 5 LA TAXE SUR LES ALCOOLS ET LES TABACS
(page 37)
ANNEXE 6 LA REGLEMENTATION NATIONALE SUR LES
STUPEFIANTS (page 39)
DEFINITIONS (page 6)
I / ETAT DES LIEUX (page 7)
1/ LA RÉGLEMENTATION (page 7)
1/ 1 - Réglementation sur l’alcool (page 7)
Importation
Débits de boissons
Réglementation fiscale
Mesures d’interdiction et de sanction
Publicité
Réglementation routière
1/ 2 - Réglementation sur le tabac (page 8)
A / Sur le plan sanitaire
B / Sur le plan économique et fiscal
1/ 3 - Réglementation sur le cannabis (page 10)
A / Sur le plan pénal
B / Sur le plan douanier
2/ LES CONNAISSANCES ÉPIDÉMIOLOGIQUES
DE CONSOMMATIONS (page 11)
L’âge des premières consommations
Les consommations : L’alcool - Le tabac - Le cannabis
II / DE L’OBJECTIF GÉNÉRAL… (page 15)
III / AUX MESURES POUR L’ATTEINDRE… (page 16)
1/ MODERNISER LA RÉGLEMENTATION :
CADRE D’INTERVENTION DE TOUS LES ACTEURS
A / Milieu scolaire
B / Milieu professionnel
C / Milieu sanitaire et social
D / En milieu carcéral
2/ RENFORCER LA RÉGLEMENTATION
DES PRODUITS LICITES (page 17)
A / Alcool
1. Modifier les dispositions du code de la route
2. Modifier les dispositions sur les débits de boissons
3. Modifier les dispositions sur la vente d’alcool
à emporter
B / Tabac
1. Limiter les lieux de ventes
2. Limiter les teneurs en substances nocives
3. Alourdir et modifier le système de taxe
4. Améliorer le dispositif de contrôle et de sanction,
5. Réduire la limitation des quantités autorisées
à l’importation personnelle
3/ RENFORCER LES ACTIONS DE PRÉVENTION :
1 / Décourager l’initiation et retarder l’âge
des premières consommations (page 19)
1. Re légitimer les adultes dans leur rôle éducatif
et acteur de prévention
2. Clarifier les rôles des institutions agissant
dans le domaine de la santé scolaire.
3. Coordonner la prévention en milieu scolaire
du primaire à l’Université
4. Renforcer le service de prévention en addictologie
de l’Agence Sanitaire et Sociale
5. Développer les conventionnements avec les
Communes, les entreprises et les administrations
(notamment l’administration pénitentiaire pour
la prévention et la réinsertion°.
6. Soutenir le secteur associatif et les initiatives locales.
7. Mettre à dispositions des élus et des coutumiers
une cellule d’accompagnement pour la mise en place
de projets de prévention.
8. Promouvoir les activités sportives culturelles
et sociales comme facteur de prévention.
9. Lier l’octroi de toute subvention publique à la signature
d’une charte interdisant l’alcool et limitant l’usage
du tabac sur le site de la manifestation subventionnée.
2 / Prévenir l’usage nocif (page 19)
1. Poursuivre l’effort de formation des personnes relais
dans les établissements scolaires, les administrations
et les entreprises permettant un repérage et une
orientation précoce.
2. Identifier les situations à risques (fêtes, soirées
étudiantes…) et sensibiliser les organisateurs
3. Développer le système de réponse à la demande
croissante du public jeune.
4. Création de postes d’éducateurs spécialisés dans les
établissements scolaires
3 / Agir de façon globale et cohérente
sur le problème calédonien numéro 1 : (page 20)
la sur-consommation de l’alcool et ses conséquences
• Sur la route
• Sur la voie publique
• En famille
4 / Renforcer la prise en charge sanitaire et sociale
A / En termes de soins :
1. Améliorer la couverture d’offre de soins
sur toute la Nouvelle-Calédonie
2. Renforcer la prise en charge des consommateurs
d’alcool en prévoyant des places de lits de post cure
dans les services de soins de suite et de réadaptation
(CHS et CHT)
3. Homogénéiser les aides au sevrage et
leur accessibilité à tous, indépendamment
de la localisation géographique
(page 19)
(page 16)
(page 20)

6 7
PLAN 2012-2016 •ISA•INFORMER•SENSIBILISER•AGIR ALCOOL, TABAC ET AUTRES DROGUES EN NOUVELLE-CALEDONIE
Il apparaît aujourd’hui indispensable de disposer d’un recueil
complet et codifié de la réglementation applicable. En effet, la
méconnaissance sur ces sujets est aussi large qu’est forte la
demande sociale les concernant. Ce travail a été amorcé ici
et devra être poursuivi et finalisé dans un document unique.
Avant d’aborder les questions de la réglementation
transversale aux produits, un point de situation par produit
apparaît nécessaire en distinguant les produits licites
(tabac, alcool, kava), des produits illicites et particulièrement
du cannabis qui est le seul produit stupéfiant dont la
consommation en Nouvelle-Calédonie n’est pas marginale.
1/ 1 RÉGLEMENTATION SUR L’ALCOOL
Comme le tabac, l’alcool est une drogue légale dont
la production, le commerce, la distribution et la
consommation sont réglementés.
La Nouvelle-Calédonie est compétente pour réglementer
l’alcool. Toutefois, l’essentiel de l’arsenal juridique est
inspiré de la réglementation nationale où le commerce et
la distribution des boissons alcoolisées sont réglementés
depuis plusieurs siècles, principalement depuis que ces
boissons sont taxées par l’Etat. La réglementation nationale
et les données et recommandations de l’OMS figurent en
ANNEXES 2 ET 3.
La délibération n°79 du 15 juin 2005 (modifiée) relative
à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme a fixé les
principales interdictions qui sont:
• Parrainage en faveur des boissons alcooliques
• Propagande et publicité sur les boissons alcoolisées
sauf journaux
• Vente et offre aux mineurs
• Consommation d’alcool dans les établissements scolaires
et de formation
Ce dispositif est complété par les interdictions
suivantes :
• Alcoolémie au volant à partir de 0,50 g/l prévu dans le
code la route
• Vente à emporter de boissons alcoolisées fraîches prises
par les provinces Sud et Nord
• Vente d’alcool les jours fériés et les après-midi des
week-ends et mercredi dans de nombreuses communes
par arrêté du Haut-Commissaire.
Contrairement au tabac, l’alcool ne constitue pas seulement
une préoccupation sanitaire, l’ordre public est également
concerné car les dommages en termes de délinquance
routière, de voie publique ou dans la sphère privée sont
massifs.
IMPORTATION
Aucune règlementation particulière n’existe à l’importation
en termes de quotas ou de restrictions.
Certaines interdictions qui existaient concernant les alcools
anisées ont été supprimées dans les années 1970.
DÉBITS DE BOISSONS
Les provinces sont compétentes en matière de débits de
boissons. Elles ont réglementé l’exploitation des débits
de boissons en adoptant les délibérations suivantes :
• délibération de l’Assemblée de la province Sud n°53-89/
APS du 13 décembre 1989 relative aux débits de boissons.
• délibération n°44/93 de l’Assemblée de la province Nord
du 7 avril 1993 relative au régime des boissons dans la
province Nord.
• délibération n° 96-18 du 10 mai 1996 des Iles Loyautés
portant réglementation de l’exploitation de débits de
boissons et lutte contre l’alcoolisme.
La province Sud a utilisé la possibilité de déléguer sa
compétence dans sa délibération n° 7-2000/APS du 3 mars
2000 portant délégation de compétence aux communes en
matière de débits de boissons.
La Ville de Nouméa a pu ainsi signer une convention avec la
province Sud pour la gestion de ses débits de boissons.
La province Nord et celle des Iles, n’ont pas utilisé cette
possibilité et demeurent totalement compétentes pour
instruire les dossiers en matière de débit de boissons.
Ces délibérations prévoient l’organisation des débits de
boissons, les conditions d’ouverture (avec notamment des
conditions de distance autour de certains édifices dont les
établissements scolaires) et de mutations, la procédure
d’attribution des licences. Ces délibérations se distinguent
sur plusieurs points notamment sur les sanctions prévues.
RÉGLEMENTATION FISCALE ET DOUANIÈRE
La loi du pays n°2001-014 du 13 décembre 2001 a institué une
taxe sur les alcools et les tabacs en faveur du secteur sanitaire
et social, cette taxe est variable selon les catégories d’alcool.
DÉFINITIONS 01. ÉTAT DES LIEUx
La drogue a été définie selon plusieurs approches.
Celle que nous retiendrons, compte tenu du
consensus qu’elle dégage, est celle de l’Observatoire
Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT)
qui propose la définition suivante :
«Produit psychoactif naturel ou synthétique, utilisé par
une personne en vue de modifier son état de conscience
ou d’améliorer ses performances, ayant un potentiel
d’usage nocif, d’abus ou de dépendance et dont l’usage
peut être légal ou non «.
Sur le plan médical l’Académie Nationale de
Médecine, en 2006, a adopté la définition suivante
«Substance naturelle ou de synthèse dont les effets
psychotropes suscitent des sensations apparentées au
plaisir, incitant à un usage répétitif qui conduit à instaurer
la permanence de cet effet et à prévenir les troubles
psychiques (dépendance psychique), voire même
physiques (dépendance physique), survenant à l’arrêt de
cette consommation qui, de ce fait, s’est muée en besoin.
A un certain degré de ce besoin correspond un
asservissement (une addiction) à la substance ; le
drogué ou toxicomane concentre alors sur elle ses
préoccupations, en négligeant les conséquences
sanitaires et sociales de sa consommation compulsive.
En aucun cas le mot drogue ne doit être utilisé au sens
de médicament ou de substance pharmacologiquement
active».
L’ALCOOL ET LE TABAC, MÊME S’ILS SONT D’USAGE
LÉGAL, SONT DES DROGUES, ILS RÉPONDENT EN
EFFET AUX DÉFINITIONS PRÉCÉDENTES
Les drogues sont généralement classées selon leurs
effets ou selon leur dangerosité:
Classement selon leurs effets :
Ce classement est plus particulièrement utilisé à des fins
médicales.
• Les stimulants qui stimulent le fonctionnement du
système nerveux : Tabac, Cocaïne, Crack, Médicaments
stimulants (Amphétamines et autres dopants), Ecstasy,
GHB.
• Les hallucinogènes ou perturbateurs qui
perturbent le fonctionnement du système nerveux :
Cannabis et produits dérivés ; Produits volatils (colles
et solvants, anesthésiques volatils) ; Kétamine, LSD,
champignons hallucinogènes, etc.
• Les dépresseurs qui ralentissent le fonctionnement du
système nerveux : Alcool, Médicaments tranquillisants et
somnifères (Barbituriques, Benzodiazépines...), Opiacés
(Héroïne, Méthadone, Codéine, Morphine, etc).
Classement selon leur dangerosité :
Ce classement est plus particulièrement utilisé à des fins
juridiques.
• Les substances stupéfiantes (morphine, cocaïne,
héroïne, cannabis, etc.)
• Les substances psychotropes (médicaments,
antidépresseurs, tranquillisants, hypnotiques, etc.)
• Les médicaments «inscrits sur les listes I et II».
• Les substances dangereuses (éther, acides, etc.)
Ce classement reprend principalement les règles
du classement fixées par les trois conventions
internationales de 1961, 1971 et 1988 sur le contrôle
des drogues.
Il est également important de distinguer les termes
addiction, conduites addictives et addictologie.
• L’addiction, est habituellement définie comme la
dépendance physique et/ou psychologique à une substance
ou à un comportement. La personne n’est plus en capacité
de gérer sa consommation, elle est prisonnière du produit
psychoactif (alcool, tabac ou cannabis par exemple) ou
d’un comportement qu’elle n’arrive plus à maîtriser (jeu
pathologique, achats compulsifs)
• Les conduites addictives sont susceptibles de
mener à une addiction. Ce sont des consommations
ou des comportements problématiques,
animés au départ par la recherche du plaisir
mais aboutissant rapidement à des problèmes.
Il existe en effet un continuum entre les conduites
« banales » et les conduites problématiques et il est
nécessaire de mettre une frontière aussi claire que possible
entre le normal et le problématique, et définir des repères
permettant de prédire le passage de l’un à l’autre.
• L’addictologie est la discipline qui prend en compte l’étude
des conduites addictives et des addictions. Elle ne peut en
aucune façon être réduite au domaine médical mais doit
intégrer également les dimensions sociales, culturelles,
sociétales, ainsi que la parentalité, la réglementation, la
répression, l’éducation, la formation, l’économie… Elle est
à la croisée de nombreuses disciplines s’intéressant à l’être
humain, à son histoire et à son milieu.
Quelques définitions apparaissent importantes pour la compréhension des questions
relatives aux drogues. 1/ LA RÉGLEMENTATION
La réglementation sur les drogues licites et illicites en Nouvelle-Calédonie résulte
essentiellement des lois de pays et délibérations du congrès pour l’alcool et le tabac
et du code pénal pour les drogues illicites, avec les dispositions du code de la santé
publique rendues applicables en Nouvelle-Calédonie.

8 9
PLAN 2012-2016 •ISA•INFORMER•SENSIBILISER•AGIR ALCOOL, TABAC ET AUTRES DROGUES EN NOUVELLE-CALEDONIE
commerciaux ou des épiceries générales. En métropole
à l’inverse seuls les buralistes placés sous la tutelle de
l’administration des douanes sont habilités à vendre du
tabac.
b/ La limitation de la teneur en goudron, nicotine et
monoxyde de carbone n’est pas impérative comme c’est
le cas dans la législation nationale qui prévoit que ces
teneurs maximales sont fixées par un arrêté du ministre
chargé de la santé.
c/ le contrôle et les sanctions sur la vente aux mineurs
qui demeurent perfectibles puisqu’il ressort de l’enquête
OMS de 2010 que plus de 60% des mineurs qui ont
souhaité acheter du tabac ne se sont heurtés à aucun
contrôle ou refus de vente.
A/ SUR LE PLAN SANITAIRE
Le principe d’interdiction de fumer dans les lieux publics a
été introduit progressivement. Tout d’abord dans l’enceinte
des établissements d’enseignement et de formation avec
la délibération du 26 mars 2004 puis dans les transports
collectifs et les lieux publics accueillant du public avec
la délibération du 15 juin 2005 puis à tous les lieux fermés
et couverts accueillant du public, (cafés, restaurants
boites de nuits, etc...) et tous les espaces non couverts
des établissements d’enseignement ainsi que tous les
établissements accueillant des mineurs avec la délibération
n°202 du 6 août 2012.
Un dispositif d’information (signalisation apparente) et de
sanctions (peines d’amendes de 3ème ou 4ème classe) a été mis
en place.
Les mesures sont les suivantes :
• la publicité sur le tabac est interdite,
• la distribution gratuite de tabac est interdite,
• toute opération de parrainage est interdite,
• un message sanitaire est inscrit sur chaque produit
du tabac,
• la vente du tabac est interdite aux mineurs. Une affiche
rappelant cette interdiction doit être placée à la vue du
public et apposée dans les lieux de vente. La production
d’une pièce d’identité avec photo peut être demandée par
le vendeur.
Sur le plan de la prévention et de la prise en charge,
en reprenant les termes de la délibération de 2004 :
« une information de nature sanitaire prophylactique et
psychologique en rapport avec les produits du tabac est
obligatoire dans les établissements d’enseignement primaire
et secondaire » depuis 2004 et une aide annuelle de 8000 F
par individu pour l’aide au sevrage dans le cadre d’une
consultation addictologique a été instituée en 2008.
B / SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE ET FISCAL
MONOPOLE DE VENTE ET DE DISTRIBUTION
Le monopole de la vente et de la distribution du tabac existe
en Nouvelle-Calédonie depuis 1916. Le gouvernement détient
ce monopole d’un point de vue fiscal, à travers la direction
des services fiscaux, dont dépend directement la régie des
tabacs. Cette dernière est donc l’unique importatrice du
territoire.
Le rôle de la régie n’est pas seulement d’importer le tabac ;
elle est également le seul revendeur aux professionnels
et elle perçoit les taxes incluses dans le prix de revente.
Le tabac n’est pas fabriqué en Nouvelle-Calédonie, il y
est importé par des achats à des sociétés commerciales
dont les plus importants sont Imperial-Tobacco, Philip-
Morris-International, Japan-Tobacco-International et British-
American-Tobacco.
PRIX RÉGLEMENTÉ
Le congrès qui a le pouvoir de fixer les prix du tabac a
réglementé ces prix par délibération du 14 janvier 1992.
Ces prix ont fortement augmenté (+7,2 % en moyenne annuelle
soit +60 % au total sur la période 1994-2008 (Sources IEOM).
TAXATION
La loi de pays N°2001-014 du 13 décembre 2001 a instauré
une taxe dite « taxe sur les alcools et les tabacs (TAT) en
faveur du secteur sanitaire et social ». Cette taxe est perçue
par le service des douanes et elle est recouvrée par le
Trésor Public. Le produit de cette taxe est affecté en
totalité à l’agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie
(ASS-NC). La TAT est régie par les dispositions des articles
720A à 720F du code des impôts de Nouvelle-Calédonie qui
figurent en ANNEXE 5.
La fiscalité a augmenté successivement ces dernières
années au fil des différentes délibérations traitant de de
santé publique, globalement elle s’élève aujourd’hui à plus de
50% avec les taxes douanières.
Il faut noter qu’entre 1998 et 2010, la quantité totale de tabac
achetée par la régie est passée de 320 à 399 tonnes.
RÈGLEMENT ET ÉTIQUETAGE
DES PRODUITS DU TABAC
La réglementation calédonienne est proche de celle de la
métropole. La délibération n°79 du 15 juin 2005 stipule que
« toutes les unités de conditionnement du tabac et des
produits du tabac portent un message spécifique de
caractère sanitaire». L’arrêté n°2005 1911/GNC du 28
juillet 2005 fixe les modalités obligatoires d’inscription des
avertissements de caractère sanitaire sur les unités de
conditionnement des produits du tabac.
AGENTS DE CONTRÔLE
La délibération n°140 du 26 mars 2004 relative à la lutte
contre le tabagisme identifie les agents de contrôle ainsi
que les amendes encourues en cas de non-respect de la
législation.
L’article 8 de cette délibération indique que les contrôles
doivent être le fait d’agents dûment agréés et assermentés
par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Elle précise
aussi dans quels cas des verbalisations peuvent être
effectuées selon les articles 6 « quiconque aura fumé
dans l’enceinte des établissements d’enseignement »,
7 « quiconque n’aura pas mis en place la signalisation prévue »
Sur le plan douanier, les droits et taxes frappant les
alcools sont de 4 types:
• les taxes de protection (droits de douanes et taxe
conjoncturelle de protection de la production locale),
• les taxes d’approche (taxe de base à l’importation, taxe de
péage ou taxe sur le fret aérien)
• la taxe générale à l’importation
• les taxes portant spécifiquement sur les alcools et les
tabacs. (Taxe de consommation intérieure et taxe sur les
alcools et les tabacs).
MESURES D’INTERDICTION ET DE SANCTION
• Depuis 2003 et 2004 des mesures concernant l’interdiction
de ventes de boissons alcoolisées fraîches ont été prises
en provinces Sud et Nord.
• De nombreuses communes ont également pris des
décisions visant à limiter les horaires de ventes d’alcool
durant les week-ends et les jours fériés.
PUBLICITÉ
Depuis 2005, la propagande et la publicité, directe ou
indirecte, en faveur des boissons alcoolisées sont interdites,
elles sont néanmoins autorisées dans un certain nombre
de cas précis fixés à l’article 13 de la délibération n°79 du
15 juin 2005. Les opérations de parrainage sont interdites
lorsqu’elles ont pour objet ou pour effet la propagande ou
la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons
alcooliques
A ce titre, il faut noter la précision apportée par
l’article L3323-3 du code de santé publique qui ne
figure pas dans la réglementation calédonienne :
« Est considérée comme propagande ou publicité indirecte
la propagande ou publicité en faveur d’un organisme, d’un
service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre
qu’une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa
présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque,
d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif,
rappelle une boisson alcoolique ».
La protection des mineurs a été prise en compte par la
délibération de 2005 qui prévoit l’interdiction de vendre
ou d’offrir des boissons alcooliques aux mineurs ainsi que
la consommation dans les établissements scolaires et de
formation.
RÉGLEMENTATION ROUTIÈRE
Elle est largement inspirée du code de la route national
dont les principales dispositions concernant l’alcool ont été
rendues applicables soit par ordonnance notamment celle
du 22 septembre 2000 soit par délibération du Congrès
comme la délibération n°198 du 22 août 2006 qui a instauré la
rétention du permis de conduire.
Le décret n°2007-1626 du 16 novembre 2007 portant
extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie de diverses
dispositions du code la route a abaissé le taux d’alcoolémie
toléré qui fixe les valeurs limites de concentration d’alcool
dans le sang (supérieure à 0,50 gramme par litre) ou l’air
expiré (supérieure à 0,25 milligramme par litre) prévu à l’article
L 234-1 du code de la route de Nouvelle-Calédonie. De
plus, ce décret institue une distinction plus stricte pour les
véhicules de transports en commun (concentration d’alcool
dans le sang supérieure à 0,20 gramme par litre ou dans l’air
expiré, concentration supérieure à 0,10 milligramme par litre).
» La peine encourue à partir de 0,80 gramme par litre est
de deux ans d’emprisonnement et de 545 455 F d’amende.
Le fait de conduire un véhicule en état d’ivresse manifeste
est puni des mêmes peines.
1/ 2 RÉGLEMENTATION SUR LE TABAC
La Nouvelle-Calédonie est compétente sur la
réglementation en matière de tabac que ce soit sur le
plan sanitaire (A) ou sur le plan économique et fiscal
(B).
Elle s’est largement inspirée des normes internationales
fixées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et par
la réglementation nationale. Les éléments plus précis sur les
textes calédoniens et sur le contexte international et national
figurent en ANNEXE 4
La délibération n°79 du 15 juin 2005 (modifiée) relative à la
lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme a fixé les principales
interdictions. La délibération n° 202 relative à l’interdiction de
fumer dans les lieux affectés à un usage collectif du 6 août
2012 est venue compléter récemment ce dispositif.
Les principales interdictions sont :
• Publicité et sponsoring
• Distribution gratuite
• Consommation dans les lieux publics fermés et couverts
• Vente aux mineurs
• Consommation dans les établissements privés
recevant du public (bars restaurants)
• Consommation dans les établissements d’enseignement
et ceux accueillant des mineurs
Le dispositif réglementaire calédonien apparaît relativement
complet. Il prévoit, aujourd’hui, un arsenal de mesures
fiscales ainsi que des mesures de protection de la population
dans les lieux publics, particulièrement tournés vers les
mineurs puisque les établissements qu’ils fréquentent sont
tous classés non-fumeurs et l’achat leur est interdit.
La publicité et le sponsoring sont prohibés et des messages
de prévention figurent sur les paquets de cigarettes. Enfin,
des sanctions aux contrevenants à cette réglementation
sont prévues avec des peines d’amendes de 3ème ou de 4ème
catégorie.
Il demeure toutefois un écart réglementaire important
avec des pays plus restrictifs concernant :
a/ la distribution des produits du tabac. En effet, la seule
condition pour être habilité à en vendre au détail est de
disposer d’une patente de commerçant. On trouve donc
des points de vente dans les stations service, les centres
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%