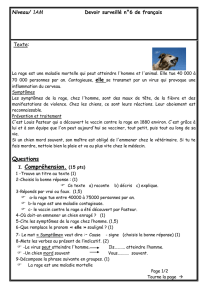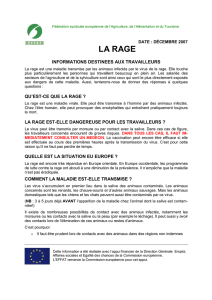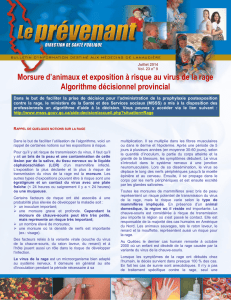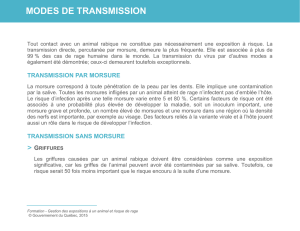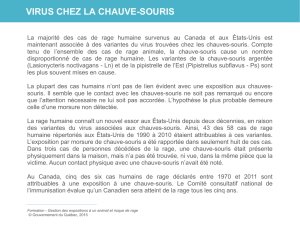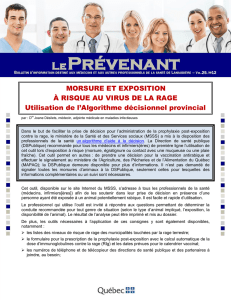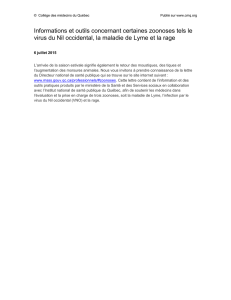LA RAGE - Collections

12345677383952
5
4691643
N0 30, 8 mars 2004
1
LAGENT
La rage est une zoonose qui produit une encéphalomyélite
aiguë fatale. Les humains et presque tous les mammifères
y sont sensibles. Les oiseaux peuvent aussi être affectés,
mais ils ne jouent pas un rôle important dans
lépidémiologie de la maladie.
Cette maladie est causée par un virus à ARN de la famille
des Rhabdoviridae et du genre Lyssavirus. Le virus rabique
se divise en plusieurs variantes. Généralement, chaque
variante est responsable de la transmission de la rage entre
individus de la même espèce dans une même région
géographique. La variante est nommée en fonction de
lespèce à laquelle elle est associée. Malgré cette
adaptation, elle peut tout de même affecter dautres
espèces, mais la chaîne de transmission est alors
généralement courte.
La rage est distribuée mondialement, et seuls quelques
pays en demeurent exempts. En Amérique du Nord, les
animaux de la faune en sont le réservoir, la rage canine
ayant pratiquement été éliminée. Les animaux sauvages
les plus susceptibles de transmettre la rage au Canada
sont les chauves-souris, les ratons laveurs, les mouffettes
et les renards roux et arctiques. Dans lOuest, les
mouffettes jouent le rôle de vecteur et de réservoir. Le
renard roux joue ce rôle dans lEst (Ontario et Québec) et
le renard arctique dans le Nord. Des chauves-souris
rabiques peuvent être retrouvées sur toute leur aire de
distribution, donc dans toutes les provinces canadiennes.
Depuis 1925, 22personnes sont décédées de la rage au
Canada et douze dentre elles venaient du Québec. Le
cas le plus récent de rage humaine au Québec a été déclaré
en 2000. Il sagissait dun Montréalais âgé de neufans qui
est décédé de la rage après avoir eu un contact avec une
LA SITUATION AU CANADA
chauve-souris. En 2003, au Québec, il y a eu 22diagnostics
positifs de la rage chez les animaux. Le tableau 1 présente
les cas de rage au Québec au cours des six dernières
années.
Tableau 1 - Nombre de cas de rage au Québec,
par espèce, 1998-2003
123456 7889 7887 788 7888
6 121111
21 1 1 1 2 7
3 1211227
66 1111227
6 31 2 3 4 1
6 53 622522
6!22 23 26 7 8 2 1
77 7 7 8 9 8
MODE DE TRANSMISSION
Le virus de la rage est présent dans la salive de lanimal
infecté. Il se transmet lors du contact de cette salive avec
une plaie (morsure ou égratignure) ou avec une muqueuse
même si celle-ci est intacte. De plus, il a été démontré
que la transmission par aérosol est possible dans les
cavernes et dans les laboratoires. Il faut demeurer prudent
lorsque lon manipule un animal mort de la rage. Le virus
devient inactif avec la progression de lautolyse, mais
pendant lhiver ou lorsquelle est réfrigérée, la carcasse
peut être porteuse du virus pendant une durée de quatre
semaines à plusieurs mois. Le virus ne survit que quelques
heures dans les sécrétions et le sang séchés. Lexposition
au sang, à lurine, aux selles, au lait et au liquide
amniotique dun animal enragé ne comporte pas de risque.
Quant au risque lié à la consommation de lait ou de viande
LA RAGE
Un cas de rage chez un bovin a été signalé en octobre 2003, dans la région de Chaudière-Appalaches.
Il sagit dune taure ayant passé lété au pâturage. Une fois entrée à lintérieur, elle a commencé à
manifester les symptômes suivants: régurgitation, hypersalivation, agressivité, polydypsie, beuglements,
piétinement des quatre membres, puis finalement décubitus latéral. Une chauve-souris porteuse de la rage
avait été découverte dans la région deux semaines auparavant. Les analyses ont démontré la présence chez la
taure dun virus de la rage apparenté à celui quon retrouve chez la chauve-souris.

provenant dun animal enragé, lAgence canadienne
dinspection des aliments indique quaucun tissu ni aucune
sécrétion dun animal cliniquement enragé ne devraient
être utilisés pour consommation humaine ou animale.
Cependant, comme la température de pasteurisation
inactive le virus de la rage, la consommation de lait
pasteurisé ou de viande entièrement cuite ne comporte
pas de risque de transmission de la maladie.
La période dincubation est variée. Normalement, le virus
demeure au site dinoculation un certain temps et il sy
réplique. Ensuite, il voyage par les nerfs périphériques,
jusquau système nerveux central. Lorsquil a rejoint le
cerveau, il voyage par les nerfs périphériques pour
rejoindre les glandes salivaires. On peut donc tenir pour
acquis que lorsque lanimal est capable de transmettre la
rage par la salive, le virus est détectable au cerveau.
Le virus peut être présent dans la salive et transmis
plusieurs jours avant lapparition de signes cliniques, soit
de 3 à 5 jours chez les chats et chiens domestiques, plus
de 8 jours chez les mouffettes et quelques semaines chez
les chauves-souris.
La période dincubation chez lhumain peut varier
considérablement, soit de 10 jours à plus dun an. Environ
75% des individus développent des signes cliniques dans
les 90 jours suivant linfection. Plus la morsure est
profonde et près du système nerveux central, plus la
période dincubation est courte. Le développement de la
rage chez une personne exposée au virus dépend du type
de morsure et de sa localisation. La quantité de virus
présente dans la salive joue aussi un rôle significatif. Les
premiers symptômes à survenir sont de la douleur et des
engourdissements au site de la morsure. Une fois le
système nerveux atteint, la rage évolue toujours vers le
coma et la mort en moins de 14 jours.
Après une morsure ou une égratignure, la plaie doit être
lavée immédiatement avec du savon et de leau pendant
plusieurs minutes. Si possible, capturer lanimal avec
précautions aux fins danalyse et consulter un médecin
sans tarder. La vaccination rapide après lexposition est
le seul traitement possible pour les personnes
potentiellement infectées. Aucun traitement entrepris
après lapparition des signes cliniques na permis de sauver
le patient. La vaccination en préexposition est dailleurs
recommandée pour les personnes qui travaillent avec des
animaux à risque.
Toutes les espèces affectées par la rage vont montrer des
signes cliniques typiques dune atteinte du système
MALADIE CHEZ LHUMAIN
2
nerveux central. Les symptômes les plus caractéristiques,
peu importe lespèce, sont un changement de
comportement et une paralysie progressive.
Les changements de comportement peuvent inclure
lanorexie, des signes dirritabilité, dappréhension, de
nervosité et dhyperexcitabilité. La forme furieuse
correspond à cette phase excitative où lanimal fait montre
dagressivité. Un animal docile peut devenir soudainement
vicieux. Les animaux sauvages perdent leur crainte de
lhomme et les espèces qui sont normalement nocturnes
peuvent être observées le jour. Ataxie, phonation altérée
et changements de tempérament peuvent apparaître.
La forme paralytique se réfère à un animal qui na pas ou
a peu de changements de comportement et chez qui la
maladie se manifeste principalement par une paralysie.
La première manifestation est la paralysie de la trachée
et des muscles masséters, qui provoque une salivation
profuse et une incapacité à avaler. Ces signes cliniques
peuvent laisser croire à la présence dun corps étranger
dans la gueule. La rage doit alors faire partie du diagnostic
différentiel et on doit éviter dexaminer la gueule de
lanimal les mains nues, sexposant ainsi à la salive.
Les bovins, tout comme les chevaux, présentent rarement
la forme furieuse. Lorsque cela se produit, ils peuvent
attaquer les humains et les autres animaux. Un signe
caractéristique est le beuglement anormal, qui peut être
continu ou intermittent, pratiquement jusquà la mort.
La production de lait chute rapidement chez les vaches
laitières. Il est inhabituel de retrouver plus dun ou deux
animaux malades de la rage dans un même troupeau car
la transmission dherbivore à herbivore est rare.
Les chevaux enragés peuvent manifester une attitude de
détresse et dagitation. Ces signes, lorsquils sont
accompagnés de roulades, peuvent être interprétés comme
des coliques, alors quil peut sagir de la rage. Comme les
autres espèces, les chevaux peuvent mordre et devenir
dangereux. Certains animaux peuvent même sautomutiler.
Les porcs enragés font des mouvements rapides de
mastication, ils souffrent souvent dincoordination et
secouent leur tête sans arrêt. Les moutons enragés
poussent des bêlements enroués, ont une tendance à
lécher les objets et deviennent combatifs.
Les renards et les coyotes enragés peuvent sapprocher
des maisons et attaquer les animaux domestiques. Les
renards atteints de rage peuvent attaquer les porcs-épics,
ce quils ne feraient pas normalement. On peut donc
suspecter la rage lorsquun renard a la gueule remplie de
poils de porcs-épics.
Les ratons laveurs et les mouffettes enragés perdent leur
peur de lhomme. Ils deviennent ataxiques, fréquemment
MALADIE CHEZ LES ANIMAUX

3
agressifs et peuvent être actifs durant le jour. Ils peuvent
aussi attaquer les animaux domestiques.
On peut suspecter la rage chez tous les mammifères
manifestant un comportement anormal. Cest donc vrai
aussi pour les chauves-souris. Il faut se méfier dune
chauve-souris active le jour, qui demeure au sol ou attaque
les humains et les animaux. De plus, il y a un risque
dinfection lorsquune chauve-souris est trouvée dans la
même pièce quune personne endormie ou un enfant laissé
sans surveillance.
La vaccination des animaux domestiques est un moyen
efficace de prévenir la transmission de la rage.
Les Directions de santé publique (DSP)
À la suite du signalement dune morsure ou dautres types
dexposition, les DSP évaluent le risque de transmission
du virus de la rage et recommandent ladministration de
la vaccination antirabique postexposition si nécessaire.
De plus, elles font des campagnes de prévention auprès
de la population.
Le ministère de lAgriculture, des Pêcheries et de
lAlimentation (MAPAQ)
Le MAPAQ concentre ses efforts sur la surveillance et la
prévention de la rage.
Le Québec est exempt de la rage de la souche virale du
raton laveur, et ce, malgré le fait quaux États-Unis on a
observé une progression de cette souche vers le Nord-Est
du pays. En 1996 a donc été créé un programme québécois
de prévention de lentrée au Québec de lépizootie de
rage de la souche virale du raton laveur. De 1997 à 2000,
le Québec a choisi de contribuer financièrement au
Programme américain de contrôle de lépizootie en créant
des barrières immunologiques dans le Nord du Vermont.
On crée ces barrières par lépandage aérien dappâts
vaccinaux. La barrière immunologique a ensuite été
prolongée au Québec, à la suite de la découverte, en 1999,
de cas au-delà de la barrière immunologique du Vermont.
En 1999, 2000 et 2001, dans lEstrie et la Montérégie, des
campagnes de vaccination orale par épandage aérien
dappâts vaccinaux ont été réalisées. En 2002, la
vaccination en territoire québécois a cessé, mais la
participation au programme américain a été maintenue.
De plus, le MAPAQ et ses partenaires demandent chaque
année à la population de certaines municipalités de la
Montérégie et de lEstrie dêtre particulièrement vigilants
et de rapporter les ratons laveurs, mouffettes et renards
trouvés morts. Il faut aussi signaler tout chien, chat, raton
RÔLE DES DIFFÉRENTS INTERVENANTS AU
REGARD DE LA RAGE
laveur, mouffette ou renard qui semble désorienté,
anormalement agressif ou paralysé. Ces signalements
peuvent être faits en tout temps à la Centrale SOS
Braconnage au numéro 1-800-463-2191.
Les pertes de bétail attribuables à la rage peuvent être
indemnisées grâce à une entente conclue entre les
gouvernements fédéral et provincial. Le Québec paie 60
% de lindemnité. Lindemnité maximale est de 1000 dollars
pour un bovin. Les animaux de compagnie sont exclus de
cette entente.
LAgence canadienne dinspection des aliments
Le mandat de lAgence canadienne dinspection des
aliments (ACIA) est de prévenir la transmission de la rage
des animaux domestiques à lhumain. Selon la Loi sur la
santé des animaux, la rage est une maladie à déclaration
obligatoire. Cette obligation a été imposée afin de prévenir
toute contamination humaine par le virus de la rage et
pour sassurer que tout contact avec un animal enragé
soit signalé aux autorités médicales.
Une enquête est instaurée sur tous les cas de morsures
signalés, afin décarter la possibilité quil sagisse de la
rage. Les animaux sont gardés 10 jours en observation
chez leur propriétaire, afin déliminer la possibilité dune
excrétion du virus avant lapparition de signes cliniques.
Lorsque lanimal ne présente pas de signes cliniques après
10 jours dobservation, on considère quil ne pouvait pas
transmettre la rage au moment de la morsure.
On mène aussi une enquête lorsquun animal domestique
entre en contact avec un animal enragé ou suspecté de
lêtre. Dans ce cas, lanimal est mis en quarantaine pour
une période de trois à six mois, selon létat de sa
vaccination, afin de contrôler la période dincubation.
Lorsque lanimal nest pas vacciné, on recommande
leuthanasie.
Aux fins de diagnostic, lACIA exécute les prélèvements
sur les animaux domestiques ou sauvages soupçonnés
dêtre atteints de la rage. Le diagnostic se fait dans un
des laboratoires de lACIA par des techniques
dimmunofluorescence directe sur du tissu cérébral.
Lorsquun médecin vétérinaire soupçonne la présence de
rage chez un animal, il doit communiquer le plus
rapidement possible avec le médecin vétérinaire de lACIA
responsable de sa région (tableau 3). Ce service est
disponible pendant les heures douverture des bureaux,
du lundi au vendredi de 8h15 à 16h30. Dans lattente
de lappel de lACIA, il importe de demeurer prudent afin
déviter tout contact avec la salive de lanimal. Ce dernier
devrait être isolé et un traitement de soutien lui être
prodigué. Lorsque la rage est suspectée, lACIA ne délivre
aucune ordonnance dabattage. Si lanimal décède

naturellement ou doit être euthanasié, la carcasse doit
être gardée au frais, à la ferme, dans lattente de la venue
du médecin vétérinaire responsable du district. Dans
léventualité où quelquun aurait été en contact avec la
salive de lanimal que lon suspecte de rage, il doit
communiquer immédiatement avec son médecin.
POUR PLUS AMPLE INFORMATION SUR LA RAGE,
COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE VET-RAIZO
4
TABLEAU 2 - LISTE DES VET-RAIZO RESPONSABLES DE
CHACUNE DES RÉGIONS POUR LE MAPAQ
♦Bas-Saint-LaurentGaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Dr Hugo Tremblay, m.v.
Tél. : (418) 698-3530 - Téléc. : (418) 698-3533
♦SaguenayLac-Saint-JeanCôte-Nord
Dr Claude Tremblay, m.v.
Tél. : (418) 668-2371 - Téléc. : (418) 669-0600
♦QuébecChaudière-Appalaches
Dr Claude Boucher, m.v.
Tél. : (418) 386-8191 - Téléc. : (418) 386-8099
Tél. : (418) 643-1632, poste 307 - Téléc. : (418) 644-6327
♦Mauricie-Centre-du-Québec (nord de lautoroute 20)
Dre Nathalie Côté, m.v.
Tél. : (819) 371-6844, poste 323 - Téléc. : (819) 371-4907
♦Estrie-Centre-du-Québec (sud de lautoroute 20)
Dre Diane Boucher, m.v.
Tél. : (819) 820-3555, poste 277 - Téléc. : (819) 820-3651
♦Montréal-Laval-Lanaudière
Dre Isabelle J. Lévesque, m.v.
Tél. : (450) 589-5745, poste 276 - Téléc. : (450) 589-0648
♦Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec
Dr Réal-Raymond Major, m.v.
Tél. : (819) 763-3287, poste 228 - Téléc. : (819) 763-3359
♦Outaouais-Laurentides
Dr Michel Bourque, m.v.
Tél. : (450) 971-5184, poste 246 - Téléc. : (450) 971-5069
♦Montérégie
Dre Mona S. Morin, m.v., coordonnatrice du RAIZO
Tél. : (450) 778-6542, poste 235 - Téléc. : (450) 778-6535
TABLEAU 3 - VÉTÉRINAIRES RESPONSABLES DES
DISTRICTS DE LA SANTÉ DES ANIMAUX À LACIA
♦Bas-Saint-LaurentGaspésie-Les Îles
Dre Hélène Gagnon, m.v.
Tél. : (418) 722-3032 - Téléc. : (418) 722-3063
♦SaguenayLac-Saint-JeanCôte-Nord
Dr Jean-Luc Dubois, m.v.
Tél. : (418) 698-5506 - Téléc. : (418) 698-5765
♦QuébecCôte-Nord-Chaudière-Appalaches
Dr Richard Bousquet, m.v.
Tél. : (418) 833-0850 - Téléc. : (418) 833-0115
♦Mauricie-Bois-Francs-Nord
Dr Gilles Rivest, m.v.
Tél. : (819) 371-5207 - Téléc. : (819) 371-5268
♦Estrie
Dr Claude Pigeon, m.v.
Tél. : (819) 564-5509 - Téléc. : (819) 564-5511
♦Montréal-Laurentides-Lanaudière
Dre Hélène Laliberté, m.v.
Tél. : (450) 476-1223 - Téléc. : (450) 476-1416
♦Montérégie-Est
Dr François Lagacé, m.v.
Tél. : (418) 773-7629 - Téléc. : (418) 773-7786
♦Montérégie-Ouest
Dr Jean-Guy Hurtubise, m.v.
Tél. : (418) 246-4123 - Téléc. : (418) 246-3804
♦Abitibi-Témiscamingue
Dre Josée Trépanier, m.v.
Tél. : (819) 762-5211 - Téléc. : (819) 762-2560
♦Bois-Francs-Sud
Dre Lise Dussault, m.v.
Tél. : (819) 752-5354 - Téléc. : (819) 752-2904
♦Outaouais
Dr Benoît Paquette, m.v.
Tél. : (819) 997-2919 - Téléc. : (819) 994-5096
Avec la participation du
Dr André Vallières, d.m.v.
Lutte contre les maladies
Agence canadienne d’inspection des aliments
1234546472845928773824782587
1232456789
www.agr.gouv.qc.ca/qasa/cqiasa/insa.htm
Auteurs
Dre Nathalie Côté, m.v., IPSAV, vet-RAIZO
Téléphone : (819) 371-6844, poste 323
Courriel: nathalie.cote@agr.gouv.qc.ca
Dre Chantal Vincent, m.v., coordonnatrice aux zoonoses
Téléphone : (418) 380-2100, poste 3110
Courriel : chantal.vincent@agr.gouv.qc.ca
Dr Michel Major, m.v., IPSAV, coordonnateur aux
mesures durgence en santé animale
Téléphone : (418) 380-2100, poste 3123
Courriel : michel.major@agr.gouv.qc.ca
Responsable des produits dinformation du RAIZO
Dre France Desjardins, m.v.
Téléphone: (418) 380-2100, poste 3115
Courriel: france.desjardins@agr.gouv.qc.ca
Conception
Mme Manon Tanguay, agente de secrétariat
Courriel: manon.tanguay@agr.gouv.qc.ca

QUE FAIRE SI ON SUSPECTE LA RAGE?
LORS DUN CONTACT SUSPECT (AVEC OU SANS MORSURE) AVEC UN ANIMAL
POTENTIELLEMENT INFECTÉ DU VIRUS DE LA RAGE:
ØSil y a morsure ou égratignure: laver la blessure avec de leau et du savon pendant
10minutes.
ØCommuniquer rapidement avec le service Info-Santé CLSC.
ØLorsque lanimal est disponible pour observation ou pour analyse, aviser
immédiatement un médecin vétérinaire de lACIA (tableau 3). Les animaux
domestiques sont gardés 10 jours en observation chez leur propriétaire, afin
déliminer la possibilité dune excrétion du virus avant lapparition de signes
cliniques.
LORS DUN CONTACT ENTRE UN ANIMAL DOMESTIQUE ET UN ANIMAL
POTENTIELLEMENT INFECTÉ DU VIRUS DE LA RAGE :
ØPorter des gants et nettoyer la morsure ou légratignure avec de leau et du savon.
ØCommuniquer avec le médecin vétérinaire de son district de lACIA (tableau 3). Les
animaux sont mis en quarantaine pour trois à six mois, selon létat de leur
vaccination, afin de contrôler la période dincubation. Lorsque lanimal nest pas
vacciné, on recommande leuthanasie.
ØLorsquil sagit dune vache laitière, ne pas consommer de lait cru.
ØSe rappeler de faire vacciner son animal régulièrement. Cest le meilleur moyen
de prévention.
LORSQUUN ANIMAL SAUVAGE OU DOMESTIQUE SEMBLE ATTEINT DE LA RAGE:
ØIsoler lanimal et éviter tout contact avec lui.
ØSignaler le cas à un médecin vétérinaire de lACIA (tableau 3). Aux fins de diagnostic,
lACIA exécute les prélèvements sur les animaux domestiques ou sauvages soupçonnés
dêtre atteints de la rage.
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES :
ØLes travailleurs les plus exposés à la rage devraient se faire vacciner.
ØLes animaux domestiques doivent être vaccinés contre la rage.
ØNe pas toucher, ni prendre un animal domestique errant.
ØÉviter les animaux sauvages qui ont un comportement anormal ou qui ont lair
malade.
ØNe pas nourrir ni caresser un animal sauvage.
ØNe pas toucher à mains nues une carcasse danimal mort ou malade.
ØÉloigner les ratons laveurs, mouffettes et chauves-souris des habitations et des
lieux abritant des animaux domestiques, par exemple en bloquant les voies daccès
aux bâtiments et aux poubelles.
1
/
5
100%