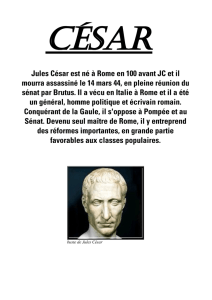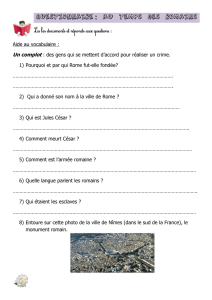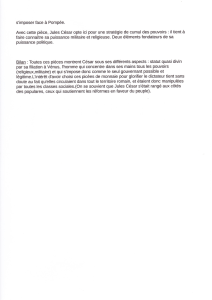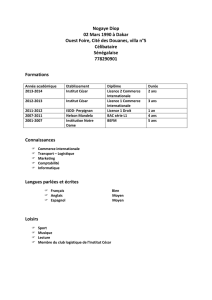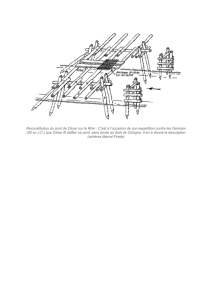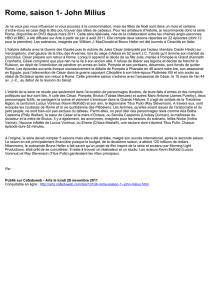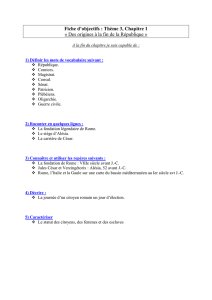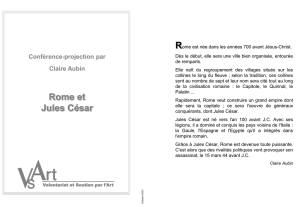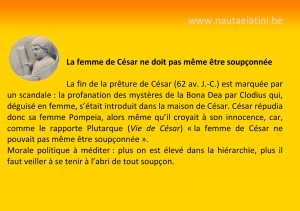césar - L`Histoire antique des pays et des hommes de la Méditerranée

CÉSAR
AN DE ROME 710.
ALPHONSE DE LAMARTINE
Soyons sans pitié pour la gloire, cette grande corruptrice du jugement humain,
lorsqu’elle n’est pas le reflet de la vraie vertu. Telle est la première réflexion qui
se présenté quand, après avoir étudié avec l’impartialité de la distance, le génie,
les circonstances, l’époque, la patrie, les exploits, la politique de César, on
entreprend de peindre le plus accompli, le plus aimable et le plus dépravé des
Romains et peut-être des hommes.
Mais il faut comprendre Rome pour comprendre César.
Le principe de ce qu’on a appelé la république romaine, dans des siècles où le
mot république signifiait seulement l’État, n’était ni le juste ni l’honnête : c’était
le patriotisme.
Le patriotisme se confond, quelquefois avec le juste et l’honnête, quand il se
borne à aimer, à défendre, à conserver la patrie, c’est-à-dire cette portion
héréditaire de sol, patrimoine de la portion de famille humaine qu’on appelle une
nation. Mais le patriotisme ambitieux, envahisseur et insatiable, qui ne reconnaît
que son intérêt personnel pour droit dans le monde, qui méprise et qui violente
les autres droits de nationalités, égaux chez tous les hommes, et qui se fait de
ces violences une gloire inique dans la postérité, ce patriotisme n’est qu’un
égoïsme colossal, un principe court, brutal, improbe, portant dans ses succès
mêmes sa condamnation et le germe de sa ruine.
Les premiers Romains, horde de brigands avant d’être peuple, ayant été obligés
par leur bannissement et leur expatriation de se réfugier dans les montagnes du
Latium, d’y bâtir une ville, et d’y conquérir un à un tous les territoires de leurs
voisins pour élargir leur patrie, avaient été naturellement induits par cette
origine à faire de ce féroce patriotisme le principe unique, la vertu et presque la
divinité de Rome. Comme toutes les fausses vertus, ce patriotisme avait légitimé
ses crimes par des axiomes. La conquête sans limites, la subjugation incessante
du monde, la spoliation de l’univers, les triomphes effrontés où la nation étalait,
au lieu d’en rougir, ces dépouilles, avaient été de siècle en siècle la conséquence
de ce principe ; la guerre perpétuelle en avait été le moyen. La fortune, et cela
est fréquent, comme pour éprouver la foi et démentir la Providence, avait asservi
une grande partie de l’univers alors connu des Romains.
L’origine illégitime de ce peuple, qui explique l’insatiabilité de ses conquêtes,
explique aussi la nature tumultueuse de son gouvernement. Comme tous étaient
égaux de crime, d’exil et de brigandage dans leur repaire devenu depuis la ville
éternelle, l’égalité de tyrannie entre les fondateurs de la cité, l’égalité de
servitude entre les vaincus, s’étaient profondément imprimées dans leurs âmes.
Ils n’avaient pas pu supporter longtemps la discipline de leurs rois ; ils avaient
monopolisé dans un sénat le pouvoir, par droit de richesse et de prépondérance

entre les membres de leurs principales familles, sans s’inquiéter des droits du
reste du peuple.
Peu à peu le peuple grandissant avait réclamé, les armes à la main, sa part de
puissance. On lui avait accordé des comices, des tribuns, des droits électoraux,
des magistratures propres, qui le rendaient l’égal du sénat ; mais ce peuple,
aussi égoïste et aussi exclusif que les grands, avait borné à lui-même l’exercice
des droits des citoyens romains.
C’étaient deux oligarchies rivales, l’une dans le sénat, l’autre dans le Forum, se
combattant pour s’arracher leurs privilèges, ou se conciliant pour imposer
ensemble leur joug à la plèbe et aux provinces ; ce n’était point une république
telle que nous entendons aujourd’hui, par ce mot, le gouvernement représentatif
organisé du peuple tout entier. Cette idée d’égalité, de représentation dans le.
pouvoir politique pour assurer l’égalité du droit dans l’ordre civil, n’était pas née
encore dans le monde romain. Elle devait naître d’une religion meilleure,
distributrice de l’équité divine entre les classes. Seul, l’esclavage, admis alors
partout, protestait contre l’établissement d’une démocratie véritable.
Rome, avec ses deux tribunes, ses deux aristocraties, ses deux consuls annuels,
ses comices, ses tribuns, ses sénatus-consultes, ses plébiscites, ses brigues de
suffrages, ses luttes intestines, ses guerres civiles, ses dictatures, tyrannie à
temps pour interposer la force entre les anarchies, avait été un éternel orage.
Mais cet orage avait répandu sur le monde les plus beaux éclairs d’éloquence, de
génie, de courage et de vertu. Tant que Rome avait été à l’étroit dans l’Italie, ou
tant qu’elle avait eu à conquérir en Sicile, en Espagne, en Grèce, en Asie
Mineure, en Égypte, à Carthage, la nécessité du salut commun ou la tension de
l’ambition commune avait ajourné les grandes luttes intestines, seule cause de
mort des nations.
Mais quand Carthage fut conquise par les Scipions, la dernière vertu de la
république, le génie soldatesque nourri par Rome dans ses légions pour asservir
l’univers se retourna contre elle. C’est la loi du talion contre les peuples libres qui
veulent en même temps être des peuples conquérants : ils se blessent tôt ou
tard et ils se tuent avec l’épée qu’ils ont tirée contre le monde. Le sénat et le
peuple eurent à compter avec les légions et les généraux, habitués à commander
chez les autres et ne sachant plus obéir aux lois dans leur patrie.
Le temps, en outre, avait développé dans l’intérieur de l’Italie et dans la
constitution même de la république des dissensions organiques et des questions
sociales qui ne pouvaient se trancher que par la, guerre civile. C’est le jugement
des causes insolubles. La plus grave de ces questions était la loi agraire.
La loi agraire, levier habituel de tous les tribuns qui voulaient soulever le peuplé
et la plèbe, depuis les Gracques jusqu’à Clodius, Catilina et César, n’était
nullement ce rêve impraticable du partage arbitraire de la terre en portions
égales, lit de Procuste où des législateurs chimériques prétendraient
éternellement niveler ce que la nature tend éternellement à inégaliser selon le
travail, l’épargne, le nombre et l’aptitude intellectuelle et physique de la famille.
Le bon sens romain, essentiellement législatif et agricole, n’avait pas de telles
aberrations du juste et du possible. La loi agraire signifiait seulement la
distribution, soit gratuite aux familles de vétérans, soit par les enchères aux
familles rurales, des territoires à cultiver conquis et possédés en Italie et ailleurs
par l’État, et qu’on appelait l’ager publicus, les biens territoriaux de l’État. Ces
territoires, non encore distribués ou vendus aux citoyens, étaient affermés à long

bail par la république à des colons cultivateurs qui voulaient changer leur
fermage contre un titre inaliénable de propriété.
Les patriciens opulents s’étaient abusivement emparés, à titre d’usurpation, de
ces terres, qu’ils faisaient cultiver par des métayers, leurs sous-fermiers, ou par
leurs innombrables esclaves. Ils refusaient de restituer ces biens qui ne leur
appartenaient, en réalité, que par l’usage et la déshérence. Le peuple, la plèbe et
les légions voulaient forcer le sénat à les exproprier avec indemnité pour donner
un cours libre à cette richesse en sol usurpé ou stérile. Les tribuns, agitateurs du
peuple, les démagogues, meneurs de la plèbe, les ambitieux, flatteurs de la
multitude, les généraux complaisants des légions, pour s’attirer la faveur des
camps, soutenaient le parti populaire contre le sénat.
Voilà toute la loi agraire. La cause était juste au fond et le résultat salutaire ;
seulement la dépossession des patriciens et des riches était d’une extrême
vexation. Les tribuns eux-mêmes sentaient la doublé difficulté de mécontenter
l’aristocratie en la dépouillant, sans indemnité, d’une possession héréditaire sur
laquelle mille autres possessions d’exploitation s’étaient fondées, ou d’aliéner le
peuple en lui demandant de voter cette indemnité nécessaire. Les biens des
proscrits des guerres civiles faisaient partie de cet ager publicus. Les distribuer
ou les vendre au peuple, c’était prononcer l’éternité de la proscription et de la
confiscation. On reculait devant cette irrévocabilité de l’exil et de l’indigence des
proscrits d’hier, qui pourraient être les proscripteurs de demain. Cela
ressemblait, sous ce rapport, à la discussion sur l’indemnité des émigrés en
France à l’époque de la restauration : mesure irritante et calmante à la fois, que
le gouvernement de la restauration eut l’audace d’aborder et la gloire d’accomplir
sans guerre civile, et en étouffant, au contraire, un germe perpétuel de
représailles. Cette loi agraire de la France agita le peuple et le sauva malgré lui,
comme l’indemnité demandée au peuple romain, préalablement à la loi agraire,
aurait sauve Rome.
Une cause de dissension qui se confondait avec celle de la loi agraire était
l’extension du titre de citoyen romain, demandée avec justice par les habitants
des villes libres et refusée avec insolence ou accordée avec parcimonie par le
sénat ou par le peuple.
A ces grands éléments de trouble au cœur de la république il faut ajouter la
dépravation déjà monstrueuse des mœurs, l’accumulation scandaleuse des.
richesses dans quelques familles, telles que les Crassus ou les Lucullus,
possédant des provinces entières et jusqu’à quarante mille esclaves ; l’indigence
des autres, vendant tout, même leur conscience et leur suffrage, à qui voulait les
acheter ; la religion, simple hypocrisie d’État, conservant au peuple des augures,
des prêtres et des dieux comme des habitudes ou des spectacles pour amuser la
populace ; une capitale immense, dont le trésor public nourrissait gratuitement
une plèbe de quatre tant mille prolétaires, armée oisive, toujours prête aux
servitudes ou aux séditions ; des corporations de trois cent mille ouvriers
formant autant de factions délibérantes qu’il y avait de métiers dans Rome,
ateliers nationaux en permanence où chaque parti allait recruter ses
vociférateurs ou ses combattants ; des jeux publics, des théâtres, des cirques,
des troupeaux de bêtes féroces, des armées de gladiateurs entretenus aux frais
de l’État ou des citoyens ; le peuple dans une tumultueuse oisiveté ; des tribunes
ouvertes dans tous les carrefours aux agitateurs de la ville pour les murmures,
les plaintes, les calomnies ; les séditions des citoyens, de la plèbe, des affranchis
et même des esclaves ; enfin des légions nombreuses de soldats ou de vétérans,

véritables cités dans la cité, inféodées comme une clientèle à tel ou tel général
pour les besoins de leur gloire ou de leur ambition, et venant imposer tour à tour
au sénat et au peuple qui les soldaient un ordre humiliant ou des désordres
sanguinaires.
Telle était la situation de la république aux temps où César grandissait pour la
détruire.
Il était né entre les proscriptions de Marius, le bourreau des nobles, et les
proscriptions de Sylla, le bourreau des plébéiens. Cette date explique ses
ambitions et son impiété envers une telle liberté. Le premier sentiment qui dut se
lever dans son âme fut de désespérer de la république. Un grand homme
vertueux aurait rêvé de la réformer et de la rasseoir ; un grand homme dépravé
devait rêver de l’asservir et de s’en emparer.
La nature et la fortune avaient façonné l’homme pour le rôle. Il avait tout ce qui
séduit les hommes et tout ce qui les subjugue : un grand nom, une grande
beauté, un grand génie, un grand caractère. On peut dire de lui seul qu’il était né
populaire.
Sa famille était des plus antiques de Rome, où l’antiquité de la race était une
consécration aux yeux du peuple. Son sang se confondait avec celui des dieux.
La première fois qu’il parla en public, aux funérailles de sa tante, il énuméra
fièrement lui-même ses aïeux comme des titres à l’attention publique : Mon
aïeule maternelle, dit-il, descendait d’Ancus Martius, la souche des rois de Rome
; la famille Julia, à laquelle s’affilie la mienne, descend de Vénus elle-même. Je
réunis donc dans mon sang quelque chose de la majesté des rois, si puissants
parmi les hommes, et de la majesté des dieux, qui sont les maîtres des rois !
La richesse de cette maison répondait à son antiquité,. Elle possédait
d’immenses domaines ruraux dans le Latium, une vaste clientèle dans Rome,
l’habitude héréditaire des grandes charges, des milliers d’esclaves dans ses
terres, un palais et des jardins somptueux dans la Via Suburra, le quartier
sénatorial des vieux patriciens. Son père, qui mourut jeune, le laissa, sous la
tutelle de sa mère, maître d’une liberté et d’une opulence précoces. A seize ans,
il commençait à attirer l’attention sur lui par son nom, par sa figure, par ses
prodigalités et par sa familiarité noble avec le peuple. La séduction irrésistible de
Vénus, de qui il prétendait descendre, semblait se retrouver en caractères plus
virils dans ses traits. Sa taille était élevée, mince et souple ; il marchait à pied
dans les rues de Rome plutôt qu’en litière, pour se faire admirer des femmes et
bien venir du bas peuple par cette affectation d’égalité. Son costume, élégant
dans sa négligence, était calculé pour faire ressortir les agréments de sa
personne : une ceinture lâche, dont le nœud retombait à demi dénoué sur ses
jambes comme une ceinture de femme, lui donnait l’apparent abandon dont les
hommes sévères de Rome accusaient les jeunes voluptueux, hommes à la
ceinture dénouée (homines decincti). Il pensait que cette affiche de licence de
mœurs dans la jeunesse ne déplaisait pas au peuple, qui avait du goût ou de
l’indulgence pour les Alcibiades, comme si un peu de vice devait toujours entrer
dans la grâce dé ses favoris. L’austérité mettait trop de distance entre le plébéien
et le patricien ; la licence rapprochait : elle donnait aux uns le besoin
d’indulgence, aux autres le droit de familiarité.
L’instinct divinatoire du jeune César lui avait appris ce mystère des popularités
consommées. L’amour du plaisir et la vanité de l’adolescent l’aidaient d’eux-
mêmes à jouer naturellement ce rôle délicat entre la popularité et le mépris, où

souvent la popularité glisse. Il soignait sa beauté non seulement comme un
attrait, mais comme une force.
Sa chevelure flottante, toujours lissée avec le peigne aux dents d’ivoire,
parfumée d’huile odorante, ramenée du sommet de la tête sur le front et sur les
tempes, et retenue par un bandeau, dérobait aux regards le seul défaut de sa
figure, le front chauve avant les années. Ce front était modelé comme par le
pouce du statuaire : la parfaite harmonie des facultés, se jouant dans une facilité
qui les accomplit toutes, n’y laissait ni froncement, ni protubérance, ni ride ; il
pensait sans qu’on le vît réfléchir, tant la pensée en lui était rapide, naturelle et
spontanée 1 Sa peau blanche était épilée avec raffinement sur la poitrine, sur les
joues et sur les jambes nues. Ses yeux étaient noirs dans le repos ; dans
l’émotion ils se teintaient, disent ses peintres, de nuances mélangées et de jets
de feu qui en rendaient la couleur incertaine ; ils semblaient lancer le regard
comme un trait, aussi loin et aussi profondément qu’il voulait atteindre. Ses
joues avaient la pâleur de l’étude ou de la volupté fatiguée. Sa bouche, bien
ouverte et souriante, n’avait ni sévérité, ni contention, ni dédain ; des paroles
gracieuses en coulaient de source. Sa voix sonore et bien timbrée s’entendait de
loin sans effort ; la bienveillance en tempérait l’accent. Son geste participait de
ce désir universel de plaire : il tendait la main avec cordialité à ceux qui le
saluaient par son nom, quel que fût le rang du sa lueur, et il la pressait
légèrement ou avec force, selon la convenance ou l’amitié.
Tel était César à dix-sept ans : déjà regardé des vieillards, envié des jeunes
gens, idolâtré des femmes, caressé du peuple, promis aux précoces fonctions des
hautes magistratures, studieux, lettré, éloquent, débauché, aspirant à toutes les
supériorités, même à celle des vices, né pour être le salut ou la perte de sa
patrie.
C’était pendant les dernières années de la dictature du vieux Sylla, qui avait fait
triompher non un ordre durable, mais une tyrannie précaire sur une autre
tyrannie. Les agitations suscitées par les Gracques, patriciens factieux passés
aux séditions du peuple et abandonnés par leurs complices à la vengeance des
patriciens ; la dictature de Marius, démagogue soldatesque sans génie et sans
vertu, mort d’excès de vin après des excès de sang contre la noblesse, avaient
lassé le peuple lui-même de ses convulsions. Sylla, général heureux, patricien
implacable, avait saisi la dictature, sans chercher à pacifier ou à réformer la
république ; Sylla, représaille vivante de Marius, avait repris pour toute politique
l’égorgement. Seulement il avait égorgé les démagogues et les plébéiens, au lieu
d’égorger les sénateurs et les nobles. La dictature n’avait été qu’une longue
consternation du parti vaincu. La république, incapable de vivre de vertu, vivait
de stupeur.
Une autre représaille, après la mort de Sylla, ne pouvait manquer de succéder à
la représaille de cet aristocrate vengeur du sénat. Déjà même les premiers
symptômes d’une réaction populaire révélaient une fermentation civile sous la
main de fer de Sylla. Quelques jeunes nobles, à l’imitation des Gracques, tels
que Dolabella, Lepidus, Crassus, César, Catilina, prêtent leur voix au peuple
abattu et briguent la popularité aux dépens de leur ordre.
Le peuple aime naturellement les tribuns qui lui viennent dé haut et qui lui
paraissent généreux en adoptant sa, cause. Les démagogues sortis du peuple lui
sont suspects de chercher fortune ou importance dans les révolutions ; lés
aristocrates populaires apportent au peuple en force et en prestige plus qu’ils ne
lui demandent, ils lui imposent en outre un respect que ne lui inspirent pas ses
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
1
/
131
100%