Le Livre d`Abraham et l`égyptologie moderne

Le Livre d’Abraham
et l’égyptologie moderne
Marcel Kahne
Réflexions préliminaires
De tous les fondateurs de religions, Joseph Smith a été le seul à affirmer avoir traduit
trois documents qu'il prétend être authentiquement historiques (le Livre de Mormon, la
section sur Énoch dans le Livre de Moïse et le Livre d'Abraham), fournissant ainsi au
monde scientifique une occasion en or de le confondre s'il était un faussaire, et à
l'humanité un puissant témoignage concret de l'existence de Dieu, et de la véracité de
l'œuvre, si ses dires se confirmaient.
Il est en effet impossible à qui que ce soit de créer un faux historique, surtout s'il le situe
dans un passé lointain et dans une autre civilisation que la sienne, sans être
immédiatement démasqué. Chaque mot, chaque expression, chaque phrase, chaque
idée, aussi anodins qu'ils paraissent, sont autant de pièges (cf. « Le Livre de Mormon vu
par un auteur de science fiction », d'Orson Scott Card). D'une part il est impossible de
penser à reproduire chacun des innombrables détails culturels qui doivent transparaître
dans le texte ancien - en admettant qu'on les connaisse tous - , d'autre part le faussaire
est incapable d'éliminer les indices de sa propre culture qu'il intègre inconsciemment dans
son texte. Le faussaire sans instruction sera repéré dès le premier mot. Le faussaire érudit
sera peut-être un peu plus difficile à démasquer, mais le temps jouera à coup sûr contre
lui, car la science est ainsi faite que les nouvelles découvertes viennent remettre en
question les certitudes du passé. Autrement dit, ce qui aurait semblé vrai à un érudit de
1830 se révélerait être faux à la fin du 20ème siècle, et chaque nouvelle découverte serait
un argument de plus contre lui.
Inversement, chaque touche juste apparaissant dans le texte doit s'expliquer. S'il n'y en
a qu'un très petit nombre, on pourra les considérer comme des coups de chance. Mais
dès l'instant où ce nombre devient plus important, le calcul des probabilités se met à jouer
en faveur de l'authenticité du document. Les chances pour qu'un faussaire tombe juste 10
ou 15 fois sont déjà très faibles. Lorsque des centaines de touches sont justes (surtout si
« l'auteur » n'avait pas accès à l'information à son époque), les chances de falsification
deviennent infinitésimales.
Or c'est le cas pour les documents publiés par Joseph Smith. Non seulement ses

« coups de chance » sont très nombreux, mais la recherche scientifique vient
régulièrement apporter de nouveaux éléments qui augmentent leur nombre.
Hugh Nibley, professeur à l'université Brigham Young, a été le premier à mettre en
évidence de nombreuses touches authentiques dans le Livre de Mormon (« Lehi in the
Desert and The World of the Jaredites », 1952, « An Approach to the Book of Mormon »,
1964, et « Since Cumorah », 1967), dans l'histoire d'Enoch du Livre de Moïse (« A Strange
Thing in the Land », série d'articles parus dans l'Ensign 1976-1977), et dans le Livre
d'Abraham (« A New Look at the Pearl of Great Price », série d'articles parus dans
l'Improvement Era, de janvier 1968 à juillet 1970, « The Message of the Joseph Smith
Papyri », 1975, et « Abraham in Egypt », 1981), ainsi que dans d'innombrables articles.
En 1976, Lynn et Hope Hilton, après une étude minutieuse de 1 Néphi, allaient sur le
terrain et suivaient l'itinéraire probable de Léhi et de sa famille de Jérusalem jusqu'à
l'océan Indien, ramenant une foule d'informations confirmant le récit du Livre de Mormon,
notamment la découverte probable du lieu-dit Nahom (1 Néphi 16:34). Conclusions
confirmées et précisées par des recherches sur place de Warren et Michaela Aston, en
1986 et 1989.
A partir de 1980, un certain nombre de chercheurs, beaucoup d'anciens élèves de Hugh
Nibley, qui ont poussé plus loin dans les nombreux domaines où celui-ci avait ouvert des
portes, et surtout qui sont devenus de véritables autorités dans leur domaine, se sont
groupés dans la Foundation for Ancient Research and Mormon Studies (F.A.R.M.S.), dans
le but de faire connaître au grand public les résultats de recherches d'un haut niveau
professionnel, qui ne sont habituellement accessibles que dans des revues spécialisées
lues par un nombre restreint d'érudits. Ces chercheurs ont publié à ce jour beaucoup
d'ouvrages dont le nombre ne cesse de croître. Entre autres :
John L. Sorenson, « An Ancient American Setting for the Book of Mormon » (1985),
résultat de 30 années de recherches sur le terrain, montrant que le Livre de Mormon
s'adapte parfaitement, géographiquement et archéologiquement, à une section précise de
l'Amérique centrale. John Clark a récemment publié le modèle théorique de la topographie
du Livre de Mormon, constitué à partir des données du livre, qui s'adapte comme un
calque sur le territoire en question.
Stephen D. Ricks et William J. Hamblin, « Warfare in the Book of Mormon » (1990), une
étude sur la guerre, la stratégie et les armements dans le Livre de Mormon, avec des
comparaisons avec les techniques antiques et méso-américaines.
John W. Welch, « Chiasmus in the Book of Mormon » (BYU Studies, 1969) : mise en
évidence d'un procédé de style propre au monde antique et surtout aux Hébreux,
redécouvert après l'époque de Joseph Smith, et présent dans le Livre de Mormon sous
des formes extrêmement élaborées.
John Tvedtnes, « A Nephite Feast of Tabernacles » (1978) et John Welch, « King
Benjamin's Speech in the Context of Ancient Israelite Festivals » (1985) dégagent les fêtes
religieuses juives qui, sans être mentionnées explicitement dans le Livre de Mormon,
apparaissent en filigrane dans certains passages.
Voilà quelques exemples parmi une véritable avalanche de découvertes résultant de
travaux récents. Il ne se passe pas six mois sans que de nouvelles informations
paraissent, confirmant telle ou telle facette du Livre de Mormon.

Il revient à chacun de décider, après étude de ces documents, s'il les considère comme
convaincants ou non. Mais désormais, plus personne ne peut soutenir valablement que
les œuvres publiées par Joseph Smith sont son invention ou celle d'un de ses
contemporains érudits. Ceux qui veulent attribuer aux Écritures modernes une origine
purement humaine auront de plus en plus de mal à s'en expliquer.
Le Livre d’Abraham
Il n'y a pas de réponses simples aux questions relatives à la civilisation égyptienne. « Il
ne faut jamais oublier que nous avons affaire à une civilisation vieille de milliers d'années,
une civilisation dont il n'est resté que des fragments minuscules. Ce que l'on présente
fièrement comme de l'histoire égyptienne n'est rien d'autre qu'un recueil de bribes et de
morceaux » (Alan H. Gardiner, « Egypt of the Pharaohs », Oxford, Clarendon Press, 1964,
p. 53). Les ouvrages de grande vulgarisation, de par leur nature même, ne révèlent que
très peu de l'énorme complexité des choses. De même, les quelques explications qui
suivent ne sont que des bribes de tout un traité sur la question. Toutes les citations
proviennent des ouvrages du professeur Nibley mentionnés plus haut.
I. La transmission du texte
Comment un manuscrit écrit de la main d'Abraham - en égyptien de surcroît - a-t-il pu
se retrouver, plus de 1500 ans plus tard, nanti de vignettes qui lui sont largement
postérieures (la première et la troisième remontent à la 17ème Dynastie, la seconde -
l'hypocéphale - date de la période saïte, 7ème-6ème siècles) dans une tombe thébaine
avec des papyrus qui datent clairement du 2ème siècle avant Jésus-Christ ?
M. A. Korostovstev note que « un moyen infaillible pour un Égyptien de traverser les
siècles était d'attacher son nom à un texte » C'est peut-être la raison pour laquelle
Abraham choisit ce moyen essentiellement égyptien pour transmettre son livre. Du moins,
c'est sous cette forme qu'il est parvenu jusqu'à nous. Theodor Böhl a récemment observé
que l'unique chance que la littérature patriarcale pourrait jamais avoir de survivre serait de
la rédiger sur des papyrus égyptiens. En égyptien, naturellement.
Est-ce l'original ?
Il faut tenir compte de deux particularités qui sont étrangères à notre mode de pensée :
Dans la pensée égyptienne ou hébraïque, toute copie d'un livre écrit à l'origine par
Abraham serait considérée et désignée dorénavant comme étant l'œuvre même de sa
main, quel que soit le nombre de reproductions faites et transmises au cours des années.
Si c'était Abraham qui avait donné l'ordre d'écrire le livre, il serait considéré comme l'ayant
écrit lui-même. Quand un livre saint (ordinairement un rouleau de cuir) était vieux et usé
par la manipulation, il n'était pas détruit, mais renouvelé. Le vieux livre n'est pas remplacé
par un nouveau, c'est l'original qui poursuit son existence, rajeuni. Selon Spiegel, pour
l'Égyptien, « il n'y a pas de différence essentielle entre un original et une copie. Car selon
sa façon de voir les choses, toutes les images ne sont que des reproductions d'un original
idéal. »
Comment ce document se trouvait-il en compagnie d'un ouvrage écrit par Joseph, son

arrière-petit-fils (également un immigrant en Égypte) ?
Un passage du Livre des Jubilés (découvert en 1850) raconte que, tandis qu'il vivait en
Égypte, Joseph « se souvint du Seigneur et des paroles que Jacob, son père, lisait d'entre
les paroles d'Abraham. » Voilà qui dit clairement que les paroles d'Abraham étaient
transmises sous forme écrite de génération en génération, et étaient étudiées
sérieusement dans le cercle familial. La même source nous apprend que quand Joseph
mourut et fut enseveli en Canaan, « il donna tous ses livres et les livres de ses pères à
Lévi, son fils, pour qu'il les conservât et les renouvelât pour ses enfants jusqu'à ce jour. »
Ici « les livres des pères », y compris « les paroles d'Abraham », ont été conservés pour
une génération future par un processus de renouvellement. Les livres de Joseph étaient,
bien entendu, des livres égyptiens.
Comment l'Hébreu Abraham aurait-il pu dessiner les vignettes ?
Quand Abraham nous dit : « Pour que vous vous fassiez une idée de ces dieux, je vous
en ai donné la représentation dans les figures qui sont au début », nous ne devons pas
croire que c'est le Patriarche lui-même qui a dessiné les vignettes que nous avons sous
les yeux. Il était de pratique courante chez les scribes égyptiens de reformuler les vieux
passages obscurs qu'ils copiaient pour les rendre plus clairs. Ce qui résout le problème de
l'anachronisme créé par la présence des trois vignettes dans un texte qui leur est de loin
antérieur. Elles ont manifestement été introduites beaucoup plus tard, à titre d'illustration,
par un scribe utilisant une pratique égyptienne que l'on voit se manifester, par exemple,
dans le grand livre des mystères appelé l'Amdouat : « La nature de cette chose, vous la
voyez dessinée sur le mur sud de la chambre cachée (...) cette chose secrète (...) on la
voit complètement expliquée dans une représentation se trouvant sur le mur sud de la
chambre cachée ». Le fait que le scribe en question ait inséré la phrase comme si elle
avait été dite par Abraham n'a rien d'étonnant puisque tout ce qui se trouve dans le
manuscrit est considéré comme étant « de la main » d'Abraham.
Comment est-il possible que le manuscrit ait fini dans un hypogée thébain ?
On ne sait pas comment il y est arrivé, mais la possibilité qu'il y soit arrivé est confirmée
par deux papyrus, le Leyde I 383 et le Leyde I 384. Tous deux proviennent d'une collection
de 132 papyrus achetés en 1828 par le Rijksmuseum à une des relations d'Antonio
Lebolo, un certain d'Anastasi. Les deux textes viennent de Thèbes et sont à peu près
contemporains des papyrus de Joseph Smith.
Le Leyde I 384 contient l'image d'un lit à tête de lion portant un personnage couché et
Anubis debout à côté. L'avant-dernière colonne du papyrus contient un texte en démotique
et en grec intitulé : « Le sacrifice (ou holocauste) d'Untel », dans lequel le personnage
s'écrie : « Vite, vite, je vous en supplie, dieux des morts, contre les morts, le dieu
Balsamos, le dieu à tête de chacal et les dieux qui sont avec lui. » Directement sous la
scène on trouve écrit en grec les mots « orichthambito abraam ho epi... » qui signifient
« Abraham qui... sur... s'étonne émerveillé... » Le texte est interrompu là, et on peut
supposer que la fin est « qui est couché sur l'autel » ou « qui invoque Dieu ». Cela
rappelle évidemment le fac-similé n°1 : « Abraham attaché sur un autel ».
Le Leyde I 383 contient un extrait du Papyrus magique démotique. La 8ème colonne
mentionne « Abraham, la pupille [et l'iris] de l'œil udjat ». C'est là une désignation très

intéressante, parce que « la pupille de l'œil udjat » est un des noms que les Égyptiens
donnent à l'hypocéphale (le fac-similé n°2). Ce qui rend le passage si intéressant, c'est
que cette épithète est donnée à Abraham au milieu d'une section concernant la manière
d'obtenir la révélation. Or, l'explication que donne Joseph Smith concernant l'hypocéphale
dans le Livre d'Abraham concerne aussi l'obtention de la révélation du ciel et du cosmos.
Voilà donc deux textes scientifiquement reconnus, provenant du même endroit et de la
même époque que les papyrus de Joseph Smith, où non seulement apparaît le nom
d'Abraham, mais où il apparaît en relation avec deux des trois fac-similés !
Un autre élément intéressant : Dans les textes abrahamiques non-bibliques, le nom
d'Abraham est systématiquement lié à Nimrod, lequel est lié à la dynastie de Shishaq I ou
Sheshonq, qui réintroduisit les sacrifices humains. Contemporain de Salomon, il fonda la
22ème Dynastie. Le professeur Breasted a trouvé le nom d'Abraham sur une stèle de
Sheshonq I en Palestine. Or le nom Shishaq ou Sheshonq apparaît sur le bord de
l'hypocéphale (fac-similé n°2). Serait-ce la tradition de cette famille qui aurait amené le
manuscrit d'Abraham jusqu'à nous ? (Selon M.D. Rhodes, BYU Studies, 1977).
II. Les fac-similés
Quel rapport peut-il bien y avoir entre des vignettes provenant du Livre des Morts et
Abraham ?
Il est impossible d'apporter une réponse à cette question dans le cadre d'un exposé
aussi bref que celui-ci. Elle requiert en effet un développement assez important qu'on ne
peut pas résumer. Il existe une importante littérature extra-biblique concernant Abraham
d'où il ressort clairement que les traditions abrahamiques ont une liaison étroite avec le
Livre des Morts.
L'étude des fac-similés eux-mêmes fait l'objet d'un traitement très important de la part
du professeur Nibley, qu'il faut consulter pour avoir une vue globale sur le sujet. Il suffit ici
de montrer que les explications qu'en donne Joseph Smith sont parfaitement possibles.
Un avertissement est toutefois indispensable : l'iconographie égyptienne ne tente pas
de faire de portraits au sens moderne du terme. Elle est essentiellement symbolique, d'où
son aspect figé. D'où aussi le fait qu'une même illustration peut représenter toute une
série de choses différentes. Dans le fac-similé n°1, il est question au départ de
l'embaumement d'Osiris par Anubis après sa mise à mort par Seth. Au second degré,
Anubis est remplacé par le prêtre (portant le masque d'Anubis) et Osiris par le pharaon,
qui devient le nouvel Osiris. Avec le temps, les riches se feront représenter de la même
façon, et à la fin de l'empire égyptien, ce sera tout un chacun qui pourra se permettre de
se transformer en Osiris. D'autre part, les vignettes, tout en ayant le même aspect général,
diffèrent souvent par de petits détails qui en changent la signification. Nous en verrons un
exemple en relation avec le fac-similé n°1. Enfin, la nature tardive des fac-similés élimine
le problème de savoir comment un Hébreu peut se permettre de représenter
iconographiquement une divinité à l'encontre du 1er commandement. A ce propos,
d'ailleurs, il convient de préciser que les Dix Commandements n'ont pas d'effet rétroactif et
qu'il ne faut pas appliquer notre logique d'Occidentaux du 20ème siècle à des événements
vieux de près de 4.000 ans. Pour s'en convaincre, il suffit de lire l'épisode des théraphim
(dieux domestiques) de Laban dans Genèse 31:19-35.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%
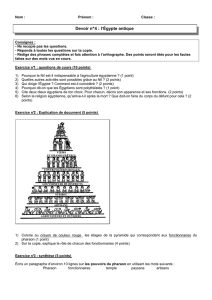


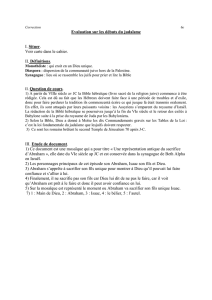
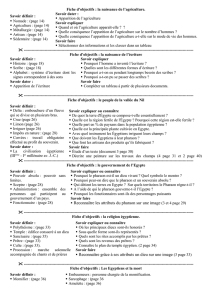
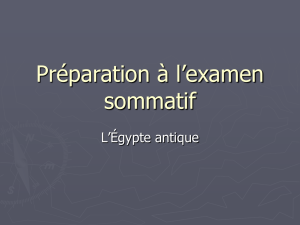
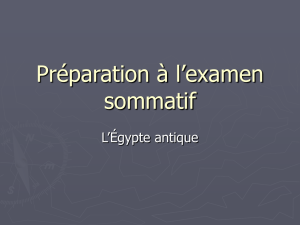
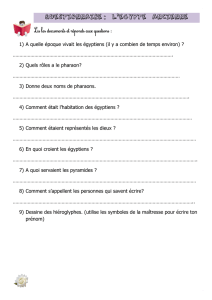
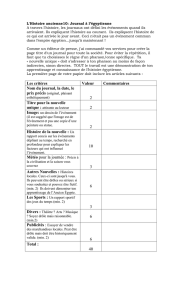
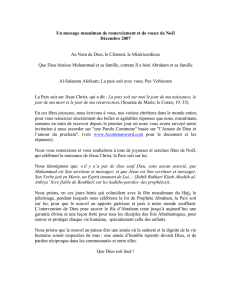
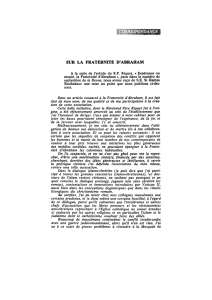
![99-11-24 [Converti]](http://s1.studylibfr.com/store/data/004197023_1-3a5c0c3b30b461997fa405970af322a4-300x300.png)