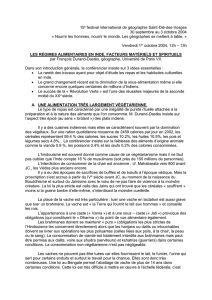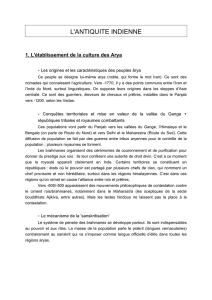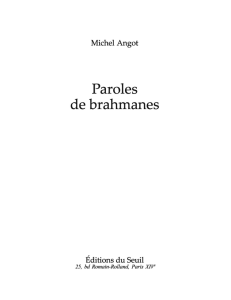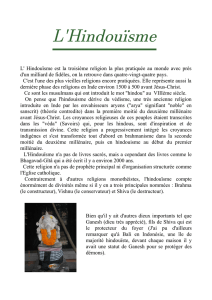Section A : les « Collections - Windows Replacement Services in


Dans la même série
Philippe Haddad
Paroles de rabbins
À paraître :
Thierry-Marie Courau
Paroles de Bouddhas
Youssef Seddik
Paroles du Coran
Régis Burnet
Paroles de la Bible
Alexis Lavis
Paroles de sages chinois

Du même auteur
L’Inde classique
Les Belles Lettres, 2001
Images du corps dans le monde hindou
(dirigé par Véronique Bouillier, Gilles Tarabout)
CNRS Éditions, 2003
Ce que les hommes disent aux dieux
Prières des grandes religions
(avec Armand Abécassis, Michel Angot, Malek Chebel,
Philippe Cornu et Jacques Perrier)
Éditions du Seuil, 2007
La Taittirīya-Upaniṣad et le Commentaire de Śaṃkara
(notes, commentaires et appendices par Michel Angot)
Collège de France, Institut de civilisation indienne, 2007
Le Yoga-Sūtra de Patañjali et le Yoga-bhāṣya de Vyāsa
(édition, traduction et présentation par Michel Angot)
Les Belles Lettres, 2008
Śaṃkara
La Quête de l’être
(textes traduits, choisis et présentés par Michel Angot)
Points, 2009
Nyāya. L’art de conduire la pensée :
le Nyāya-Sūtra de Vātsyāyana Pakṣilasvāmin
et le Nyāya-Bhāṣya de Vātsyāyana

(édition, traduction et présentation de Michel Angot)
Les Belles Lettres, 2009
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%