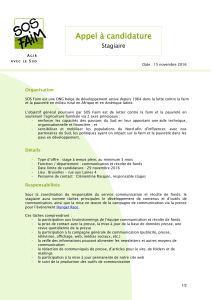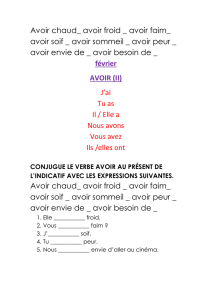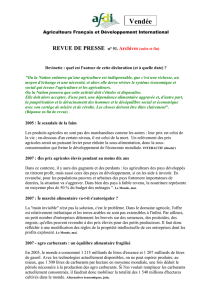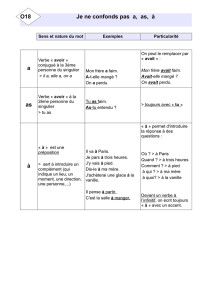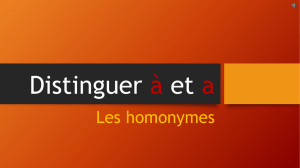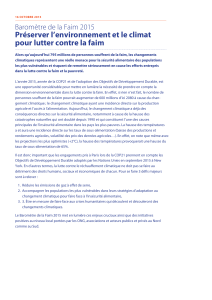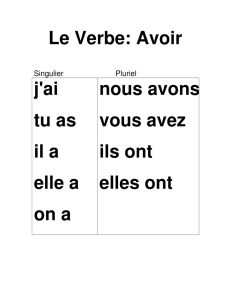Compte rendu d`ouvrage - Manger pour vivre. L`alimentation

Compte rendu d’ouvrage - Manger pour vivre.
L’alimentation en condition de pr´ecarit´e dans les pays
”riches”
Ana Masullo
To cite this version:
Ana Masullo. Compte rendu d’ouvrage - Manger pour vivre. L’alimentation en condition de
pr´ecarit´e dans les pays ”riches”. Revue d’Etudes en Agriculture et Environnement - Review of
agricultural and environmental studies, INRA Editions, 2010, 91, pp.234-238. <hal-01201206>
HAL Id: hal-01201206
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01201206
Submitted on 17 Sep 2015
HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.
L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destin´ee au d´epˆot et `a la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publi´es ou non,
´emanant des ´etablissements d’enseignement et de
recherche fran¸cais ou ´etrangers, des laboratoires
publics ou priv´es.

Comptes rendus de lecture-Revue d’Etudesen Agriculture etEnvironnement,91 (2),229-252
234
Mangerpour vivre. L’alimentation en condition de précarité danslespays «riches»
Anthropologyof Food 6,septembre2008, Delavigne A.-E., Montagne K. (éds)
Ce numérospécial de larevue en ligne Anthropologyof Food,dédié àl’alimentation des
personnesprécaires, convoque les sciences sociales sur le sujetde lafaim. Dansleur introduction,
intitulée « De lahonte d’avoirfaim dans un pays riche », Anne-Elène Delavigne et
Karen Montagne, coordinatricesdunuméro, affirmentchercherà«réintroduire dansl’actualité
des sciences sociales une dimension dufaitalimentairesouventnégligée » danslespays riches, bien
qu’incontournable. Ainsi,lafaim ne seraitpas uniquement un problème propreaux pays
émergents,maiségalementcelui de pays ayantpour pointcommun l’abondancealimentaire
comme signe de leur richesse (Suisse, France) oul’importance de laproduction de denrées
alimentairesdansleur territoire (Espagne, Roumanie). La faim est traitée àpartirde différents
points de vue,qui incluent une perspective ethnologique (Guidonet),ethnographique (Plancade),
socio-anthropologique (César),historique (Perianu, Clément)ainsi qu’une approche
quantitative (Poulain etTibère, Gaberel etOssipow, Amistani etTerrolle). Ce parti prisde
lapluridisciplinaritésetraduitpar une diversité de méthodes(quantitativesetqualitatives)
etde matériaux.Les sources utiliséesincluentfilms,œuvreslittéraires,entretiensqualitatifs,
observation participante,questionnairesquantitatifsetentretiens rétrospectifs.
Quatrethématiquesprincipales se dégagentde cettecompilation. La premièretraite des
représentationsinstitutionnellesde lafaim. Cesdernièresdonnentlieuàdespratiquesetdes
initiativesde prise en charge desindividus en marge de lasociété. Le numéros’ouvreainsi
sur une vision diachroniquesur trois siècles,livrée parAlain Clément sur l’histoire de la
pensée libérale etla construction du«bon pauvre ». Il proposeune approche de laréponse
àlaquestion « faut-il nourrirlespauvres? » en France eten Angleterre danslapensée
économique. Lespremièresapprochesmodernesdu secours aux pauvres sont situéesentre le
XVIeetle XVIIesiècles,période àlaquelle la charitéaunrôle nutritif accompagné d’unrôle
éducatif et,surtout,une miseau travail desplus exclus :mendiants « oisifs»,vagabondset
invalides.Cettecatégorie s’élargitdansladeuxième moitié duXVIIesiècle aux travailleurs
dontles revenus sontàpeine suffisants pour vivre. C’est auXVIIIesiècle que l’obligation
alimentaire familiale est systématisée ( speenhamlandsystem,1795) comptantavecune version
moderne de l’aide sociale (indexée sur le prixdescéréales,versée en complémentdu salaire
ettenantcompte de la composition de lafamille). Lesiècle suivant secaractérise par un
désengagementprogressif,mettantaucentre de ladiscussion lalibéralisation du travail et
considérantlespauvrescomme desconsommateurs irrationnelsetimprévoyants suivantdes
processus différents.Parallèlement,se développe une prise en compte desfacteurs institutionnels
et systématiquesàl’origine de lapauvreté. Aucours de la Troisième République,une politique
d’assurancesociale etde solidaritévoitle jour en Francetandisqu’en Grande-Bretagne
unpassage de lagestion de l’assistance philanthropiqueàlagestion étatiquetransforme les
mentalités.Dèslors,« l’Etat vaérigerl’assistance en droit» (p. 22).
Lescontraintesalimentairesen situationsexceptionnellesouparticulières(défaut
d’approvisionnement) fontl’objetd’un deuxième ensemble de textes.Les stratégiesmisesen
place parlesindividus pour y faire face en constituentle sujetprincipal. Ainsi,troisarticles
livrent une approche de lafaim en Europe aucours duXXesiècle :pendantle régime
communiste en Roumanie,laguerrecivile en Catalogne,ouencore lafaim en Europe qui
« naîtde situationsexceptionnelles» multiples.L’article « Précaritéalimentaire, austérité.
Mangerpendantladernière décennie communiste en Roumanie » se propose « d’examinerla

235
Comptes rendus de lecture-Revue d’Etudesen Agriculture etEnvironnement,91 (2),229-252
manière dontl’accèsaux aliments astructuré l’expériencesociale etnutritionnelle de l’individu,dansle
casde lasociétéroumaine pendant sadernière décennie communiste» (p. 12). Catherina Perianu
analyse, à travers des témoignagesetdesobservations, commentlafonction sociale de la
nourriture prend une place et une signification propresaucontexte économique etpolitique
de la Roumanie de lafin de ladictature. Lespratiquesalimentaires sontaucœur de
laconstruction de l’identité desindividus,dulien social etdeséchanges.Avecun
approvisionnementdifficile,lesfilesd’attenteconstituentdeslieux privilégiésde débrouillardise,
de développementde réseaux sociaux,voire de résistance politique. Pour l’auteur,la
préparation culinaire,le bricolage des recettes traditionnellesetlesoccasionsfestivesont
«influencé de manière notable lafaçon dontlesindividus se percevaientet se définissaientpar rapport
àsoi-même età autrui» (p. 9). Atravers uncasd’étude, Alicia Guidonet,dans son article
«La réciprocitécomme stratégie pour gérerlafaim etlaprécaritéalimentaire », analyse la
manière dont une femme en situation de monoparentalité faitfaceaux différentesétapes
imposéesparle ravitaillementen tempsde guerre dans unromanclassiquecatalan. Elle
montre laplacecentrale de laréciprocitécomme ressource etdéfend l’hypothèse « selon
laquelle l’une desfonctionsde l’alimentation serait,danscecontextespécifique,la création etle maintien
des relations sociales». Ainsi,les relations sociales sont réexaminéesàtravers le filtre de
l’alimentation (son établissement,sesaffaiblissements ou son effritement). Enfin,l’article de
VincentChenillé,«La faim danslespays occidentaux développés.Sa représentation dansle
cinémade fiction (1918-2006) »,proposeune recension d’une centaine de films«tournésà
un momentoùlafaim était techniquement réglée » etdésormaisintolérable danslespays
appartenantaucorpus France, Allemagne, Grande-Bretagne, Italie etEspagne. La faim est
placée àl’écrancomme propreàdes situationshistoriquesexceptionnelles,l’isolement
géographique ou social,lamarginalité. L’auteur faitégalement une caractérisation des
personnagesqui ontfaim et y résistent,devenantdeshéros.
Letroisième axeregroupe un ensemble de textesportant sur desindividus en situation
d’extrême pauvreté et s’intéressantaux effets desaides socialesen matièrealimentairesur
leurs bénéficiaires.Constituantlaplus grande partie desbénéficiairesde l’aide d’urgence,
lessans-abrisontlargementétudiésdansce numéro. Amandine Plancade montre notamment
que leur alimentation secaractérise par une dépendance plus oumoinsforteselon les
pratiquesd’approvisionnement(glanage,récupération de restesetdesproduits en fin de
marché,pratiquesde manche,de vol,de ‘débrouille’ et,éventuellement,d’achat). C’est à
cettecatégorie qu’appartiennentlesquatre habitants de « la cabane »,unabri de fortune où
l’approvisionnement(dons,récupération et,dans une moindre proportion, achat) etla
préparation des repasprennent une placecentrale danslavie quotidienne,organisentet
structurentlavie sociale de sesmembres,etpermettentd’établirdes relationsavecleur
voisinage. « Suivre le chemin parcouru parlesaliments,décrire lesfaçonsde se lesprocurer,de les
cuisiner,de lesconsommer,de les redonneretde lesjeterinviteà considérerles rapports sociaux en jeu
età comprendrecomment seconstruitlavaleur desaliments à chacune de cesétapes» (§ 3). La
valorisation desdenréespour la consommation est une activité loin d’être exclusivement
une activité de survie oude maintien physique,même si elle constituerarement,nous dit
l'auteur,une « question de goût ». Ce processus constitue pour lesmembresde la cabane une
construction de soi,une possibilité de négocierleur relation avecle manque. Il leur procure
égalementle statut de « possesseurs » d’aliments etmême lapossibilité de deveniraidant/
donateur.Dansl’optique de dresser uncadre plus général, Carole Amistani etDaniel Terrolle
définissentl’alimentation des sans-logisparleur autonomie (entenduecomme le choix) et/ou

Comptes rendus de lecture-Revue d’Etudesen Agriculture etEnvironnement,91 (2),229-252
236
leur dépendance (liée audon). La politiquesociale,etplus spécifiquementle don alimentaire,
est sujetd’une critique, carcelui-ci n’« assure pasl’équilibre nutritionnel oumême lesaspects
socialisants dansl’actealimentaire» (p. 1). Ilse limite encore de nosjours àlasphère de
l’urgence et relève du traitementpalliatif pour un problème de fond de nos sociétés.L’analyse
viseàétudierle fonctionnementetlesdysfonctionnements de cettealimentation en
considérantles représentationsqui luisontassociées,tantde lapart des sans-abrisque des
personneschargéesd’assurerceservice. Lesauteurs concluentqu’en dépitdesefforts menés
dupointde vue de l’assistanceaux sans-abri,le contenunutritionnel desaliments distribués
etles tentativesde distribution de compléments vitaminiquespeuvententraînerdes troubles
graves.Ils soulignentégalementla conscience que lesSDF ontde leur situation d’exclusion,
n’ayant«perduni le sensde la cuisine,ni les repèresd’une alimentation équilibrée ». Ils restent
soumisaux lois socialesde l’exclusion qui lespriventdudroitde pouvoirchoisirleur
alimentation.
L’article de Christine Césarprésenteune étude de casapprofondie sur un ménage de personnes
«sanspapiers » en France,en articulantle recours àl’aide alimentaire etleurs conditionsde
vie. Pour l’auteur,l’absence de papiers érige cespersonnesen « figuresextrêmesde dépendance
au soutien misen place parlasociétécivile,lesassociationscaritatives». Situation amplifiée par
lesconditionsde logementàl’hôtel,oùlaprésence de cuisinescollectivesest rare etla
prohibition de cuisineroude réchaufferdesaliments,voire d’avoir unréfrigérateur,
contraignentencore plus lapossibilité de se nourrir.Bénéficiaire de colisde nourriture, avec
des ressources trèslimitées,lafamille étudiée composeses‘repas’avecle panieraccordé par
lesépiceries socialeset unréchaud dansla chambre. Cette épreuve quotidienne pour se
nourriradeseffets sur l’image de soi desadultesduménage quisententque « le don
alimentaire ‘dégradé’ dégrade celui qui le mange » (p. 9),etlesmène àrefusercertains types
d’aide,notammentpour ne pasêtre engagésdanslalogique dudon/contre-don. PascalGaberel
etLaurenceOssipow s’intéressentquantàeux aux pratiquesdesbénéficiairesdesaides
socialesgenevois.Atravers le suivi d’une cohorte,lesauteurs cherchentàmettre en lumière
ce que « bien manger veut dire » pour cette population. Ilsmobilisent une approche
bourdieusienne de lanotion d’habitus pour analyserlesdiscours etlesactivitésalimentaires
régulièresde cesbénéficiaires.Pour cela, ils seréfèrentaux textesde loisetaux directives
d’application qui leur accordentleur statut,définissentleurs aides sociales, ainsi que les
montants attribués.Dansles représentations,«les usagers de l’aide sociale ne se distinguent
fondamentalementpasde lapopulation générale » (p. 23). Certainsd’entre eux ont une situation
particulière qui peut ouvrirdroitàdesindemnitésalimentairesleur permettant une marge
de manoeuvre grâceaux maigres ressources reçues.Lesautresontgénéralementlesmoyens
de manger renforçantnotammentde manière exceptionnelle le caractèreconvivial et
socialisantde l’alimentation. Lors d’un excédent,il ne s’agitplus simplementde se nourrir
pour entretenir son corpsmaisaussi de dépassercestade.
L’article de Jean-PierrePoulain etLaurenceTibèreaborde une quatrième thématique,la
question de laprécaritéalimentaire etde seseffets sur lasanté. Apartirde l’analysestatistique
d’un échantillon de personnesen situation précaire,issu d’une étude en population générale,
lesauteurs entendent«contribueràune plus fine identification desgroupes sociaux àrisqueset se
mettreainsiau service de laluttecontre lesinégalitésfaceàlasanté» (p. 5). Lesindividus sont
repérésdansl’échantillon àl’aide d’« indice de précarité » etclassésen deux groupes,
« précaires» ou« en voie de précarisation ». La relation entre précarité etobésité est analysée

237
Comptes rendus de lecture-Revue d’Etudesen Agriculture etEnvironnement,91 (2),229-252
en montrantque « l’instabilité etlafragilisation socio-économiques semblentconstituer unterrain
favorable àlaprise pondérale etàl’obésité» (p. 9),de même que la baisse des revenus.Les
auteurs cherchentégalementàdéfinirdes systèmesde prisesalimentaires spécifiques
aux populationsprécaires.Chezcesfamilles,les repas suiventlatendance générale àla
simplification des repas,maisd’une façon plus forte:«La norme classique ‘entrée + platgarni
+ fromage et/oudessert’recule auprofitduplat unique oudescouples‘entrée + plat’ ou‘plat+ dessert’.
Les sandwichs/hamburgers (9,1 %),lespizzas/quiches(11,5 %) etlesboissons sucrées(26,8 %)
apparaissentcomme composantesnormalesdes repas»;leur taux de consommation de légumeset
de poisson est plus faible que pour lapopulation générale en opposition aveclesféculents qui
ontdes scores trèsimportants.Finalement,en ce quiconcerne lespratiques,lesauteurs
constatent une multiplication despriseshors repas,un décalage par rapport àla«temporalité
sociale » etla consommation des repasfaceàlatélévision (notammentpour le petit-déjeuner
etle repasde midi). Ence quiconcerne les représentations,laviande est survalorisée comme
aliment« essentiel » etcespersonnes s’avèrent«moins sensiblesaudiscours nutritionnel valorisant
lesfruits etlégumesoule poisson » (p. 10).
Travailleraujourd’huisur lespersonnesen situation de précarité nous semble constituer un
défi danslamesure oùla catégorie des« précaires» est composée d’une grande diversité
d’individus aux parcours etoriginesmultiples.Serge Paugam (2005) suggèreainsi que
l’étude de lapauvreté doitincluretroisfacteurs :le degré dudéveloppementéconomique et
dumarché de l’emploi,lanature du système de protection sociale etd’action sociale,etla
forme etl’intensité desliens sociaux.Ces troisfacteurs sontprésents danslesdifférents
articlesde ce numéro. Tout en seréférantàdes« pays riches»comme contexte d’analyse,
lesdifférencesentre lespériodesétudiéesmultiplientlescontextes sociaux etéconomiques
danslesquelslesconditionsde vie etd’assistancevarientfortement.Cette pluralité de
situationspermetd’analysercommentl’expérience de lafaim prend des visagesdifférents en
période de pénurie (guerrecivile ou régime contraignantcomme en Roumanie),oudansdes
contextesd’abondancecomme à ParisouGenève de nosjours.Lesdifférents systèmesde
protection sociale etd’intervention (deuxième facteur) façonnentlespratiquesalimentairesde
leurs bénéficiairesetles représentationsde lapauvreté. Detelles situations sontaujourd’hui
associéesàdes situationsexceptionnellesouaux pays dits en voie de développement,ou
encore propresàdesmoments de l’histoire de l’Europe. Dece fait, comme le dénoncent
Carole Amistani etDaniel Terrolle ouChristine César,le traitementde lafaim reste du
domaine de l’urgence. Les réponsesne visentpasàlaprise en charge de l’ensemble des
besoinsde situationsquise pérennisent, alors même qu’un grand nombre des usagers de la
distribution de repasoucolisen dépendent totalement.La difficultéàse nourrir relève du
domaine de l’exclusion et resteassociée àune population jugée marginale etassistée,qui
seraitincapable de se prendre en charge dansdes sociétésoùl’injonction àl’autonomie est
lanorme (Duvoux,2009). L’impossibilité de prendre en charge son alimentation oucelle de
sesproches représenteaujourd’hui le dernieréchelon de lamarginalité,voire de
désocialisation. Danslesarticlesde Christine CésaretAmandine Plancade,lesefforts menés
parlesindividus pour négocierleur statut d’assistéset reprendre en main leur alimentation
sontlapreuve de ladifficulté du vécude la“dépendancealimentaire”. Pour ceux encore
plus dépendants,les usagers de ladistribution d’aliments,l’alimentation perdsadimension
sociale et se nourrirdevient une épreuve. D’aprèsCarole Amistani etDaniel Terrolle, cette
population partageraitavecle reste de lasociété lesmêmes représentationsde ce que « bien
nourrir»veut dire et serait victime des« logiques socialesde domination » (p. 15).
 6
6
1
/
6
100%