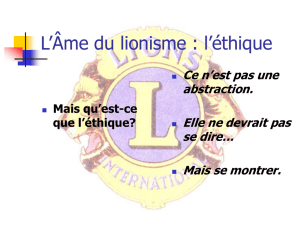Présentation sommaire du livre «L`œuvre de soi

Présentation sommaire du livre L’œuvre de soi.1
Par Marcelle Monette, inf., Ph. D.
3 décembre 2007
Le livre a été écrit par Pierre Fortin, spécialiste en éthique, professeur retraité de
l’Université du Québec à Rimouski.
Le titre L’œuvre de soi signifie « l’art d’être soi-même » (p. 112) et la capacité de
gouverner sa vie de manière libre et responsable. L’ouvrage est divisé en sept chapitres.
Les trois premiers situent les sources de la pensée de l’auteur : Qohélet IIIe siècle av. J.-
C., Épicure IVe siècle av. J.-C., et Albert Camus XXe siècle. Ces penseurs « croient en la
possibilité du bonheur » (p. 63). L’auteur consacre un chapitre à chacun des auteurs pour
exposer leur conception de la condition humaine et du bonheur.
Le geste peut sembler éclectique de placer côte à côte des penseurs qui ont vécu à des
époques différentes et de traditions aussi diverses que biblique, antiquité grecque et
européenne de l’ère moderne. Fortin explique leurs ressemblances et différences de
conception et pourquoi il les retient. De la pensée de Qohélet il dégage que « L’atteinte
du bonheur est possible… Il est à rechercher et à cueillir dans la beauté des petites choses
et des événements les plus simples de la vie » (p. 21). De l’enseignement d’Épicure, il
rappelle que « La gouverne de sa vie repose entièrement sur la capacité de quiconque à se
prendre en main » (p. 36). Enfin, citant Camus : « Le bonheur est la plus grande des
conquêtes, celle qu’on fait contre le destin qui nous est imposé. Il se présente comme une
conquête fragile et sans cesse menacée » (p. 56).
Le chapitre 4 situe comment la recherche du bonheur est liée à la gouverne de sa vie.
Comme outils d’enseignement, retenons que « l’œuvre de soi exige que l’on se fasse
libre… qui consiste à savoir se suffire à soi-même… étant bien conscient que les chaînes
les plus lourdes de la servitude ne viennent pas d’autrui, mais de soi » et « vivre
lucidement et à fond son métier d’homme et de femme, avec toute la richesse de
satisfactions et de plaisirs qu’il peut procurer à l’occasion, peut favoriser les conditions
d’une relation plus autonome et finalement plus profonde à autrui » (p. 67).
Il y a une habitude ancrée de vouloir trouver un coupable quand il nous arrive une
malchance. Le plus souvent la responsable est la personne elle-même qui a mal évalué la
situation, ou bien a fait des excès de toutes sortes ou encore n’a pas voulu se rendre
consciente de comportements à risque.
Le chapitre 5 traite de l’itinérance comme mode d’appréhension de l’éthique. « La morale
secrète la norme, l’éthique… s’articule à la valeur » (p.73). La personne en cheminement
personnel de création éthique qui poursuit le but d’atteindre à ses valeurs au lieu de
suivre le chemin déjà tracé par les normes est forcément itinérante. Elle est une sorte
d’aventurière, mais elle ne se départit jamais du souci de soi et de l’autre :
1 FORTIN, Pierre, L’œuvre de soi, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2007, 129 p.

« quand nous nous préoccupons de déterminer les règles qui doivent guider notre agir,
quand nous tentons de traduire l’éthique comme recherche du bonheur et du plaisir,
création de soi, expression de la liberté et de la responsabilité, nous nous insérons dans un
jeu particulier : le jeu du bien et du mal… » (p. 72).
Le chapitre 6 décrit en quatre étapes ce qu’est l’expérience éthique personnelle :
- le sentiment d’étonnement et d’étrangeté qui conduit à la remise en question de la
norme et à la prise de distance par rapport à elle;
- la dérive hors norme;
- l’épreuve du vide : s’il n’y a plus d’adhésion à la norme, il faut s’inventer une
éthique;
- la découverte d’une responsabilité illimitée : vivre sa liberté avec autrui.
Ce processus est tellement difficile que plusieurs peuvent perdre pied, surtout après
l’étape de la révolte contre les morales universelles. Que reste-t-il à l’individu? Le temps
requis pour choisir son éthique personnelle, nommer ses propres valeurs risque d’être
long et faire dériver plus d’un. La sensation du vide peut paraître insoutenable. « C’est le
prix à payer pour quiconque entreprend de se faire libre afin que les désirs qui l’animent
ne tournent pas à vide » (p. 2).
C’est au chapitre 7 que l’auteur définit l’art de bien vivre : « une conquête lente,
progressive et éprouvante de la liberté et de la paix intérieures »… « jouer à fond le jeu
de la finitude, en assumant lucidement et courageusement les paradoxes de la vie et de la
vie avec autrui » p. 110.
Quelques impressions à la suite de la lecture du livre
Contrairement à l’éthique de la recherche qui a des normes reconnues par l’ensemble de
la communauté des chercheurs de la planète, du moins officiellement, l’éthique clinique
appliquée n’a que des repères, critères, référents pour se guider comme pour l’éthique
personnelle. La lecture de ce livre original et novateur donne des pistes qui aident la
personne à tracer son cheminement personnel vers une liberté authentique et responsable
de l’autre.
Tout le monde doit-il passer par là? Il ne semble pas. L’acquisition de la liberté est un
processus continu au cours d’une vie et tous les niveaux de réussite sont possibles. Par
contre, une infirmière qui voudrait exercer en éthique clinique n’a pas le choix de
requestionner les morales et reconnaître la pluralité des valeurs. Un cheminement
semblable à celui que nous propose l’auteur est une étape obligée pour arriver à résoudre
des problèmes éthiques complexes en clinique. Une fois qu’on est arrivé à prendre ses
distances et à « faire de sa vie une œuvre qui ne soit pas le produit des moules du prêt-à-
penser et du prêt-à-agir » (p.110), il devient plus facile de le faire avec d’autres et pour
d’autres.
1
/
2
100%