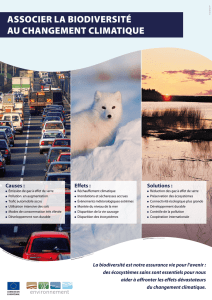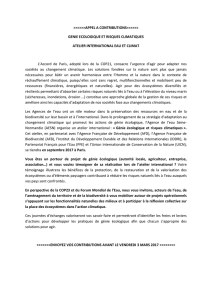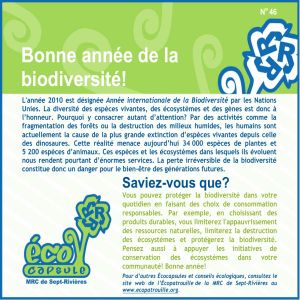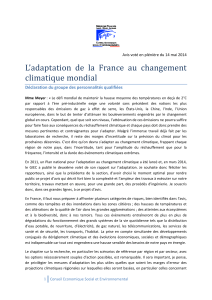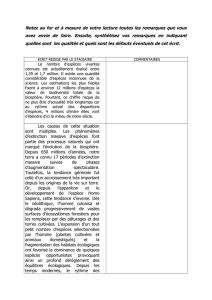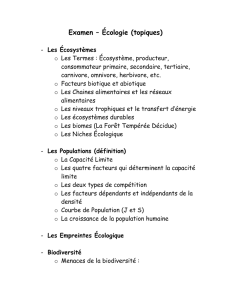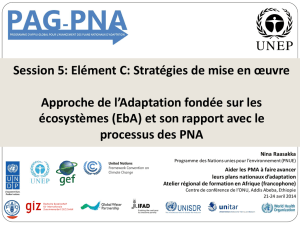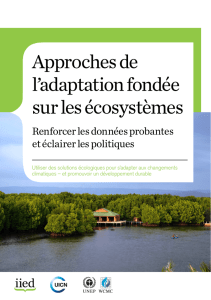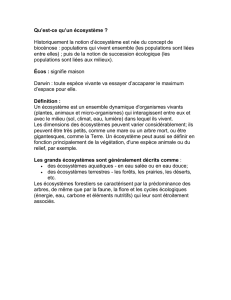Adaptation fondée sur les écosystèmes (EbA)

Environnement et changement climatique
Adaptation fondée sur les écosystèmes (EbA)
Une nouvelle approche pour promouvoir des solutions naturelles en vue de
l’adaptation aux changements climatiques dans différents secteurs
Contexte conceptuel
Les populations de la planète sont dépendantes d’écosystèmes
intacts et des services qu’ils fournissent, tels que la fertilité du
sol, l’eau salubre et la nourriture. Cela est particulièrement vrai
pour les populations pauvres des pays en développement, dont
les moyens de subsistances sont étroitement liés aux ressources
naturelles. Le changement climatique est l’une des principales
causes des changements et de la détérioration des services éco-
systémiques et son impact augmentera probablement à l’avenir
(Évaluation des écosystèmes pour le Millénaire 2005). Dans le
même temps, les écosystèmes sains aident les populations et la
nature à s’adapter aux eets du changement climatique.
« L’adaptation fondée sur les écosystèmes est le recours à la biodiversité
et aux services écosystémiques dans le cadre d’une stratégie d’adapta-
tion globale, aux ns d’aider les gens à s’adapter aux eets négatifs des
changements climatiques. »
CBD 2009
L’adaptation fondée sur les écosystèmes, ou EbA, utilise
intentionnellement des « infrastructures vertes » et des services
écosystémiques pour renforcer la résilience des communautés
humaines face au changement climatique. L’EbA est donc une
approche anthropocentrique qui s’intéresse à la manière dont
les écosystèmes peuvent aider les populations à s’adapter à la
variabilité climatique actuelle et aux changements climatiques
à venir. L’objectif est toujours de réduire la vulnérabilité des
gens aux eets du changement climatique. L’EbA comporte
des mesures visant à conserver, restaurer ou gérer durablement
les écosystèmes et les ressources naturelles, et complète ou
même remplace d’autres mesures d’adaptation, comme les
mesures en faveur d’infrastructures matérielles ou « grises ».
De plus, les solutions naturelles fondées sur les écosystèmes ont
tendance à générer de précieux avantages concomitants comme
la séquestration du carbone, la conservation de la biodiversité
ou la production de denrées alimentaires, et sont souvent
plus ecaces. C’est ainsi, par exemple, que l’on a constaté
au Vietnam que le fait de planter et d’entretenir des forêts de
mangroves pour servir de digues et protéger la côte est bien
moins onéreux (1,1 million USD pour 12 000 hectares) que la
réparation mécanique de l’érosion des digues provoquée par les
vagues (7,3 millions USD par an) (L’économie des écosystèmes
et de la biodiversité, 2009).
Une nouvelle approche prometteuse ou du vieux vin
dans de nouvelles bouteilles ?
Contrairement aux approches courantes en matière de gestion
des ressources naturelles et de la biodiversité, l’EbA évalue
et choisit à dessein des mesures dans le cadre d’une stratégie
d’adaptation globale. Elle a) s’appuie sur des études portant
sur les impacts du changement climatique ou sur des analyses
intégrées du climat utilisant des scénarios et des modèles cli-
matiques, b) analyse les relations de cause à eet et les pressions
générées par le changement climatique, c) compare les coûts et
l’ecacité de diérentes mesures d’adaptation et d) surveille
les impacts résultant de l’adaptation. Ainsi, alors que les projets
classiques de développement et de conservation de la nature
peuvent également apporter des avantages positifs concomitants
pour l’adaptation en termes écologiques et socio-économiques,
l’EbA se concentre d’emblée sur les besoins d’adaptation et les
avantages qui peuvent découler de cette adaptation. Il est cepen-
dant important de noter qu’un grand nombre de projets d’EbA
ont débuté comme des projets traditionnels de conservation de
la nature ou de gestion des ressources naturelles et n’ont produit
tout leur potentiel d’adaptation qu’au bout de quelques temps.
De la théorie à la pratique
L’approche EbA est nouvelle, donc nouvelle aussi pour la GIZ.
Il existe de nombreuses expériences de mesures d’EbA poten-
tielles sur lesquelles s’appuyer, mais dans la plupart des cas ces
mesures n’ont pas été prises dans le cadre d’un processus de
planication de l’adaptation.
Les expériences en matière de mesures d’EbA potentielles
comprennent notamment la gestion, la conservation et la
restauration améliorées :
de forêts, terres humides et sols organiques an qu’ils jouent
leur rôle de régulateur au sein du régime hydraulique dans un
contexte de rareté de l’eau due à la diminution des précipita-
tions et à des périodes de sécheresse plus longues ;
de pâturages, forêts et prairies qui protègent les communautés
de l’érosion accrue des sols, des coulées de boue et des glis-
sements de terrains dus à l’augmentation des précipitations
abondantes ;
de récifs de corail et mangroves pour la protection des côtes dans
un contexte de tempêtes et d’inondations plus importantes ;

Publié par :
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
65760 Eschborn/Alemania
T +49 6196 79-0
F +49 6196 79-1115
I www.giz.de
de la végétation qui, au cours des périodes sèches de plus en
plus longues et de plus en plus intenses, protège des consé-
quences de la désertication accrue, par exemple, la pollution
par la poussière ;
de paysages uviaux, terres humides ou plaines inondables
dans des bassins versants et des zones sujettes aux inondations
pour répondre à l’augmentation des précipitations abondantes
et à la fréquence ou du volume des précipitations.
La question de savoir si ces mesures peuvent être considérées
comme des mesures d’EbA ou non dépend du contexte
spécique qui prévaut au cours de la conception du projet. La
théorie du changement doit expliquer dans les grandes lignes en
quoi elles améliorent la résilience des populations vulnérables
face aux impacts du changement climatique.
L’EbA peut être utilisée dans diérents domaines/secteurs vul-
nérables, par exemple la gestion de l’eau, la protection des côtes,
la sécurité alimentaire, la réduction des risques de catastrophes,
la diminution des inondations à l’intérieur des terres ou des
glissements de terrain, le secteur de la santé, etc. Un exemple
de mesure d’EbA concrète concerne le projet portant sur la
protection des côtes par le reboisement et la gestion durable
des mangroves dans la Province de Soc Trang, au Vietnam.
Dans ce pays, le changement climatique a notamment comme
eet de modier les régimes de précipitation, de ruissellement
et de température, et d’accroître la fréquence et l’intensité des
cyclones tropicaux. Il entraîne également une aggravation
des pressions actuellement exercées sur la biodiversité, par
exemple, la conversion des terres par le déboisement en vue de
l’élevage de crevettes, la pollution du sol et de l’eau du fait de
l’aquaculture ou l’usage excessif des produits forestiers par les
communautés locales. Les mesures d’EbA comprennent la
conservation (zones de protection où l’exploitation fores-
tière et l’élevage de crevettes sont interdits, programmes
de cogestion pour gérer les mangroves) et la restauration
des écosystèmes (réhabilitation des forêts de mangroves
dégradées et reboisement), ainsi que la gestion durable
(planication et gestion intégrées des zones côtières,
réglementation de la pêche et promotion de sources de
revenus alternatives pour les communautés locales).
De nombreux outils et approches qui existent dans les
domaines de l’adaptation au changement climatique et
Auteurs:
Julia Olivier
Kirsten Probst
Isabel Renner
Klemens Riha
Août 2012
de la gestion de la biodiversité sont pertinents pour l’EbA, par
exemple les études de vulnérabilité au changement climatique
des sociétés et des écosystèmes, la planication et le suivi de
l’adaptation, la résistance au changement climatique, la carto-
graphie et l’évaluation des services écosystémiques, la planica-
tion de l’espace et la conservation/restauration des écosystèmes.
Perspectives futures
Les projets d’EbA ainsi que les composantes et activités pilotes
sont en augmentation au sein de la GIZ. La direction de la GIZ
a créé un groupe de travail composé d’employés de diérents
départements sectoriels qui ont pour objectif de rassembler des
expériences et des outils pertinents et de donner des conseils sur
la manière dont l’EbA peut progresser au sein de la Coopération
internationale allemande. Les services en cours de développe-
ment et pouvant être fournis sur demande comprennent :
La fourniture de matériel d’information et de formations.
Des conseils sur les méthodes/outils spéciques pertinents
dans un contexte d’EbA.
La conception et la mise en œuvre de mesures pilotes.
Des visites réciproques et des voyages d’étude pour tirer
des enseignements d’exemples et d’expériences de bonnes
pratiques en Europe.
La présentation des expériences de la GIZ au sein de forums
internationaux.
Cadre analytique pour les mesures d’EbA
Mesures d’adaptation
fondées sur les écosystèmes
(restauration, conservation, utilisa-
tion durable des écosystèmes)
Réponse
Vulnérabilité
du système socio-
économiqe
Impact
État des écosys-
tèmes
(vulnérabilité, résilience)
Importance
Changements
climatiques
actuels et futurs
Pression
Causes de
la perte de
biodiversité
Chemin analytique : enchaîne-
ment d’effets dans les systèmes
Prise de décision
Inuence des mesures d’EbA
Émissions de gaz à
effet de serre
Cause
Services
écosistémiques
1
/
2
100%