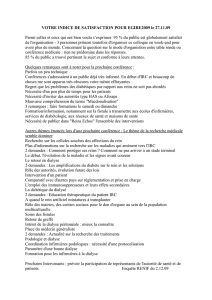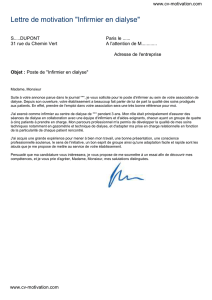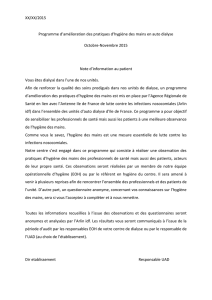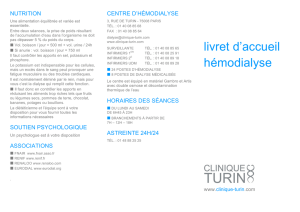Téléchargez le pdf

Comprendre et traiter globalement les problématiques des centres de dialyse grâce à
l’identification précise de leurs besoins a toujours été notre priorité.
Cette démarche se traduit en renforçant nos liens avec des partenaires industriels experts
dans leurs domaines. Notre objectif est de valoriser les applications issues de leurs
recherches en participant au développement de procédés et de produits nouveaux adaptés
à l’hémodialyse.
Hemotech souhaite être moteur pour l’élaboration d’une offre Produits & Service évolutive qui
intègre l’ensemble des spécificités propres au traitement de l'insuffisance rénale. Qu’il
s’agisse de matériels conséquents ou de petits dispositifs, l’impact sur le patient demeure
notre motivation principale.
Nous vous proposons dans ce numéro un retour sur quelques expériences récentes.
Guy LESTRADE - Président
N° 14 - Juillet 2009
édito
sommaire
Tego®+ sérum pysiologique
Eau pour dialyse, un enjeu
majeur
Focus SAV traitement d'eau
Zoom sur une gestion
de projet réussie
PUBLIS EN BREF
Congrès Hemotech “Thérapies extra-corporelles : évolutions et innovations”
Montpellier, 18 et 19 mars 2010.
A vos agendas !
Association TEGO
®
+ sérum physiologique :
expérience d'un centre de dialyse
Un certain nombre de
patients au stade termi-
nal de l’insuffisance
rénale chronique débute
la dialyse par un cathé-
ter veineux central
(CVC) tunnelisé. Cet
accès veineux peut être
temporaire ou définitif
en l'absence de possibi-
lité de création d’un
abord vasculaire péri-
phérique (FAV).
10 % des hémodialysés porteurs d’un cathéter dévelop-
pent une infection. Plusieurs verrous ont été expérimen-
tés : héparine, antibiotiques, citrate ou encore la
Taurolidine. Dans notre centre, nous avons évalué les
CVC et le risque infectieux avec la valve sécurisée
TEGO®avec verrous de sérum physiologique versus
DuraLock C™.
Matériels et méthodes
De septembre 2008 à avril 2009: étude observationnelle
de 15 patients porteurs de CVC dont 10 (66 %) comme
premier abord et 5 (33 %) suite à une anomalie de la FAV.
Critère d'exclusion: l'utilisation de la FAV.
Après un mois, les patients sont répartis en deux groupes
de 6 et 3 patients ont quitté l’étude:
Groupe A: TEGO®+ Sérum Physiologique.
Groupe B: TEGO®+ DuraLock C™.
Résultats
Après 1092 séances d’hémodialyse :
- tous les cathéters sont fonctionnels, les autres paramè-
tres sont restés stables
- les prélèvements bactériologiques sont négatifs dans les
deux groupes.
Discussion
Quelques auteurs (Bouza, Irvine) ont déjà rapporté l’inté-
rêt de ce type de connexion retrouvé dans notre étude
(prévention des infections, des thromboses).
Conclusion
- L’efficacité de la valve TEGO®associée verrou de sérum
physiologique devrait permettre sa généralisation, la
réduction des infections et des coûts.
- La réduction du pourcentage des patients porteurs de
CVC doit rester la priorité.
- Les résultats obtenus soulignent l'implication de l'équipe.
- Intérêt d'une étude multicentrique. ■
Dr M. BOUZERNIDJ, [email protected]
Dr B. TEMPERVILLE et l'Equipe IDE,
Centre de Néphrologie-Dialyse. Clinique de l’Europe - Rouen

En décembre 2008, toutes les activités de la Clinique Béthesda ont été transférées sur le site de la Clinique Sainte
Anne du Groupe hospitalier Saint Vincent à Strasbourg. Le centre lourd d’hémodialyse (24 postes de dialyse,
4 postes à l’atelier, 3 postes de désinfection) est installé dans des locaux entièrement neufs. Notre problématique était
d’acquérir un traitement d’eau permettant d’effectuer la technique d’hémodiafiltration on line et d’alimenter tous nos
postes de dialyse sur une seule boucle de distribution d’eau osmosée. Le partenariat Hemotech/Permo - spécialiste
du traitement d’eau industriel alimentaire et pharmaceutique, nous a paru intéressant. Leur réponse à notre appel
d’offres correspondait entièrement à nos demandes: aspects qualitatifs, garantie des délais de mise en service,
compatibilité avec la boucle installée. Notre budget était respecté et la base SAV proche. La présentation du dossier
de réponse était excellente et le sujet maîtrisé. L’accompagnement durant la phase d’installation, de qualification, de
mise en service, de formation a été bien suivi. Les résultats durant toute la phase de qualification de performance ont
toujours été conformes aux textes et circulaires applicables. Les objectifs fixés sont atteints. ■
Marie-Laure ANDRE-ALI, Ingénieur Biomédical, Christiane COURNAPEAU, Pharmacien CHU Strasbourg
Zoom sur une gestion de projet réussie
Nous ne pouvons que nous féliciter du partenariat mis en
place depuis maintenant 2 ans avec HEMOTECH. Leur
expérience de la dialyse nous a permis d’adapter davan-
tage notre prestation d’assistance technique et de mainte-
nance sur les installations de traitement d’eau qui nous
sont confiées.
Lors d’un projet de nouvelle installation ou de rénovation,
notre prestation consiste à assister HEMOTECH dans la
définition et l’étude de l’installation la mieux adaptée au
besoin de notre client. Le marché établi, nos équipes d’exé-
cution prennent le relais pour le montage de l’installation en
collaboration avec les équipes techniques de l’agence
régionale PERMO. Ce sont effectivement les techniciens de
secteur qui ont en charge la mise en route du système et la
formation des utilisateurs. Cette organisation garantit une
continuité dans le suivi de la vie de l’installation.
En phase d’exploitation, nous sommes en mesure de gérer
des contrats d’assistance technique en maintenance par-
tagée ou en “full service” avec l’ensemble des services
associés comme la Hot Line, pour une assistance télépho-
nique couvrant l’ensemble des plages horaires des séan-
ces de dialyse. Des délais garantis d’intervention sont
contractualisés.
Notre expertise technique en traitement des eaux alliée à
celle d’HEMOTECH sur la connaissance de ce marché
spécifique nous permettent de garantir à nos clients un
niveau de performance technique et de prestation qui font
désormais référence. ■
Franck VERGNENAIGRE,
Responsable Permo Agence Sud-ouest
Traitement d’eau : focus sur le SAV
Souvent les néphrologues laissent le problème de la qualité
de l’eau aux mains des ingénieurs biomédicaux et des phar-
maciens. Pourtant, l’enjeu est majeur. L’obtention d’une eau
ultra-pure est un pré-requis indispensable pour obtenir un
dialysat ultra-pur. Inutile de rappeler l’intérêt sur l’inflamma-
tion chronique et sur les conséquences au long cours de
l’hémodialyse (anémie et utilisation de l’EPO, complications
ostéo-articulaires, état nutritionnel etc.).
L’obtention d’une eau ultra-pure est également un premier
pas indispensable avant la mise en place d’un programme
de technique convective “on line”.
Il faut aujourd’hui aller au-delà de la pharmacopée et veiller
au respect des circulaires ministérielles ainsi que des recom-
mandations de l’AFNOR. Ceci nécessite une démarche
impliquant l’ensemble des acteurs concernés : médecins,
pharmaciens, ingénieurs biomédicaux, techniciens d’hémo-
dialyse, laboratoires d’analyses. La station de traitement de
l’eau doit être adaptée aux réalités locales et tenir compte
des grandes variations de la qualité de l’eau d’apport tant en
caractéristiques biochimiques surtout dans les zones agri-
coles, qu’en température.
Les contrôles en particulier bactériologiques doivent être
traités de façon très spécifique par le laboratoire, après un
recueil rigoureux. Une démarche d’assurance qualité doit
être mise en place, avec traçabilité et procédure.
Cette réflexion a guidé la démarche du centre d’hémodialyse
Saint Roch Médipole à Cabestany. Il a une station de traite-
ment de l’eau réalisée avec la société BWT - Hemotech.
Outre les éléments habituels, avec bi-osmose, elle comporte
une déminéralisation par champ électrique grâce à un
Septron. Cet appareil utilisé largement par l’industrie phar-
maceutique comporte un procédé d’électrodéionisation qui
permet d’obtenir des niveaux de qualité d’eau ultra-pure
dont la conductivité est en routine inférieure à 0,1 µS/cm, soit
autour de 15 MégOhms. L’expérience menée a permis de
constater un net gain sur les critères bactériologiques et
endotoxiniques, avec des résultats sur test au limulus au long
cours en dessous du seuil de détection à 0,005 UI/ml. ■
Dr J.-P. ORTIZ, Centre d’Hémodialyse St Roch
L’eau pour dialyse : un enjeu majeur
Module d'électrodéionisation - Médipôle St Roch

1- PTH et pathologie cardio-vasculaire
Bhuriya R, Li S, Chen SC, McCullough
PA, Bakris GL. Plasma parathyroid hor-
mone level and prevalent cardiovascular
disease in CKD stages 3 and 4: an analy-
sis from the Kidney Early Evaluation
Program (KEEP). Am J Kidney Dis 53
(4 Suppl 4): S3-10, 2009.
La relation entre PTH, désordres
phosphocalciques et complications
cardio-vasculaires est établie chez les
patients dialysés. Peu d’études existent
chez le patient IRC stade 3-4. Les
auteurs, à partir des données de l‘étude
KEEP (Kidney Early Evaluation Program,
suivi prospectif d’une population à risque
d’IRC), analysent la relation entre taux de
PTH et survenue d’un événement cardio-
vasculaire. L’étude porte sur 4472
patients au stade 3 ou 4. Le DFG est
estimé à partir de l’équation MDRD. Un
taux de PTH > 70 pg/ml est associé à
une fréquence plus élevée d’accident CV
(OR: 1.51). Il n’y a pas de relation avec
les taux de calcium ou phosphore. La
relation est indépendante du degré de
l’IRC. Un argument supplémentaire pour
mesurer la PTH (et traiter l’HPTH) dès les
stades précoces de l’IRC.
■
2 - EPO, thrombocytose et mortalité
Vaziri ND. Thrombocytosis in EPO-trea-
ted dialysis patients may be mediated by
EPO rather than iron deficiency. Am
J Kidney Dis. 2009 May; 53(5): 733-6.
Un éditorial dans l’AJKD de ND Vaziri
revient sur les conclusions de l’étude de
Streja parue en 2008: une thrombocytose
(> 300) est retrouvée chez 15 % de la popu-
lation hémodialysée, est associée à une
dose d’EPO 30 % supérieure et à une
déplétion des réserves en fer. C’est la
déplétion des réserves qui induit la throm-
bocytose. La conduite à tenir serait donc
l’augmentation de la supplémentation en
fer. Varizi montre que cette attitude peut
conduire à une charge excessive alors que
la causalité n’est pas certaine.
Indépendamment du fer, L’EPO peut stimu-
ler la prolifération des mégacaryocytes et
l’adhésion plaquettaire. Par ailleurs, les taux
élevés de cytokines et l’inflammation indui-
sent une résistance à l’action de l’EPO et
donc une augmentation des doses.
Inflammation et doses élevées d’EPO sti-
mulent la thrombocytose et induisent aussi
une baisse du fer et de la transferrine.
■
3 - HbA1c et dépistage du diabète
International expert committee report on
the rôle on the A1C assay in the dignosis of
diabètes. Diabetes Care 2009, 32, 7 :1-8.
Dans le numéro de Juillet de Diabetes
Care, est publié un avis d’un comité inter-
national d’experts à propos de l’utilisation
de l’HbA1C dans le diagnostic du dia-
bète. Il rappelle que les précédents comi-
tés n’avaient pas retenu l’A1C alors qu’il
apparaît plus “évident” d’utiliser un mar-
queur de l’exposition chronique au glu-
cose, en raison, à l’époque, du manque
de standardisation de la mesure. Ce n’est
plus le cas aujourd’hui, au contraire de la
variabilité du dosage de la glycémie selon
le laboratoire. Par ailleurs, l’A1C est moins
sujet aux variations liées au stress ou à
l’infection. Le taux de A1C est bien corrélé
à la survenue de complications rétinien-
nes et un taux supérieur à 6,5 % à 2 repri-
ses peut être considéré comme un critère
diagnostique. Reste aux sociétés savan-
tes et aux organisations internationales à
entériner (ou pas!) l’avis du comité.
■
4 - Prévention des sténoses
de l’abord vasculaire
Dixon BS, Beck GJ, Vazquez MA,
Greenberg A, Delmez JA, Allon M, et al.
Effect of dipyridamole plus aspirin on
hemodialysis graft patency. N Engl J Med.
2009 May 21; 360(21): 2191-201.
Prévenir la récidive des sténoses et
thromboses de l’abord vasculaire par
l’association dypiramidole-aspirine
paraît prometteur en raison des effets
des 2 médicaments sur la prolifération
endothéliale et l’agrégation plaquet-
taire. Dans le NEJM est publié un
essai randomisé double insu (13 cen-
tres, 649 patients) de cette associa-
tion (dipyramidole 200 mg + aspirine
25 mg, 2 fois par jour) versus placebo.
Les patients sont traités à la mise en
place d’un nouvel abord. Le traitement
prolonge le délai de vie de l’abord
sans intervention (0R 0,82). Les autres
critères ne sont pas significativement
modifiés (perte de l’abord, complica-
tions hémorragiques, décès). Les
auteurs concluent à un effet modeste
mais significatif du traitement sur le
risque de sténose et le délai sans
intervention.
■
5 - Rapport REIN 2007, qualité de vie
Néphrologie et Thérapeutique, juin 2009,
vol 5 Suppl 1 à 3.
En supplément de Néphrologie et
Thérapeutique, Juin 2009, le rapport
REIN 2007. À lire aussi le supplément sur
la surveillance de la qualité de vie. Il s’agit
d’une étude transversale, par question-
naire sur 832 patients. L’objectif était de
décrire la qualité de vie des patients dia-
lysés en France. Au travers de ce rapport
de plus de 50 pages, on peut dire que
celui-ci est atteint! Premier travail coopé-
ratif de ce type en France sur la qualité de
vie, à lire. Enfin troisième supplément: le
guide du rein 2009, destiné aux utilisa-
teurs, c’est-à-dire nous tous.
■
6 - Dépression et observance
a. Cukor D, Rosenthal DS, Jindal RM,
Brown CD, Kimmel PL. Depression is an
important contributor to low medication
adherence in hemodialyzed patients and
transplant recipients. Kidney Int. 2009 Jun;
75(11): 1223-9.
b. Untas A, Aguirrezabal M, Chauveau P,
Leguen E, Combe C, Rascle N. [Anxiety
and depression in hemodialysis: Validation
of the Hospital Anxiety and Depression
Scale (HADS).]. Nephrol Ther. 2009 Jun;
5(3): 193-200.
En 2004, aux USA, le coût de la non-
observance aux traitements en transplan-
tation est estimé à 100 millions de dollars.
Le patient non adhérent a 7 fois plus de
chance d’évoluer vers la perte du greffon.
La prévalence de la dépression est élevée
en dialyse (20 à 30 %) et associée à une
plus grande fréquence de non obser-
vance. Le diagnostic et le traitement chez
le patient dialysé devraient se faire avant la
transplantation. Cukor dans cette étude
parue dans Kidney Int, évalue l’état psy-
chologique de 2 cohortes de patients,
transplantés ou dialysés, par 3 question-
naires validés, en parallèle avec une éva-
luation de l’observance. Comme déjà
publié par ailleurs, la dépression est plus
fréquente chez le patient dialysé. L’intérêt
de l’étude est de démontrer que, quelle
que soit la population, les index de
dépression sont significativement associés
à la non observance. Comme le concluent
les auteurs “le temps de dépister et traiter
la dépression est arrivé”. Encore faudra-t-
il dans les services avoir les moyens de
dépister et prendre en charge les patients.
Les études françaises sont peu nombreu-
ses sur le sujet. Dans Néphrologie et
Thérapeutique de Juin, A. Untas utilise et
valide l’échelle HADS en français dans une
population de 200 patients. Cette échelle
permet d’évaluer les composantes
dépressives et anxieuses. Les prévalences
de l’anxiété et de la dépression sont pro-
ches de celles publiées dans d’autres
pays (18 à 30 %). En conclusion, les
patients doivent être dépistés et traités
systématiquement et précocement, afin
d’améliorer la qualité de vie et aussi dans
le cadre d’une transplantation future.
■
7 - Tout sur les phosphates
Kidney International 2009, 9 (1)
a. De Broe ME. Phosphate: despite
advances in research, the benefits to
patients remain limited. Kidney Int. 2009
May; 75(9): 880-1.
publis en bref

publis en bref
b. Silver J, Naveh-Many T. Phosphate and
the parathyroid. Kidney Int. 2009 May;
75(9): 898-905.
c. Prie D, Urena Torres P, Friedlander
G. Latest findings in phosphate homeosta-
sis. Kidney Int. 2009 May; 75(9): 882-9.
d. Giachelli CM. The emerging role of
phosphate in vascular calcification. Kidney
Int. 2009 May; 75(9): 890-7.
e. Hutchison AJ. Oral phosphate binders.
Kidney Int. 2009 May; 75(9): 906-14.
Dans la section “Translational nephro-
logy” de Kidney Int, une revue actuelle
autour du phosphore. M. De Broe intro-
duit cette revue. D. Prié, P. Urena et
G. Friedlander synthétisent les récentes
découvertes sur l’homéostasie des phos-
phates, le rôle central du rein et l’axe
FGF23-klotho. La part des phosphates
dans la calcification vasculaire est synthé-
tisée par CM Giachelli. Silver et Naveh
redéfinissent la relation (complexe!) entre
phosphore, PTH, calcium et vitamine D et
comment le phosphore régule l’expres-
sion et la production de PTH. Plus prati-
que, A. Hutchison détaille mode d’action,
avantages et inconvénients des chéla-
teurs des phosphates actuellement dis-
ponibles. Il évoque aussi le rôle de l’infor-
mation et de l’éducation du patient.
■
8 - Prise en charge du patient
avant la dialyse
McClellan WM, Wasse H, McClellan AC,
Kipp A, Waller LA, Rocco MV. Treatment
center and geographic variability in pre-
ESRD care associate with increased mor-
tality. J Am Soc Nephrol. 2009 May;
20(5): 1078-85.
Il est maintenant reconnu que la prise en
charge tardive du patient par un service de
néphrologie est facteur de surcoût mais
aussi de surmortalité la première année de
dialyse. La prise en charge tardive est pro-
bablement centre ou médecin dépendant.
Le taux de mortalité en dialyse peut être
associé à ces 2 facteurs, prise en charge
tardive et effet-centre. Ces réflexions de
bon sens demandaient encore à être véri-
fiées. Tous les 30000 patients incidents de
5 régions aux USA ont été inclus. 51 %
des patients avaient eu une prise en
charge en prévision de la dialyse. La prise
en charge tardive est associée à un risque
1,5 fois plus élevé de mortalité en dialyse.
Il existe un effet centre et la mortalité de
chaque centre est associée au % de prise
en charge précoce. Cette relation et la
variabilité entre centres persistent même
après ajustement aux autres variables et
en particulier les caractéristiques de la
population. Au total, une prise en charge
adéquate en dialyse ne suffit pas, la struc-
ture doit pouvoir améliorer le % de prise en
charge de patients à un stade précoce.
9 - Rosiglitazone et mortalité
Ramirez SP, Albert JM, Blayney MJ,
Tentori F, Goodkin DA, Wolfe RA, et al.
Rosiglitazone is associated with mortality
in chronic hemodialysis patients. J Am
Soc Nephrol. 2009 May; 20(5): 1094-101.
Les glitazones sont de plus en plus utilisées
dans le traitement du diabète. Une méta-
analyse récente dans la population géné-
rale a mis en évidence une relation entre
rosiglitazone et risque d’infarctus. Ramirez
et col. ont utilisé les données de DOPPS-
USA pour explorer cette relation chez le
patient dialysé. Comparée aux autres anti-
diabétiques oraux, la rosiglitazone est
associée à un risque cardio-vasculaire plus
élevé (OR: 1,38) ou d’hospitalisation pour
IDM (x 3,5). Comme pour de nombreux
médicaments et les autres glitazones, les
études initiales n’avaient pas inclus de
patients en IRC. Sachant l’incidence de
l’IRC dans le diabète et le nombre croissant
de patients IRC diabétiques, une étude
randomisée apparaît nécessaire.
■
10 - Médecines alternatives et
transplantation
Nowack R, Balle C, Birnkammer F, Koch
W, Sessler R, Birck R. Complementary
and alternative medications consumed by
renal patients in southern Germany. J Ren
Nutr. 2009 May; 19(3): 211-9.
L’utilisation de compléments alimentaires
et les médecines alternatives sont très à la
mode, en particulier les thés à base
d’herbe (plus ou moins chinoises), les jus
de fruits ou de légumes variés (et exoti-
ques) et les compléments minéraux. Une
plus grande consommation de ces pro-
duits est connue dans les maladies chro-
niques et peu étudiée en néphrologie.
Cette enquête ne fait pas toujours partie
de l’interrogatoire, notamment chez nos
patients dialysés (HD) qui prennent déjà
beaucoup de médicaments. L’enquête
est parfois ciblée chez le transplanté (TR)
sur des consommations connues comme
à risque (jus de pamplemousse, potion St
John Wort). Une étude par questionnaire
a été réalisée chez les patients HD ou TR
de 5 centres du sud de l’Allemagne (donc
proches de nos habitudes). Les résultats
sont un peu inquiétants d’autant que la
majorité des médecins n’est pas au cou-
rant de cette prise ou n’en connaît pas les
effets secondaires. 57 % des HD et 49 %
des TR prennent des compléments (thé
aux herbes, vitamines, minéraux, phyto-
thérapie, jus de citron). Certains produits
(détaillés dans l’article) ont une action sur
la fonction rénale et/ou une interaction
avec les traitements. 40 % des produits
consommés sont potentiellement à risque
et si 70 % des TR en avaient parlé à leurs
médecins, seuls 50 % des HD l’ont fait. Le
problème étant que la majorité des néph-
rologues n’avait pas de notion sur les
effets supposés des plantes ingérées!
■
Bonus
La consommation d’alcool n’est pas béné-
fique pour la santé. Une récente polémique
a récemment éclaté en France sur les ris-
ques de cancer versus l’effet bénéfique
supposé d’une consommation modérée
de vin (rouge!) sur l’endothélium vasculaire,
dont malheureusement nous nous étions
fait l’écho dans cette chronique. Une nou-
velle étude parue dans l’American Journal
of Clinical Nutrition (à priori une référence)
risque encore de semer le doute dans nos
esprits. La consommation excessive d’al-
cool est un risque connu pour de nom-
breuses pathologies chroniques, en parti-
culier osseuses. L’article de Tucker exa-
mine la relation entre consommation
(modérée) d’alcool et masse osseuse chez
plus de 2000 sujets. Un questionnaire et un
examen sont réalisés tous les 4 ans de
1971 à 2001 et un DEXA a été pratiqué lors
des 2 dernières visites (1996-2001). Une
première découverte (!): les hommes
consomment plutôt de la bière et les fem-
mes plutôt du vin. Une consommation
modérée est associée à une meilleure
masse osseuse, surtout avec la bière, et la
consommation de liqueurs est plutôt délé-
tère. Cela n’étonnera pas les buveurs de
bière, mais pose la question cruciale: ce
n’est peut-être pas la quantité d’alcool qui
est en jeu, puisque les liqueurs en contien-
nent plus! Le responsable désigné serait le
silicone contenu dans la bière, plus exacte-
ment l’acide orthosilicique (sic!) qui serait le
constituant majeur de la bière et connu
pour ses propriétés stimulantes de la for-
mation osseuse. Comme le concluent les
auteurs: il ne s’agit absolument pas de
recommandations (“mais au moins, on sait
ce que l’on boit” note du rédacteur). Tucker
KL, Jugdaohsingh R, Powell JJ, Qiao N,
Hannan MT, Sripanyakorn S, et al. Effects
of beer, wine, and liquor intakes on bone
mineral density in older men and women.
Am J Clin Nutr. 2009 Apr; 89(4): 1188-96.
19, avenue de l’Europe - BP 62270 - 31522 RAMONVILLE SAINT-AGNE CEDEX
Tél. 05 61 75 27 27 - Fax 05 61 75 00 43 - www.hemotech.fr
- Imprimé sur papier recyclé Cyclus
Dr Philippe Chauveau
1
/
4
100%