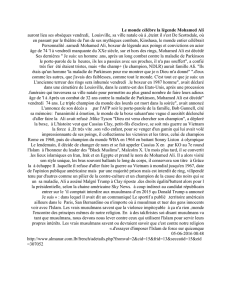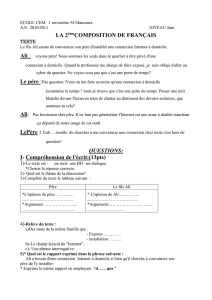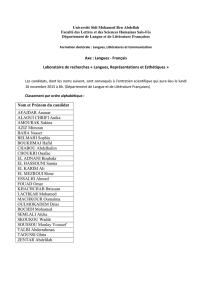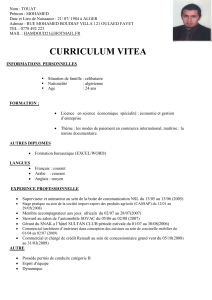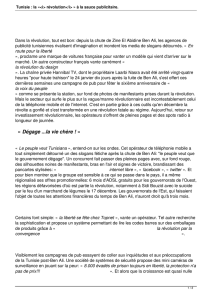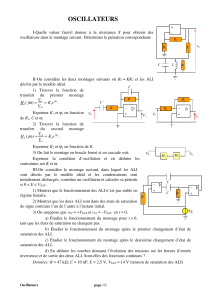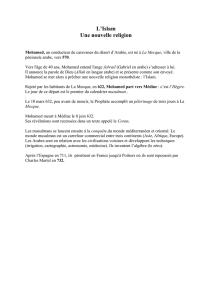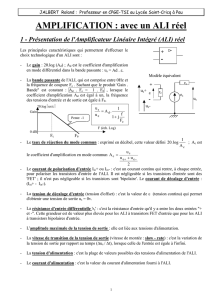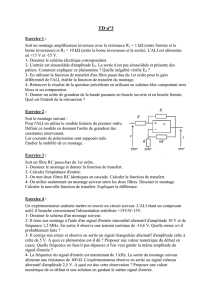lire l`interview complète

Etienne Minoungou est homme de théâtre au Burkina Faso, travaillant sans relâche pour introduire
la culture partout où elle manque en Afrique. C’est incroyable comme il ressemble à Ali, il a aussi
sa force, son charisme et son intensité. Sautant sur la comparaison, le comédien prend le relais,
enfile des gants de boxe, nous raconte sa réalité de « combattant » africain et envoie un uppercut
bien placé aux préjugés tenaces.
Etienne, vous êtes à l’affiche de « M’appelle Mohamed Ali » de Dieudonné Niangouna. Vous avez
dit « Dieudonné Niangouna a écrit ce texte en pensant à ‘ma gueule’ »? Expliquez-nous…
On a souvent souligné ma ressemblance physique avec Mohamed Ali. Je voulais l’interpréter au
cinéma mais j’en ai été empêché par Will Smith, qui a fini par obtenir le rôle (rires). Heureusement il
me restait une chance au théâtre. J’ai donc demandé à Dieudoné Niangouna de me proposer un
texte, et il a accepté. « M’appelle Mohamed Ali », en plus de l’histoire formelle, traite aussi de nos
combats en Afrique pour la culture, pour le théâtre. Il y a donc beaucoup d’emprunts à ma vie privée.
Le spectacle consiste en un croisement, un mélange entre le personnage mythique et moi-même, en
ma qualité d’acteur de théâtre et d’homme de culture africain. C’est autour de cet aller-retour que
s’articule la pièce.
Vous avez été personnellement confronté à ce combat, évoqué dans la pièce ?
Oui. Quand on parle de Mohamed Ali, on ne parle pas exclusivement du boxeur, on parle de
quelqu’un qui s’est servi du ring pour prendre la parole. De ce point de vue, prendre la parole en
Afrique représente également un combat : pour l’élargissement des libertés, la défense d’idées, et le
démantèlement des préjugés persistants, notamment sur le théâtre. Il est particulièrement difficile
d’exercer ce métier dans un pays où il manque tout, et où très peu de place est accordée à la culture
et aux arts. Pourtant, notre conviction est que la culture participe activement au devenir de toute
société. C’est à cet endroit-précis que le combat de Mohamed Ali rejoint le combat d’une Afrique qui
a envie de gagner, qui a envie de se défaire des préjugés qui l’emprisonnent.
Quel est le questionnement que vous souhaiteriez voir surgir chez le spectateur ?
Si le ring est un espace de combat, la scène est un espace de dialogue. Mon but est qu’au terme de
cet échange, le spectateur réalise qu’on se connait mieux, qu’on partage la même culture, et qu’on
peut franchir les barricades, faire confiance et baisser la garde. Dans le contexte actuel, où la peur et
les préjugés s’amplifient, c’est en baissant sa garde et en accordant sa confiance à l’autre qu’il sera
possible de trouver un terrain de partage.
En parallèle à votre métier de comédien, vous êtes l’initiateur des Récréâtrales de Ouagadougou,
vous pouvez nous en parler ?
Il s’agit des Résidences d’Écriture, de Création et de recherche Théâtrale, qu’on a mis en place en
2002 pour permettre aux artistes et professionnels du théâtre (qu’il s’agisse d’auteurs, metteurs en
scène ou comédiens) d’aller au bout de leur démarche créative, et de proposer des spectacles de
qualité à la fois à un public local, ainsi que sur la scène internationale. Les Récréâtrales, c’est donc 5
mois de travail tous les deux ans pour des artistes professionnels issus d’Afrique et d’ailleurs, qui
viennent écrire, parfaire leurs œuvres, ou raffermir leurs profils respectifs via des ateliers spécifiques.
Nous proposons également des ateliers pour les médiateurs culturels, qui forment le lien entre la
création artistique et la réception des publics.

La particularité propre aux Récréâtrales est que nous sommes volontairement sortis des lieux
institutionnels du théâtre pour investir le quartier populaire de Gounghin à Ouagadougou, où les
pièces se jouent dans les cours familiales. Pour cela, nous avons fabriqué des structures mobiles et
fait l’acquisition de matériel son et lumière spécifique afin de rendre les spectacles adaptables à
chaque lieu sans appauvrir l’expérience scénique. De ce fait là, c’était une révolution. Le théâtre en
Afrique n’est pas exclusivement destiné aux bourgeois, aux intellectuels et aux artistes. Il est
envisagé comme un lieu de discussion sociale qui doit être populaire. En l’amenant dans les cours
familiales, on élargit le spectre du public qui a accès au théâtre. Cela donne un sens supplémentaire
au travail des artistes ; on ne crée pas pour une audience privilégiée, on crée pour tout le monde.
Cette vision horizontale de la création théâtrale est-elle répandue en Afrique ?
Au début nous avons rencontré certaines difficultés, car les espaces tels que les centres culturels
français, seuls véritables lieux de création et de diffusion dans la plupart des capitales africaines,
constituaient la règle en matière de théâtre. Développer des espaces alternatifs n’a pas été une
mince affaire. Mais petit à petit, l’engouement s’est fait ressentir et a fini par convaincre tout un
chacun que cette manière de fonctionner était juste, idéologiquement parlant. La cour familiale est
un lieu privilégié de dialogue social en Afrique et, pour cette raison, elle représente un espace
légitime de diffusion pour ce théâtre envisagé comme populaire. En outre, une attention particulière
est portée sur les décorations de rue durant l’événement, ce qui suscite une curiosité
supplémentaire. Lors de la dernière édition, nous avons ouvert 9 cours familiales, chacune
accueillant entre 250 et 300 personnes par soir.
Comment s’est passée ta rencontre artistique avec ce personnage emblématique qu’est
« Mohamed Ali » ?
Tout le monde a en mémoire le fameux combat de Kinshasa qui fut retransmis en direct le 30
Octobre 1974. J’avais 6 ans à l’époque, et je me rappelle de mon père boxant et envoyant des
uppercuts dans le vide, au rythme du combat radiodiffusé. Je me rappelle aussi qu’on dessinait Ali en
tenue de boxeur, étant enfants. C’est quelque chose qui nous a beaucoup marqué.
Mais ce qu’on a surtout retenu d’Ali outre ses capacités techniques, c’est qu’il ne considérait pas tant
le ring comme un lieu de combat que comme un lieu de prise de parole politique. Il a utilisé le ring
pour arracher cette parole et pour défendre à la fois les luttes émancipatoires des noirs, et l’Afrique
face à la colonisation occidentale. En tant qu’homme de théâtre, on ne peut passer à côté d’une
figure aussi forte. Ensuite il y a cette ressemblance physique qu’on me prête, à tort ou à raison
(rires), mais qui m’a néanmoins interpellé.
En bref c’était écrit ? (rires)
Oui ! Mais il reste que c’est un personnage exceptionnel, et un véritable personnage théâtral. Il y a
tout chez Ali : la beauté, la grâce, un destin singulier ; il y a cette scène aux Jeux Olympiques, où il
jette sa médaille dans le Mississipi lorsqu’on lui refuse l’accès dans un espace réservé aux blancs, et il
y a ce refus de partir combattre au Viêt-Nam alors qu’aucun combat interne n’est entrepris en faveur
des laissés pour compte dont il fait partie. Enfin, il y a cette image magnifique de Mohamed Ali qui,
atteint de la maladie de Parkinson, allume la flamme des Jeux Olympique d’Atlanta. L’image de ce
héros moderne qui allume la flamme en tremblant est un symbole très fort pour le monde. Dans une

période marquée par le culte du corps et la starification des sportifs, il incarnait à ce moment précis
la beauté d’un grand homme, et aussi sa fragilité. C’est une image qui m’a beaucoup marqué.
De qui est votre parole sur scène finalement? Celle du comédien, de l’auteur, du boxeur ? On peut
parler d’un même combat ?
C’est là tout l’exercice, complexe, de cette pièce. Je pense qu’un auteur écrit toujours pour lui-
même. Même s’il écrit pour moi je sais qu’il écrit son histoire. Dieudonné Niangouna est l’un des
auteurs africains les plus brillants de sa génération. Sa langue est flamboyante, féroce. Il a vécu la
guerre, échappé aux milices, et il investit le théâtre comme un espace de résistance. Je me saisis
donc de la parole de cet auteur. On porte également la parole de Mohamed Ali puisque, dans cette
pièce, on rappelle sa vie, son combat. Ce combat c’est aussi le mien car sur le plateau c’est mon
corps, mon âme, ma vie. J’essaye, à juste distance, d’être respectueux de la parole de Dieudonné
Niangouna l’auteur, de porter le rêve de Mohamed Ali, et d’y introduire mon propre rêve aujourd’hui
afin de le partager avec le public. La construction de la pièce part de cette triple parole, qui s’ancre
dans cette belle allégorie qu’est le ring. C’est de la boxe donc on reçoit des coups, et on en donne.
Mais on crée aussi un espace de discussion avec le public qui est venu regarder.
À l’issue de ses combats, ce n’était pas Mohamed Ali qui gagnait en tant qu’homme, c’était le rêve
qu’il portait. C’est pour cette raison qu’il a battu des adversaires techniquement plus doués.
Foreman, Frazier étaient des machines à tuer, mais Ali gagne par l’intelligence, et parce qu’il il ne
monte pas seul sur le ring : il y monte porté par tout un peuple. Pour moi c’est très fort. Quand je
monte personnellement sur le ring, je ne monte pas seul. Je monte avec Dieudonné Niangouna, je
monte avec Mohamed Ali, et je monte avec un peuple. Je monte avec tous ceux qui aujourd’hui au
bord de la route, au bord du chemin, cherchent leur manière d’appartenir au monde.
Comment la pièce a-t-elle été reçue jusqu’à présent ?
Beaucoup de gens viennent car la figure de Mohamed Ali les appelle, et qu’ils ont envie de revivre
ses combats. La première réaction est souvent la surprise car ce qui est proposé ne correspond pas
forcément à ce qu’ils attendaient de la pièce. Ensuite, en Afrique, il y a une identification rapide à la
figure et aux idées qui sont présentées à travers la pièce. À Avignon et en Suisse, on perçoit un
certain malaise, mais dans le bon sens : c’est un vrai combat, on reçoit des coups, et il y en a qui
résistent, qu’il faut travailler aux poings là où certains sont K.O. au 3ème round. Sur d’autres il faut
revenir, remettre le combat en quelque sorte.
J’expérimente cette diversité dans le rapport à la pièce, mais au fur et à mesure que je joue, une
chose apparait, limpide : le théâtre a besoin d’habiter cet espace de partage et de discussion. On
vient au théâtre pour prendre du plaisir bien sûr, mais également pour confronter ses idées à
d’autres idées. Et il ne faut pas avoir peur d’y aller franchement. La bataille des idées doit avoir lieu,
et quand elle a lieu, quelle que soit sa férocité, un dialogue s’instaure. Cela engendre généralement
des discussions supplémentaires une fois la pièce terminée. Pour certains, c’est déstabilisant, là où
d’autres estiment qu’il est vivifiant de revenir sur l’histoire. Car les comptes ne sont pas soldés. On a
tendance à le croire, mais c’est faux, et il est important de pouvoir remettre les choses en question
pour avancer vers ce que j’appelle, peut-être naïvement, une forme de fraternité universelle.

On vous a vu au Public dans « Georges Dandin in Afrika » d’après Molière en 2011. Quels sont vos
projets à venir, après « M’appelle Mohamed Ali » ?
J’entame une période exceptionnelle car, en plus de ma présence à l’affiche de « M’appelle
Mohamed Ali » au Public (du 14/01/15 au 14/02/15), je commence à répéter au théâtre des Martyrs
pour un autre seul en scène, sur un très grand texte d'Aimé Césaire, « Cahier d'un retour au pays
natal ». L’œuvre a été écrite en 1956 dans le contexte de la décolonisation et des revendications
indépendantistes des noirs ainsi que des peuples d’outre-mer. Cette parole a retentit très fortement
à l’époque. Cette interprétation s’inscrira pour moi dans une logique de continuité avec « M’appelle
Mohamed Ali ». C’est un joli challenge artistique.
On vous souhaite tout le meilleur pour ces deux projets. Merci Étienne, et bonne continuation !
1
/
4
100%