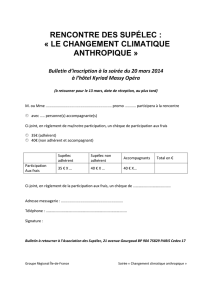Discours de remise des diplômes Supélec 2004

REMISE DES DIPLOMES DE LA PROMOTION 2004
17 septembre 2004
Discours de Jean-Jacques Duby
Parrain de la promotion
Merci Alain Bravo. Merci de m’avoir permis de revenir m’adresser à la Promotion 2004 pour
la remise de ses diplômes, et de m’adresser aussi aux parents et amis qui sont venus
nombreux pour cette cérémonie.
Il y a trois ans, presque jour pour jour, j’accueillais cette promotion 2004 par visioconférence
sur les trois campus de l’Ecole. Mes premiers mots, je me rappelle, avaient été pour vous
féliciter d’être rentrés à Supélec.
Je voudrais aujourd’hui vous féliciter pour en être sortis, et surtout pour en être sortis
diplômés. Car il ne suffit pas de rentrer à Supélec pour en sortir diplômé : l’Ecole a une
tradition d’exigence pour décerner son diplôme, de contrôle de qualité pour parler en termes
d’ingénieur, et vous avez satisfait à ces contrôles tout au long de votre scolarité. Quelques-uns
de vos camarades ne l’ont pas fait, ce qui confirme vos mérites : bravo à toutes et à tous !
Une autre tradition de Supélec est que le discours du parrain de promotion comporte deux
parties : dans la première, le parrain évoque sa carrière à titre d’exemple – non pas au sens
d’exemple à suivre, car il n’y a pas un modèle de carrière, mais au sens d’échantillon, si j’ose
dire, de spécimen, de ce que l’on peut faire dans la vie en sortant d’une grande école. Dans la
seconde, la plus difficile, le parrain est tenu de donner à ses jeunes filleuls quelques conseils
que son âge et son expérience sont censés légitimer. Les jeunes américains de ma génération
disaient : « never trust anyone over thirty » – heureusement, votre génération est moins
radicale et plus ouverte, et j’espère que vous m’écouterez…
Puisque l’ironie du sort veut que ma carrière se termine au moment précis où la vôtre
commence, c’est pour moi le moment propice pour faire comme Maurice Constantin-Weyer,
pour « me pencher sur mon passé ».
Si je devais caractériser ma carrière en une phrase, je dirais, d’abord, que j’ai eu beaucoup de
chance, mais que j’ai su la susciter et en profiter ; ensuite, que je n’ai jamais eu de plan de
carrière, mais une idée directrice, toujours la même, qui m’a guidé dans mes choix.
Je vous l’avais avoué il y a trois ans, je ne suis pas ingénieur – quoique l’Amicale m’ai fait le
plaisir et l’honneur de me nommer membre d’honneur, nous pourrons donc dans quelques
minutes nous appeler « cher camarade » ! J’ai fait la rue d’Ulm, et la première grande chance
que j’ai eue est d’avoir choisi un sujet de thèse en logique mathématique, à un moment – au
début des années 60… – où l’on croyait que les calculateurs électroniques – on ne disait pas
encore « ordinateur » – allaient servir à démontrer des théorèmes. On attend toujours que les
ordinateurs les plus puissants d’aujourd’hui démontrent un théorème significatif, c’est vous

2
dire qu’avec les machines de l’époque, c’était parfaitement utopique. Mais qu’à cela ne
tienne, j’avais commencé à publier sur le sujet, un autre mathématicien qui travaillait au
laboratoire de recherche d’IBM de Yorktown Heights aux Etats-Unis m’a écrit (il n’y avait
pas Internet à l’époque…), invité à faire une conférence, et en fin de compte IBM m’a
proposé de m’embaucher comme chercheur à Yorktown.
Rétrospectivement, c’était un énorme coup de chance, car je me suis retrouvé au bon endroit
au bon moment, c'est-à-dire parmi les scientifiques d’horizons divers qui créaient
l’informatique, dans l’entreprise qui allait dominer les premières années de l’informatique et
imposer ses produits et ses solutions. Inutile de vous dire que, très vite, je me suis désintéressé
de la fin, à savoir la démonstration automatique de théorèmes, pour m’intéresser aux moyens,
c'est-à-dire à l’informatique. D’autant plus que je m’étais rapidement aperçu que je pouvais
faire passer mes idées et le résultat de mes travaux dans des produits qui allaient être utilisés
par des milliers de personnes – à l’époque des milliers, plus tard des millions – : ce qu’on
appelle aujourd’hui l’innovation, ce que le premier directeur de l’Ecole, Paul Janet, appelait
« la science au service de l’action ». Ce sera à la fois cette conviction de la puissance de la
science et la volonté de l’appliquer à résoudre des problèmes concrets qui me guideront au
cours de toute ma carrière – et qui devaient naturellement m’amener à la terminer à Supélec,
puisque cette conviction et cette volonté étaient aussi celle de Paul Janet, qui était lui aussi
normalien.
Pendant un peu plus d’un quart de siècle, j’ai donc occupé diverses fonctions dans la
recherche et le développement d’IBM, dans différents laboratoires, aux Etats-Unis et en
Europe, en grimpant rapidement dans la hiérarchie car les informaticiens étaient peu
nombreux et les besoins croissaient très vite. Pendant quelque temps, j’ai gardé des activités
académiques et j’ai enseigné dans différentes universités et écoles en France et à l’étranger,
aux Etats-Unis. J’ai été deux ans Professeur Extraordinaire à l’Université de Genève – cela
fait très bien sur un CV ou une carte de visite, mais en fait, il faut savoir qu’en Suisse,
Professeur Extraordinaire, c’est moins bien que Professeur Ordinaire…
J’ai eu une autre parenthèse dans ma carrière à IBM, qui s’est aussi révélée une chance
extraordinaire – vraiment extraordinaire, au sens de mieux qu’ordinaire – : Jean-Pierre
Chevènement, qui était alors Ministre de la recherche et mettait en place une réforme du
CNRS pour l’ouvrir davantage vers l’industrie et les applications, m’a proposé de venir
comme Directeur Scientifique au CNRS pour mettre en place cette réforme. C’était une
chance extraordinaire car cela m’a apporté l’expérience du management dans la fonction
publique, l’expérience du travail en prise directe avec les niveaux politiques, et surtout m’a
permis de connaître les milieux scientifiques dans toutes les disciplines, ce qui allait m’être
très utile par la suite.
Ce n’était pas une chance aussi extraordinaire sur le plan financier, car mes revenus s’étaient
trouvés divisés par trois – sans compter les stock options, qui n’étaient pas très favorables au
CNRS… – mais il faut savoir ce que l’on veut. Cela étant, quand IBM est revenu me chercher
trois ans plus tard, ils avaient des arguments auxquels je n’ai pas pu résister, et j’ai pris la
responsabilité de la R&D en France puis en Europe.
A la fin des années 80, j’ai un désaccord grave avec la direction américaine d’IBM sur sa
politique de Recherche et Développement en Europe : je démissionne. Nouveau coup de
chance : au même moment, le président de l’UAP, ayant observé que tous les grands groupes
du secteur industriel ont une structure de R&D, se demandait si une telle structure ne pourrait
pas aussi être intéressante pour un grand groupe d’assurance. J’étais moi-même, comme
toujours, convaincu que la science pouvait servir dans l’assurance comme partout ailleurs,
bien que je ne connaissais rien à l’assurance, mais c’était une raison de plus pour me laisser

3
tenter, et je rejoins l’UAP comme Directeur Scientifique. C’est là que mon expérience à IBM
et surtout au CNRS m’a été utile, car ce sont presque toutes les disciplines scientifiques qui
peuvent servir dans l’assurance : les mathématiques pour les statistiques, bien sûr, mais aussi
la physique et la chimie pour les risques industriels, les sciences de la terre pour les risques
naturels, les sciences de la vie pour la santé, et les sciences humaines et sociales à peu près
partout.
En 1995, j’ai un choix cornélien à faire puisque l’on me propose la Direction Générale de
Supélec. Très vite, je décide que c’est pour moi la chance de mettre toute mon expérience au
service des jeunes, donc de l’avenir. Bien m’en a pris, car l’UAP était absorbée par AXA…
mais ce n’est pas pour cela que je me félicite d’être venu à Supélec, car je n’aurai pas pu
trouver un meilleur job pour les neuf années dernières de ma carrière.
Donc, vous voyez, pas de plan de carrière, mais des opportunités à saisir, avec une idée
directrice très Supélecienne : « la science au service de l’action ». Alors, encore une fois, ma
carrière est un exemple spécimen, pas nécessairement un exemple à suivre, mais je vais
maintenant essayer, comme le veut la tradition, d’en tirer quelques conseils – que vous
suivrez ou que vous ne suivrez pas, bien sûr…
Pour vous donner ces conseils, je vais m’inspirer de la célèbre « campagne des verbes » du
Club Med. En 1976 – vous n’étiez pas nés… – le Club Méditerranée avait lancé une
campagne d’affichage publicitaire qui est restée un modèle du genre, toujours cité dans les
écoles de commerce. On l’a appelée la « campagne des verbes » parce que, sur chaque
affiche, on voyait une très belle photo et un seul mot, un verbe à l’infinitif : « dormir », on
voyait un hamac entre deux cocotiers dans un lagon de rêve ; « nager », on voyait un plongeur
au milieu de poissons extraordinaires ; « aimer », on voyait deux transats côte à côte avec un
garçon et une fille se tenant par la main ; etc. Alors, je vais faire moi aussi ma campagne des
verbes, mais ce ne sera pas les mêmes verbes, et il n’y aura pas de photos…
Le premier verbe sera « oser ». La théorie économique montre qu’il n’y a pas de profit sans
risque. Je crois que cela est vrai aussi pour une carrière, ou tout du moins qu’une carrière sans
risque ne peut pas apporter autant de satisfaction et de récompense qu’une carrière où l’on a
pris des risques. C’est ce que j’ai fait personnellement, bien sûr j’ai connu quelques échecs,
mais j’ai toujours pu rebondir, souvent d’ailleurs en prenant un nouveau risque.
Le deuxième verbe est « changer ». Changer de fonction, changer de lieu de travail, changer
de métier, changer d’employeur, mais changer. Osez changer. C’est le changement qui vous
force à vous remettre en cause, à ne pas vous contenter de vos acquis, à progresser. Dans mon
cas personnel, Supélec était mon septième employeur et la Direction Générale de l’Ecole mon
quinzième job, et je ne regrette aucun des changements par lesquels je suis passé. D’autant
plus que changer est aussi la meilleure façon d’apprendre.
Car le troisième verbe est « apprendre ». Chaque fois que j’ai eu le choix entre plusieurs jobs,
j’ai pris celui où j’y connaissais le moins, et de préférence où je n’y connaissais rien du tout :
c’est ce que j’ai fait en rejoignant l’UAP, dans une moindre mesure quand je suis parti au
CNRS – et les mauvaises langues vous diront que c’est pour la même raison que j’ai pris la
Direction de Supélec… Apprendre est une des grandes joies de l’existence, et en plus c’est
utile : mon expérience m’a convaincu que tout ce que vous avez appris dans un domaine peut
servir dans un autre : j’ai utilisé au CNRS ce que j’avais appris à IBM, à l’UAP ce que j’avais
appris au CNRS, et à Supélec ce que j’avais appris partout ailleurs. Et quand vous arrivez
dans un domaine nouveau pour vous, vous pouvez toujours apprendre ce qui est nécessaire

4
pour y travailler, mais les connaissances que vous avez apprises dans d’autres domaines, c’est
ça votre avantage compétitif par rapport à d’autres – si vous voulez vous distinguer, bien sûr,
mais je suis sûr que c’est le cas pour tous.
Le quatrième verbe, je n’aime pas beaucoup le mot car c’est un barbarisme et surtout il a été
rabâché dans une autre campagne de pub : il s’agit de « positiver ». Je préfère l’anglais « think
positive », et c’est une chose que j’ai apprise aux Etats-Unis, qui fait la force de la culture
américaine : dans n’importe quelle situation, même en situation d’échec, même si vous n’avez
aucune idée de comment vous allez vous en sortir, il y a toujours quelque chose de positif à
tirer de la situation – quand ce ne serait que comprendre ce qui a pu se passer, à commencer
par analyser les erreurs que l’on a pu commettre. Mon désaccord avec la Direction Corporate
d’IBM m’a contraint à démissionner, mais il m’a permis de connaître un nouveau domaine,
l’assurance, et sans doute aussi de venir plus tard à Supélec.
Le cinquième verbe, c’est « exiger ». Soyez exigeants, et d’abord vis-à-vis de vous-même.
Fixez-vous des objectifs ambitieux : si on essaye, on n’est pas sûr de réussir ; si on n’essaye
pas, on est sûr de ne pas réussir. Visez au plus haut : le roi Ferrante de la Reine Morte de
Montherlant voulait mettre son fils « en prison… pour médiocrité » ; je n’irai pas jusque là,
mais la médiocrité n’est pas pour vous. Vous faites partie des meilleurs, cela vous impose
d’abord des devoirs. Et lorsque vous prendrez des responsabilités hiérarchiques, soyez
exigeants vis-à-vis de vos collaborateurs : ils vous le pardonneront sur le coup si vous êtes
aussi exigeant vis-à-vis de vous-même, et ils vous en seront reconnaissants plus tard.
Oser, changer, apprendre, positiver, exiger…
En conclusion, je voudrais ajouter un sixième verbe, qui vous surprendra peut-être : c’est un
des verbes de la campagne du Club Med…, c’est le verbe « aimer ». Beaucoup d’entre vous
ont profité de leurs études pour rencontrer celui ou celle qui sera le compagnon ou la
compagne de votre vie. Et je sais que beaucoup de jeunes s’inquiètent de savoir s’il est
possible de concilier vie de famille et carrière, bonheur personnel et succès professionnel.
Alors, c’est vrai, il y a parfois un prix à payer pour la carrière, à commencer par l’éloignement
géographique, surtout si vous êtes deux à poursuivre chacun sa carrière. Mais c’est justement
en mettant en commun vos projets, vos ambitions, en vous aidant mutuellement dans la vie
professionnelle comme dans la vie de tous les jours, que vous assurerez à la fois le bonheur de
votre couple et la réussite de la carrière de chacun. Et comme dans tous les changements que
vous allez vivre, il vous faut un point fixe, le plus solide des points fixes, c’est la famille que
vous allez fonder.
Alors, rappelez-vous les ultimes conseils de votre dernier Directeur d’école : osez, changez,
apprenez, positivez, exigez, et aimez.
Et bonne chance à toutes et à tous !
1
/
4
100%