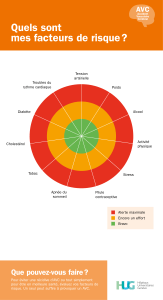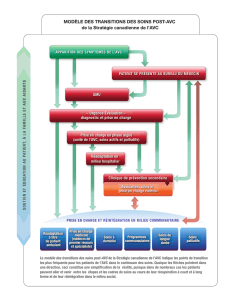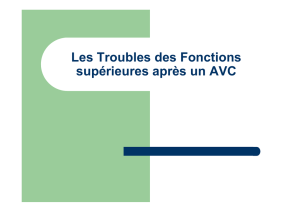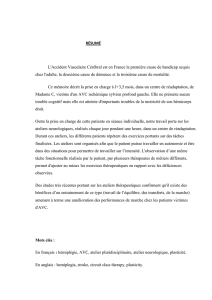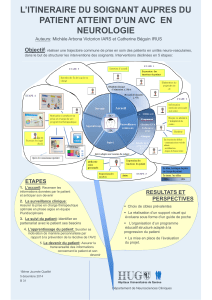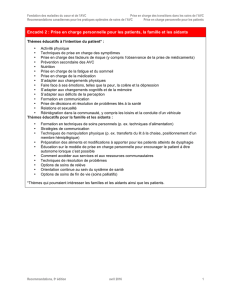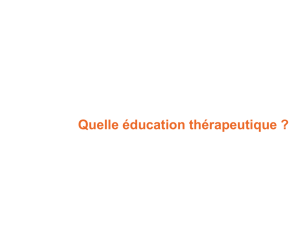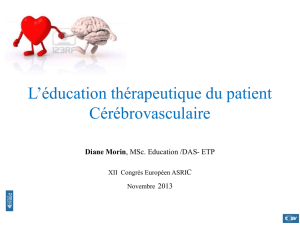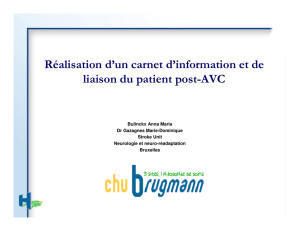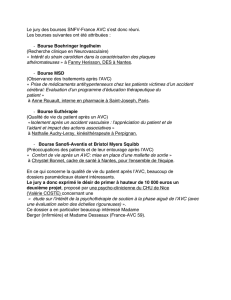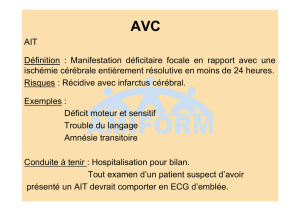ERU 22 - Unadreo

L’Orthophoniste N° 340 Juin 2014
32
Unadréo
Le travail mené conjointement avec la Haute autorité
de Santé et le Laboratoire Unadréo de Recherche
Clinique en Orthophonie (LURCO) a porté sur 4
études dont voici les résultats, cette convention étant
achevée depuis décembre 2013.
L’ERU 22 (outils d’évaluation en aphasiologie) a réalisé
une enquête sur les outils d’évaluation de l’aphasie
utilisés en UNV et services de soins en phase aiguë dans
le cadre du programme pilotes impact clinique accident
vasculaire cérébral de la Haute Autorité de Santé. Ce
travail, intitulé « Indicateurs de pratique clinique AVC »,
a été réalisé dans le cadre d’un partenariat dans le
but d’améliorer les pratiques de l’amélioration de la
qualité et de la sécurité des soins.
Deux études (A et B) ont été menées dans le but de
mettre en évidence des indicateurs de récupération
ou de gravité de l’aphasie en phase aigüe.
Les objectifs de ces études sont a/ la comparaison des
indicateurs de récupération ou de gravité en phase
aigüe de l’aphasie, b/d’analyser l’intérêt de l’utilisation
de la Batterie Informatisée d’Aphasie Version Courte
(BIA-VC), Gatignol et al, (2011) pour l’évaluation de
l’aphasie en phase aiguë, Courleux et al (2012).
Cette première étude (étude A) a mis en évidence :
Pour tous les modules de la BIA-VC, les patients de plus de
60 ans sont significativement moins performants que les
patients de moins de 60 ans ; la différence de performance
est encore plus significative concernant l’expression écrite
(p < 0,01*). Le score NIHSS est également significativement
plus élevé pour les patients de plus de 60 ans (p≤0,05*).
Les patients plus âgés sont significativement plus
atteints. * p < 0.01, ce qui confirme les données de
(Marini et al., 2004). Aucune différence significative de
gravité des troubles langagiers n’est relevée au niveau
du sexe. En revanche, les patients ayant un niveau
bac ou supérieur au bac sont garants de meilleurs
résultats, il existe bien un effet des variables générales
sur la récupération.
Concernant l’effet lié à la pathologie, les scores à T0 ont
mis en évidence que les patients hémiplégiques ont
significativement des scores plus chutés que ceux des
patients sans déficit moteur. *p< 0,05 (EO/EE) - *p< 0,01
(CO/CE). Paradoxalement, aucune différence significative
quant aux troubles langagiers n’a été relevée entre
patients thrombolysés et non thrombolysés.
La seconde (étude B) a porté sur un suivi longitudinal
de 18 mois de patients :
Les hypothèses sont :
Hypothèse 1 : la BIA-Version courte répond-elle aux
objectifs du bilan orthophonique, de manière adaptée
à la phase aigüe de l’aphasie ?
Hypothèse 2 : les résultats obtenus à la BIA-Version
courte, reflètent-ils sensiblement les troubles langagiers
des patients aphasiques ? 6 centres UNV participent
à ce projet. Les résultats arrivent au fur et à mesure,
une synthèse est en cours et les résultats seront publiés
en juin 2014.
Avec 130 000 français touchés chaque année, l’accident
vasculaire cérébral est une urgence diagnostique et
thérapeutique. La mise en place de soins par une équipe
pluridisciplinaire dès l’accident est donc une priorité.
Dans cette équipe, l’orthophoniste tient une place
essentielle puisqu’il permet d’évaluer, via des outils
standardisés, les troubles langagiers qui surviennent
généralement suite à un AVC.
A travers cette étude longitudinale et grâce à un
protocole précis de passations, nous avons voulu
mettre en avant ces indicateurs de gravité ou de
récupération en phase aigüe de l’aphasie. 14 patients
ont été recrutés au niveau national et ont accepté de
participer à cette étude avec un recul sur 18 mois et 4
temps d’évaluation. (Article à paraître).
La troisième étude (Etude C) concerne le plan AVC
2010/2014 :
Ce plan mis en place en 2010, pose les problématiques
de l’AVC mais qu’en est-il exactement des
connaissances de la population française sur l’AVC
et de ses séquelles ?
Après avoir rédigé un questionnaire ciblant les signes
d’alerte, les mécanismes en jeu dans l’AVC, les facteurs
de risque et les conséquences telle que l’aphasie et sa
prise en charge, nous l’avons soumis à 300 personnes
tout venants en fonction du sexe, âge, niveau d’études
et du lieu de vie au sein de la population nationale.
280 questionnaires ont été exploités pour cette étude.
Des approximations et des confusions demeurent
quant à l’AVC dans l’esprit de la population tout venant,
les sources d’information fiables restent floues et
l’intervention orthophonique dans la prise en charge
post-AVC apparaît encore méconnue.
Des difficultés subites pour parler (p=0,04), une baisse
de vision (p=0,04) et une paralysie faciale (p=0,03)
apparaissent significativement en tête des signes d’alerte
et ce, en fonction de la variable « âge ».
En revanche, la faiblesse de la moitié du corps, des
céphalées et la connaissance du numéro d’appel
d’urgence (le 15) ne sont pas connus quel que soit
l’âge, le sexe et le niveau de vie.
Les 18-30 ans connaissent ce numéro à 57% versus 90%
pour les +de 60 ans.
Il existe également un effet du niveau de diplôme sur
le fait d’avoir entendu ou non parler d’aphasie. Les
niveaux plus élevés connaissent le terme AVC alors
que les niveaux plus faibles l’associent à congestion
cérébrale.
De plus, 25% des spécialistes de l’AVC (étudiants en
médecine ou en paramédical, infirmiers, médecins,
etc) ne savaient pas que l’orthophoniste intervenait
au stade aigu de l’AVC lors de l’hospitalisation. Enfin,
52 % de la population tout-venant vont sur internet
quand ils se posent des questions « santé ».
&361PJOUTVSMFQSPHSBNNFQJMPUFTJNQBDUDMJOJRVF
BDDJEFOUWBTDVMBJSFDnSnCSBMEFMB)BVUFBVUPSJUnEF4BOUn
1FHHZ(BUJHOPM5IJFSSZ3PVTTFBVPSUIPQIPOJTUFT
© Jérôme Rommé - Fotolia

L’Orthophoniste N° 340 Juin 2014
33
Unadréo
Par ailleurs, la rééducation orthophonique post-AVC
apparait trop peu prescrite au vu du nombre d’AVC et le
suivi orthophonique des patients post-AVC non optimal.
(Vendenbussche et Gatignol, à paraître).
Cette étude souligne les méconnaissances des français
en matière d’AVC et de prise en charge orthophonique.
Elle doit s’inscrire dans une médiatisation plus large
et plus efficace de l’AVC et de ses séquelles dans la
société. Les résultats de cette enquête ont été présentés
au congrès SOFMER le 19 octobre 2013 à Reims. Une
nouvelle étude, suite aux messages radio diffusés par le
ministère de la Santé en octobre 2013 a été reconduite en
2014. 900 questionnaires ont été reçus, les résultats sont
en cours d’exploitation et seront diffusés en juin 2014.
La prévention chez les jeunes femmes y sera centrale car
il existe une augmentation des AVC chez femmes jeunes
de (- 40 ans) en 2 ans et 17% chez les enfants.
La dernière étude (Etude D) a porté sur les Indicateurs
de Pratique Clinique (IPC) dans les Unités Neuro-
Vasculaires en phase aiguë.
Nous nous sommes intéressés à la prise en charge
paramédicale de l’AVC dès la phase aiguë, plus
particulièrement sur trois de ces IPC intéressant
directement la prise en charge orthophonique à la
phase aiguë de l’AVC, c’est-à-dire durant le séjour du
patient en Unité Neuro-Vasculaire (USINV/UNV). Ces
trois IPC portent sur l’évaluation primaire des besoins
en termes de rééducation/réadaptation, le bilan
diagnostic et la prise en charge rééducative dans
un premier temps, la pneumopathie d’inhalation
dans un second temps.
Ces IPC ont pour vocation d’être des outils d’analyse
et de mise en œuvre de la qualité des pratiques,
communs à l’ensemble des professionnels de la filière
AVC permettant de mesurer et garantir la qualité
des soins.
En nous appuyant sur ces IPC, nous sommes parties du
postulat qu’une prise en charge précoce et spécifique
de l’AVC améliorait le pronostic de récupération. Nous
avons alors cherché, au travers d’un questionnaire
destiné notamment aux orthophonistes des services
d’aigu, à apporter des réponses à ces questions. Ce
questionnaire portait directement sur la prise en charge
paramédicale de l’AVC à la phase aiguë, depuis le délai
avant l’évaluation des besoins jusqu’aux outils utilisés
pour exécuter un bilan approfondi du langage. Nous
leur avons également demandé de remplir un relevé
d’activité du service sur deux semaines afin de pouvoir
effectuer quelques statistiques pouvant répondre à
ces problématiques. Le développement des Unités
Neuro-Vasculaire (USINV/ UNV) en France est au centre
du Plan d’action national AVC 2010-2014.
Les résultats de notre enquête auprès des 220 UNV ont
permis, en partie, d’apporter des données nécessaires
à la validation des trois IPC et également de confirmer
certaines de nos hypothèses. Nous nous sommes
aperçus néanmoins que malgré les nombreuses
recommandations, les évaluations primaires
paramédicales n’étaient pas toutes systématiquement
réalisées. Si elles sont toutes effectuées dans les 48
heures après l’admission du patient, ce n’est pas souvent
avec des outils standardisés et validés. On observe des
disparités importantes entre les services.
Nous pouvons confirmer que les bilans diagnostiques
du langage sont bien effectués grâce à des outils validés
et toujours par un professionnel spécifiquement
formé, ce qui n’est pas toujours le cas des bilans de
dysarthrie.
Nous pouvons également affirmer que, majoritairement,
la rééducation des patients démarre dès le service
d’aigu. Nos résultats ont montré aussi que la présence
de thérapeutes paramédicaux permet une meilleure
prévention et une meilleure prise en charge rééducative
dans son domaine.
Concernant nos questionnements sur le développement
de pneumopathies, les résultats recueillis indiquent
globalement que malgré les mesures mises en place
(évaluation de la déglutition et fréquence des soins de
bouche notamment) des infections se développent.
Néanmoins, les taux relevés se situent dans la moyenne
de ceux rapportés dans la littérature internationale
(article à paraitre).
Ces travaux ont été menés au sein de mémoires de fin
d’études. Toutes nos félicitations à toutes ces jeunes
collègues (Caroline Courleux, Camille Petit, Diane
Pertuisot, Marine Léonard, Marie Simon, Marine
Vendenbussche) pour leur rigueur et investissement.
Bibliographie
Courleux, C., Pertuisot, D., Petit, C., Oudry, M., Weill-
Chounlamountry, A., Gatignol, P.(2012). Indicateurs
de récupération en aphasiologie en phase aiguë –
Expérimentation de la BIA version courte. L’orthophoniste,
312, 32-35.
Gatignol,P , Jutteau, S., Oudry, M., Weill-Chounlamountry,
A. (2011). De l’intérêt de l’évaluation assistée par ordinateur
au bilan informatisé d’aphasie. In Les entretiens de Bichat
(pp. 5-16). Paris : Les entretiens médicaux 2011.
Gatignol, P., ERU 22. (2013). Connaissances en matière
d’AVC et prise en charge orthophonique post-AVC.28eme
congrès de Médecine Physique et de réadaptation-, 19
oct 2013. Reims
Joyeux, N., Oriano, M. (2011). Preliminary survey in the
validation of a new assessment of language in acute stage
of stroke. Abstracts / Annals of physical and rehabilitation
medicine, 54, sup.1, e250.
Marini, C., Baldassarre, M., Russo, T. (2004). Burden of
first-ever ischemic stroke in the oldest old : evidence form
a population-based study. Neurology ; 62(1) : 77-81.
Simon, M., Léonard, M., Gatignol, P. (2014) Les Indicateurs
de Pratique Clinique dans les Unités Neuro-Vasculaires
en phase aiguë de l’Accident Vasculaire Cérébral (AVC).
Soumis
Vendenbussche, M, Gatignol,P. (2014) Enquête sur
les connaissances en matière d’accident vasculaire
cérébral (AVC) et la prise en charge orthophonique
post-AVC. Soumis
1
/
2
100%