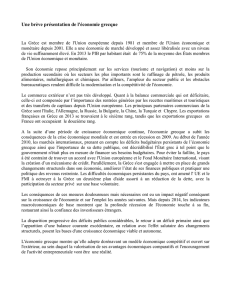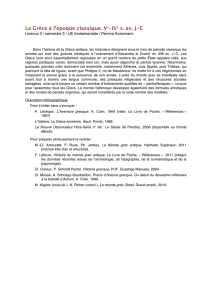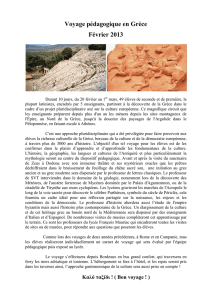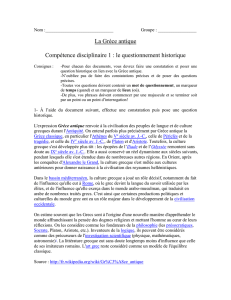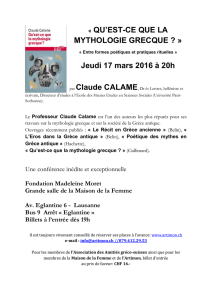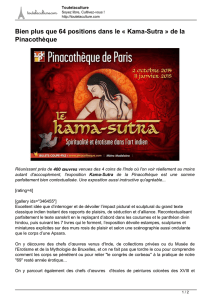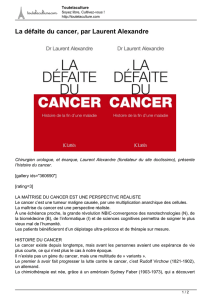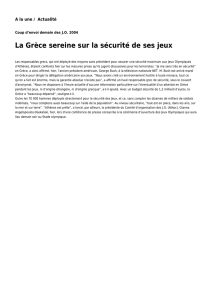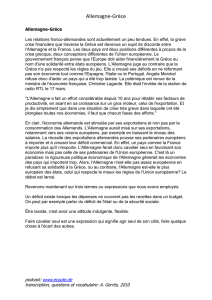Apocalypse Grèce antique ? Les origines de la

Toutelaculture
Soyez libre, Cultivez-vous !
http://toutelaculture.com
Apocalypse Grèce antique ? Les origines de la Grèce à
Saint-Germain-en-Laye
Le motif de la Grèce antique ne peut qu’attirer les foules. Le musée d’archéologie nationale de
Saint-Germain-en-Laye, un peu oublié malgré ses très riches collections, tente le pari en cette
rentrée avec une exposition fleuve sur les prémisses de la civilisation grecque classique. Un
ensemble décevant.
[gallery ids="353329,353327,353325,353326,353324"]
[rating=1]
Pédagogie de la Grèce antique
On conseillera l’exposition pour sa portée pédagogique générale. Pour les enfants ou les
néophytes, le parcours embrasse un point de vue très général et très simple, à la fois
chronologique et thématique. Les cartels introductifs sont très descriptifs et accessibles.
La première moitié de l’exposition s’attache essentiellement aux civilisations du néolithique et
des débuts de l’histoire (le linéaire A et le B, dont une partie seulement est aujourd’hui
déchiffrée et comprise). Ces civilisations dont seule la culture matérielle nous est parvenue,
avec de chiches traces, sont celles de la Grèce du Sud et surtout des îles. On les approche
donc par les habituels vestiges archéologiques : céramiques, sigillées, morceaux d’outils et
quelques figures à portée votive et supports de croyances. Quelques pièces venues du Louvre
viennent donner à corps à cette section consacrée surtout aux Cyclades, à la Grèce maritime…
Les Minoens occupent une importante place. La civilisation crétoise fut en effet particulièrement
étudiée à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, alors que la vogue était grande quant
aux antiquités nationales ou gréco-romaines et que l’archéologie se développait désormais
comme une vraie science. Le sort fait à Evans, présenté comme un découvreur et est un
précurseur, peut être critiqué tant il a beaucoup détruit le site de Cnossos pour mettre en
1 / 4

Toutelaculture
Soyez libre, Cultivez-vous !
http://toutelaculture.com
lumière quelques caractères généraux de ce qui fut l’un des complexes palatial les plus grands
de la Crète minoenne. On appréciera à l’inverse les plans très pédagogiques de la Santorin
d’alors, site majeur étudié comme Délos par l’Ecole française d’Athènes, partenaire de
l’exposition.
La seconde partie est celle des premiers bourgeons de la Grèce continentale et surtout, une
place importante est donnée aux Mycéniens du second millénaire avant Jésus-Christ et à la
Troie d’alors. Ici, la figue de découvreur est évidemment celle de H. Schliemann.
L’archéologue allemand a en effet, dans le dernier tiers du XIXe siècle, été l’un des plus
grands constructeurs de l’archéologie moderne en Grèce, recherchant les traces des
affrontements homériques. Mycènes et Troie sont ainsi l’essentiel du propos. Le trésor
mycénien, avec le masque dit d’Agamemnon et ce qu’on a considéré longtemps comme son
tombeau marquent particulièrement la section.
Le troisième grand mouvement est consacré aux franges nordiques de la civilisation grecque :
Macédoine et Bulgarie actuelle dominent. Ces foyers finissent en effet par participer du monde
égéen avec la conquête de Philippe de Macédoine et surtout avec Alexandre. Nombre de
sources archéologiques y sont d’ailleurs encore à découvrir. Ainsi près de la frontière gréco-
macédonienne a été découvert un grand tombeau lié à Alexandre en cette rentrée 2014, les
recherches mettant en avant le syncrétisme entre symboles macédoniens et représentations
typiques de la Grèce classique finissante.
Déceptions scientifiques
De prime abord, on voit donc les différentes sources de la culture grecque classique et
hellénistique être mise à découvert dans des vitrines très pourvues. Mais le problème est que
l’exposition est construite sur la promesse de l’étude de la Grèce des origines, en partenariat
avec le musée du Louvre et l’Ecole française d’Athènes. On pourrait donc parier sur la rigueur
scientifique du discours, voir même, pour une exposition sur un thème plus que classique, sur
une argumentation fouillée, solide. On le déplore, mais il n’y a rien de cela ici…
Tout d’abord, à trop embrasser on se perd un peu. Pourquoi négliger, hors Troie, la place de
l’Asie mineure dans la naissance de la civilisation grecque ? A l’inverse, pourquoi donner une
si grande place à la Bulgarie et à la Macédoine ? Les éléments égéens y sont en effet
longtemps mineurs et ce n’est que tardivement que l’hellénisation s’y produit, les cités
grecques ne s’y trompant pas au IVe siècle et s’opposant souvent à la monarchie
macédonienne considérée comme barbare, et d’ailleurs alliée des Perses durant les guerres
médiques. Il aurait au moins été salutaire de rappeler le débat sur la participation de la
Macédoine à la culture grecque, débat qui fut houleux et qui est encore discuté par les
spécialistes. Ensuite, cette accumulation s’apparente souvent à une juxtaposition qui ne
permet pas de mettre en relief les structures fondamentales de ces sociétés (palatiales…), de
comprendre leurs évolutions ou d’expliquer les césures fondamentales qui expliquent
l’évolution des foyers civilisationnels et des cultures matérielles. Enfin, que dire du mythe de la
Grèce blanche ? Il est à peine évoqué. La question des Doriens, des peuples de la mer
semblent trop complexes et délaissés si bien qu’apparaissent sur le même plan les vestiges
des différents foyers.
On appréciera cependant une certaine mise au point en fin de parcours sur l’état des lieux de
l’archéologie égéenne aujourd’hui, là aussi très « basique » mais au moins accessible au plus
grand nombre à défaut d’être précise.
2 / 4

Toutelaculture
Soyez libre, Cultivez-vous !
http://toutelaculture.com
La mode crétoise et grecque au début du XXe siècle
Surtout, le dernier quart de l’exposition intéresse parce qu’il apporte quelque chose de plus
que les expositions archéologiques habituelles sur la Grèce ancienne. Elle développe, certes
rapidement, la mode minoenne et plus généralement grecque à Paris (mais on perçoit le même
mouvement dans plusieurs capitales) entre la Belle Epoque et les années 1920. Décors de
théâtre, traces dans les œuvres écrites ou mode et costumes, la Grèce est en effet en vogue.
Les dessins du décor du Phèdre de G. D’Annunzio fascinent par leur pigmentation violente,
comme un écho aux tonitruants débuts de l’Italie fasciste. L’intérêt pour d’Annunzio et les
autres auteurs d’alors n’est souvent pas dénuée de choix politiques, alors qu’au même
moment s’est déjà développé l’école du retour à l’antique prônée par Maurras ou chez les
tenants du Novecento d’ailleurs. Le regard de la peinture métaphysique sur les racines
antiques de l’Europe serait presque intéressant à mettre en regard avec le reste de cette
section…
Enfin, on constate que cette vogue touche toutes les traces qui émergent alors de ces
civilisations rêvées comme celles d’Homère ou d’Hésiode. En effet, l’exposition est composée
pour un gros tiers, peut-être même pour moitié, de reproductions d’objets. Le masque
d’Agamemnon, nombre d’objets précieux ou de fibules ou traces d’apparat sont des copies.
Leur importance peut évidemment être interrogée, mais on voit mal les plus belles coupes ou
urnes quitter les musées grecs qui réclament si souvent le retour de la Frise du Parthénon ou
d’autres objets de leur passé. Cependant, cette vague de reproduction aurait été intéressante à
étudier en tant que telle. En effet, elle reflète bien des aspects de l’Europe de la Belle Epoque :
nouvelles techniques (notamment la galvanoplastie) dans un monde désormais industriel,
tiraillements identitaires sur la question des origines (reproduire un objet mycénien ou un objet
macédonien n’a pas forcément la même charge, les objets ayant trait aux antiquités dites
nationales…) ou encore naissance d’une science archéologique nouvelle et mise en patrimoine
du passé. Toutes ces reproductions auraient pu nourrir l’apport de l’exposition non pour
simplement rappeler les foyers de la Grèce antique, mais pour enrichir la fin de l’exposition,
celle qui a peut-être le plus d’intérêt.
Au final, l’exposition proposée par le musée d’archéologie nationale rate un peu sa cible et se
perd à trop vouloir embrasser. Si les enfants et les non spécialistes pourront trouver du plaisir à
voir les traces des foyers civilisationnels de la Grèce, tous les autres déploreront un catalogue
sans relief et s’attacheront surtout à la dernière partie du parcours qui étudie la réception et les
réinterprétations des découvertes archéologiques dans les sociétés impériales du tournant du
XXe siècle.
Visuel 1 – Grèce des origines - Reproduction de la fresque dite des acrobates au taureau
Cnossos, Crète 1905 - original datant du Minoen Moyen III, 1800-1700 av. J.-C. - peinture à la
gouache sur papier - musée d’Archéologie nationale © Rmn-Grand Palais
Visuel 2 – La Grèce des origines – Affiche de l’exposition
Visuel 3 – La Grèce des origines - Paul Poiret - Costume de Bacchante - mousseline de soie
imprimée, « châle Knossos » de Mariano Fortuny - musée de la Mode de la Ville de Paris © Fr.
Cochennec et E. Emo - Galliera - Roger-Viollet
Visuel 4 – Grèce des origines - Tête de figurine aux bras croisés - Amorgos, Cyclades
2800-2200 av. J.-C. marbre – Louvre © Rmn-Grand palais (musée du Louvre) - Hervé
Lewandowski
3 / 4
1
/
4
100%