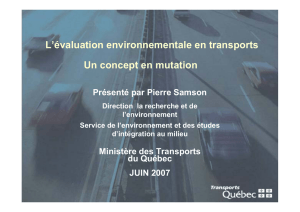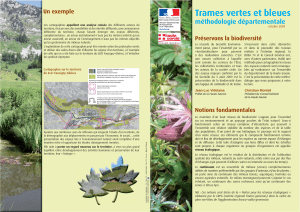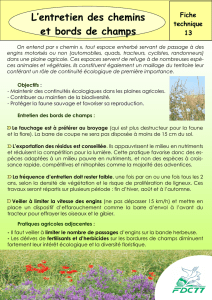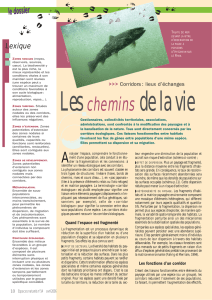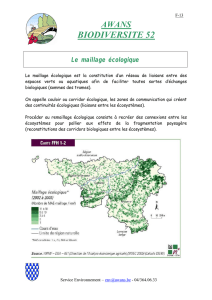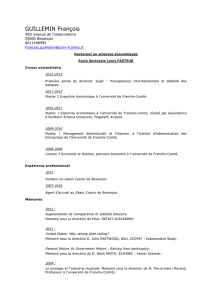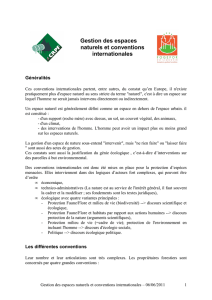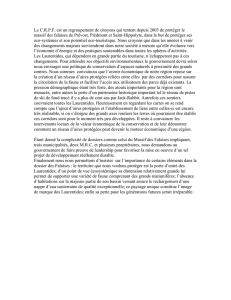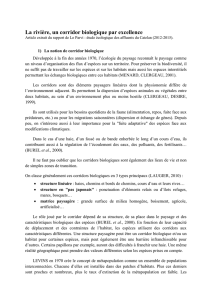Proposition d`une cartographie de réseau écologique régional pour

Rapport de stage, Août 2007
Proposition d’une cartographie de
réseau écologique régional pour la
Franche-Comté
Encadrement :
Université Nancy 1 : Daniel EPRON
DIREN Franche-Comté : Arnaud PIEL
Master 2ème année Foresterie, Agronomie et
Génie de l’Environnement
Spécialité Conservation et Restauration des
Ecosystèmes
Sébastien COULETTE

Source des images, de gauche à droite :
Google image
Document DIREN FC
J Carsignol

Remerciements
Je tiens à remercier, en premier lieu, Monsieur le Directeur Régional de
l’Environnement de Franche-Comté ainsi que les chefs du Service du Développement
Durable, de l’Evaluation Environnementale et des Paysages (SDDEP) et du Service des
Milieux Naturels Aquatiques et Terrestres (SMNAT) pour m’avoir donner l’opportunité de
réaliser ce stage dans d’excellentes conditions.
Mes remerciements vont également à mon encadrant, Arnaud PIEL, chargé de mission
à la DIREN Franche-Comté, qui m’a suivi dans la bonne humeur tout au long de ce stage et
avec lequel j’ai énormément appris.
J’exprime également ma gratitude à tous ceux qui ont participés en répondant à mes
nombreuses questions dans le but d’améliorer mon rendu : Jean Christophe Weidman de la
LPO, Virginie Croquet chargée de mission à l’ONCFS et les membres de l’ONCFS 25,
Charlette Chandosné de la FDCFC, et enfin Luc Terraz et Sandrine Pivard respectivement
chargé de mission et chef du SMNAT.
Merci aussi à Sylvain Lethuillier (vacataire) et Alain Moustache (cartographe) qui ont
accompli un travail remarquable au niveau de la mise en forme des cartes.
Plus généralement, merci à l’ensemble du personnel de la DIREN Franche-Comté qui
a contribué à ce que ce stage se déroule dans des conditions idéales.

1
SOMMAIRE
SOMMAIRE ..............................................................................................................................1
Introduction................................................................................................................................2
Présentation de la DIREN de Franche-Comté........................................................................3
Contexte et objectifs du stage.................................................................................................3
Présentation du site d’étude : la Franche-Comté....................................................................4
1. Méthodes............................................................................................................................6
1.1. Vocabulaire lié à l’écologie du paysage.....................................................................6
1.2. Cartographie et tracé du réseau écologique................................................................7
1.2.1. Mise en forme des cartes pour interprétation.....................................................7
1.2.2. Tracé des corridors et positionnement des points de conflit..............................8
1.2.3. Hiérarchisation des éléments constitutifs du RER.............................................9
1.2.4. Echelle de travail................................................................................................9
1.2.5. Consultation .....................................................................................................10
2. Résultats...........................................................................................................................11
2.1. Effets de la hiérarchisation.......................................................................................11
2.2. Cartographie du réseau écologique de Franche-Comté............................................11
3. Discussion ........................................................................................................................15
3.1. Discussion autour des décisions prises pour la méthodologie .................................15
3.1.1. Espèces utilisées pour l’interprétation des cartes.............................................15
3.1.2. Connexion et délimitation des zones nodales ..................................................16
3.1.3. Efficacité du positionnement des corridors......................................................17
3.2. Interprétation des cartes de synthèse du réseau écologique.....................................18
3.2.1. Tendances générales et principaux enseignements de la consultation.............18
3.2.1.1. Grands obstacles.......................................................................................18
3.2.1.2. Passages faunistiques ...............................................................................19
3.2.2. Le continuum forestier : enjeux et gestion.......................................................21
3.2.3. Le continuum agriculture extensive : enjeux et gestion...................................24
3.2.4. Le continuum aquatique : enjeux et gestion.....................................................26
3.2.5. Mesures de protections et précautions à prendre pour les 3 continuums.........28
Conclusion................................................................................................................................29
Bibliographie............................................................................................................................30

2
Introduction
La convention sur la diversité biologique établie lors de la conférence de Rio en 1992
vise à stopper la destruction des habitats naturels et des écosystèmes et invite les pays
contractants à élaborer des stratégies nationales. De plus, les pays membres de l’Europe ont
adopté en 1995 une stratégie paneuropéenne pour la diversité biologique et paysagère validant
ces objectifs et réaffirmant plus tard la nécessité « d’enrayer la diminution de la biodiversité à
l’horizon 2010 et au delà » (Lieutaud, 2007). Or, à l’échelle mondiale, la destruction des
habitats et la fragmentation des milieux, la plupart du temps d’origine anthropique, ont été
identifiés comme étant les principales menaces pesant sur la biodiversité (Conférence de
Rio, 1992 ; Bennett et Mulongoy, 2006) et la durabilité des populations (Baghli, 2006).
A long terme, il est insuffisant de maintenir la biodiversité dans des milieux naturels
certes protégés, mais isolés les uns des autres (OFEFP, 2001 ; Bennet, 2002). La connexion
des habitats, par l’intermédiaire de corridors écologiques
*
, joue un rôle important dans la
viabilité des espèces (Hargrove et al, 2005). Les notions de corridor et de réseau écologique
*
sont conséquents de la théorie de la biogéographie des îles (Maccarthur et Wilson, 1967 dans
Riecklefs et Miller, 2005), du concept de métapopulation (Levins, 1969 dans Riecklefs et
Miller, 2005) et d’écologie du paysage (bennett, 2004). Les bénéfices directs et indirects des
corridors interviennent dans les domaines de :
- l’écologie (principalement sur le long terme) :
o En facilitant les déplacements des espèces afin de répondre à l’ensemble de
leurs besoins vitaux (Spinelli-Dhuicq, 2005) ;
o En augmentant les effectifs par immigration dans une population en déficit
démographique (Bennett, 1999 dans Vuilleumier, 2003) ou même en favorisant les
recolonisations d’habitats perturbés ou inoccupés (« rescue effect ») (Burel et Baudry, 1999 ;
Hargrove et al, 2005) ;
o En maintenant les flux génétiques (Bennett, 2004) et donc en diminuant
l’érosion génétique qui revêt 2 aspects (Rieckelf et Miller, 2005 ; SETRA, 2005) : La
consanguinité, qui caractérise la reproduction entre individus apparentés. Ses conséquences
sont la hausse de la mortalité juvénile, la diminution de la fertilisation et une plus grande
sensibilité aux agents pathogènes ; la dérive génétique qui survient lorsque l’effectif est trop
réduit. La perte d’allèles diminue le pourcentage de gènes polymorphiques et le taux
d’hétérozygotie. Ce second aspect est toutefois moins sensible chez les espèces de type r
(fécondité élevée, durée de vie courte, maturité précoce, régime alimentaire généraliste) que
celles de type K (le contraire) (Rieckelfs et Miller, 2005).
D’après les faits énoncés précédemment, les chances de survie des espèces menacées et des
espèces spécialistes seront ainsi augmentées (Bennett et Mulongoy, 2006 ; SETRA, 2005).
- l’économie, l’écologie du paysage et la pédagogie :
o En aidant à la création de « réseaux verts et bleus » ou « infrastructures
vertes et bleues » qui mettent en valeur le patrimoine à la fois au niveau biologique mais aussi
paysager, favorisant ainsi la qualité du cadre de vie et l’attractivité des agglomérations
(DIREN FC, 2002) ;
o En donnant des bases de travail pour les nombreuses études traitant des
continuités écologiques, procurant ainsi un gain de temps non négligeable ;
o Egalement en facilitant la communication sur notre vision qualitative du
territoire régional à tous les partenaires par le biais d’une représentation cartographique claire.
- la sécurité routière et la santé publique : en permettant une visualisation par
cartographie des secteurs à risque pour la circulation automobile et ainsi disposer
*
Les termes suivis d’un astérisque sont définis en 1.1.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
1
/
25
100%