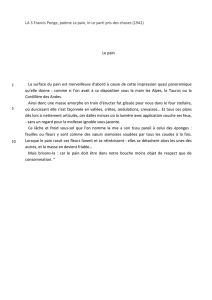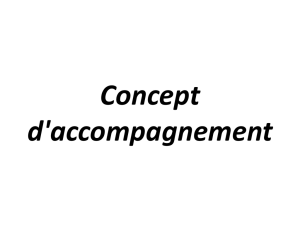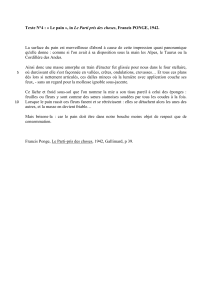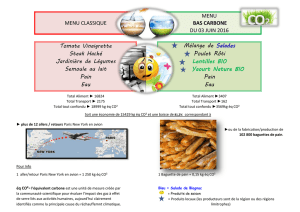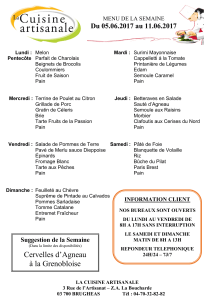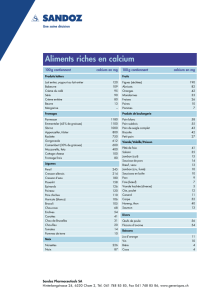Médecine factuelle (EBM) et traitement des douleurs

Méthodologie
Médecine factuelle (EBM)
et traitement des douleurs
André Muller
1
, Eric Salvat
1
, Jacques Kopferschmitt
2
1
CETD, 1 Place de l’Hôpital, 67000 Strasbourg
2
SAU, 1 Place de l’Hôpital, 67000 Strasbourg
L’EBM ou médecine factuelle est l’utilisation judicieuse chez un patient donné des meilleures
preuves disponibles pour traiter la pathologie qu’il présente. Ces preuves sont obtenues à partir
de l’analyse de la littérature de qualité publiée à propos de la pathologie en question. En
matière de douleurs chroniques, plusieurs écueils viennent contrecarrer les bonnes intentions
de l’EBM : l’imprécision de bon nombre de cadres nosographiques, avec, de fait, bien souvent,
une méconnaissance de la physiopathologie correspondante ; la notion de plasticité des voies
nociceptives qui fait qu’une douleur chronique peut modifier les « circuits neuronaux » et leur
réponse aux traitements actifs dans une douleur aiguë ; la plainte douloureuse dépasse
largement le fait physiologique et inclut dans ses déterminants des facteurs personnels et
environnementaux ; ce qui fait que la littérature de qualité est rare. À côté de thérapeutiques
validées (alcoolisation splanchnique dans la douleur solaire d’origine cancéreuse, psychotro-
pes dans les douleurs neuropathiques), d’autres paraissent efficaces, mais il manque des
preuves (péridurale aux corticoïdes dans les radiculalgies, stimulation électrique dans les
douleurs neuropathiques, etc.), et d’autres encore sont, à défaut d’essais bien conduits, à
considérer comme équivalentes au placebo.
Mots clés :médecine factuelle, douleur chronique
La médecine factuelle (ou EBM :
Evidence-Based Medicine,ou
encore : la médecine basée sur des
«preuves ») est définie « comme l’uti-
lisation consciencieuse et judicieuse
des meilleures données (“preuves”)
actuelles de la recherche clinique
dans la prise en charge personnalisée
des patients » [1].
Conçue initialement comme une
stratégie d’apprentissage des connais-
sances cliniques, rendue nécessaire
au regard de la difficulté à trier et à
assimiler la masse croissante d’infor-
mations publiées, elle fait maintenant
partie intégrante de la pratique médi-
cale. La médecine factuelle consiste à
baser les décisions médicales non seu-
lement sur les connaissances théori-
ques, le jugement et l’expérience per-
sonnelle de chaque praticien, mais
également sur des « preuves » scienti-
fiques, tout en tenant compte des pré-
férences des patients. La médecine
factuelle propose des outils et non pas
des règles [2].
Par « preuves », on entend les
connaissances déduites de recherches
cliniques systématiques bien condui-
tes, réalisées dans les domaines du
pronostic, du diagnostic et des traite-
ments, et qui se basent sur des résul-
tats validés et applicables à la pratique
médicale courante. Ces « preuves »
ne remplacent pas le jugement et
l’expérience du praticien : elles les
complètent.
La place croissante prise par la
médecine factuelle n’a pas manqué de
susciter des réactions [3] et des
controverses concernant, en particu-
lier, l’intolérance des fondateurs de
l’EBM Journal [4, 5], les biais des
méta-analyses utilisées pour fonder
les « preuves », les critiques décou-
lant des conclusions contradictoires
de revues systématiques abordant le
même thème [6], l’usage d’études non
m
t
Tirés à part : A. Muller
doi: 10.1684/met.2007.0051
mt, vol. 13, n° 1, janvier-février 2007
30
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

représentatives des malades auxquels les données préten-
dent s’appliquer [7], la méconnaissance de la « littérature
grise » [8], et, de façon logique d’un point de vue poppe-
rien, le fait qu’il reste à l’EBM à faire la preuve de sa
pertinence [6, 9, 10].
L’enthousiasme et les critiques s’estompant, la méde-
cine factuelle trouve une place « raisonnable » dans la
pratique médicale. Les mérites de la médecine factuelle
sont multiples : meilleure attention portée aux essais thé-
rapeutiques, aussi bien de la part des auteurs [11] que des
lecteurs [12] ; élaboration de conférences de consensus
[13] et de recommandations pour la pratique clinique [14]
par la HAS (ex-Anaes) en France, et par les sociétés
savantes ou des groupes de professionnels comme la
Collaboration Cochrane en Angleterre, sous les auspices
du NHS (British National Health Service) aux États-Unis, et
en France ; impact économique, pour peu que les recom-
mandations soient claires, transmises aux praticiens et que
ceux-ci les appliquent [15]. Il y a actuellement une telle
floraison de recommandations que l’EBM se heurte, dans
une étonnante contradiction, à l’un des écueils qui a
présidé à sa conception, à savoir un trop-plein de littéra-
ture difficile à consulter pour le praticien [6].
En matière de prise en charge de la douleur aiguë existent
en France des recommandations concernant l’analgésie
périopératoire, l’analgésie postopératoire, la prise en charge
de la douleur postopératoire
1
et, en matière de douleur
chronique, des recommandations disponibles sur le site
de la HAS et concernant l’évaluation et le suivi de la
douleur chronique chez l’adulte en médecine ambula-
toire ; le diagnostic, la prise en charge et le suivi des
malades atteints de lombalgie chronique ; l’évaluation et
la prise en charge thérapeutique de la douleur chez les
personnes âgées ayant des troubles de la communication
verbale, etc.
Aux États-Unis, un cercle restreint de spécialistes [16]
se consacre à la douleur chronique dans le cadre de la
Collaboration Cochrane (www.cochrane.org) et un
ouvrage dédié à l’EBM dans le traitement de la douleur
était paru en 1998 [17].
Depuis lors, que ce soit dans le domaine des douleurs
aiguës ou celui des douleurs chroniques, il y a une infla-
tion de revues systématiques [18] qui, de façon un peu
désespérante, se terminent toutes par la même conclu-
sion : « Nous ne disposons pas de suffisamment d’études
de bonne qualité pour affirmer que tel ou tel traitement a
fait la preuve de son efficacité », ou plus péremptoire :
« Ce traitement est inefficace dans cette indication » !
Curieusement, on retrouve bien souvent les mêmes
auteurs sur toutes ces revues systématiques, à tel point que
certains en sont venus à se poser la question de savoir si les
auteurs en question voyaient encore des patients, et ce
qu’ils pouvaient bien leur proposer comme traitement !
Le propos de cet article est d’aborder les étapes suc-
cessives d’une démarche d’EBM, de souligner les difficul-
tés inhérentes à ces étapes dans le domaine de la prise en
charge des douleurs, et en particulier des douleurs chro-
niques, et d’inciter les praticiens à une vigilance accrue
quant aux résultats de leurs interventions thérapeutiques.
Les étapes d’une démarche d’EBM
Quatre étapes sont nécessaires pour une démarche
d’EBM [1].
1. Formulation claire de la question qui doit être en
relation directe avec le problème médical abordé [19]. La
question peut concerner le diagnostic, l’étiologie, le trai-
tement ou le pronostic d’une affection. Les critères PICO
(tableau 1) servent à diviser la question en différentes
parties, ce qui facilite la stratégie de recherche.
2. Recherche d’articles pertinents dans la littérature en
interrogeant des bases de données bibliographiques
(Medline, Embase, Pre-Medline, etc.), des bases de don-
nées analytiques (Cochrane Library, ACP Journal Club,
Best Evidence), des bases de données personnelles, ainsi
que des sociétés savantes pour avoir accès à la « littérature
grise » non indexée par ailleurs. Une recherche de bonne
sensibilité permet de retrouver la plupart des articles,
même les moins pertinents, alors qu’une recherche axée
sur la spécificité ne cible que les articles les plus perti-
nents, au risque d’en rater certains. C’est dire l’intérêt
d’une bonne stratégie de recherche dans les différents
domaines du diagnostic, de l’étiologie, de l’intervention
thérapeutique, du pronostic et des revues systématiques,
domaines pour lesquels des guides de recherche ont été
développés [20]. Toutes les bases de données ne se valent
pas, mais c’est surtout la pertinence des mots-clés utilisés
pour l’interrogation qui est rentable : le fait d’utiliser les
termes « double-blind » et « random » permet d’exclure
les articles de moins bonne qualité (spécificité de 98 %) et
d’identifier les articles de bonne qualité (sensibilité de
97 %), et ceci est valable en matière de douleur [21].
3. Évaluation de la validité des publications et de
l’intérêt des résultats. L’évaluation qualitative vise à véri-
fier que la méthodologie employée par les auteurs des
articles est, en tous points, conforme aux bonnes pratiques
des essais cliniques [12] ; il existe des recommandations
destinées aux auteurs des publications, recommandations
connues sous l’acronyme CONSORT. En particulier,
1
voir les sites internet : www.anaes.fr ; www.alrf-asso.fr ;
www.setd.org
Tableau 1.Critères PICO
Critère P Pour caractéristiques du Patient et/ou Problème posé
Critère I Pour Intervention thérapeutique, ou autre, prévue
Critère C Pour Comparaison, s’il y a lieu, à une autre alternative
Critère O Pour Objectif visé (“Outcome”)
mt, vol. 13, n° 1, janvier-février 2007 31
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

lorsqu’il s’agit d’un essai thérapeutique, il faut s’assurer
que toutes les erreurs liées aux fluctuations d’échantillon-
nage ainsi que toutes les erreurs systématiques appelées
biais ont été évitées [22]. La grille de lecture la plus utilisée
est celle qui a été proposée par Jadad [23] (tableau 2),
mais les auteurs de revues systématiques de la littérature
sont libres d’employer des critères plus souples ou au
contraire plus sélectifs à condition que cela soit précisé.
C’est précisément cette liberté qui conduit parfois à ce que
les conclusions de revues abordant le même thème ne
proposent pas les mêmes réponses. L’évaluation qualita-
tive s’intéresse aussi à la méthodologie statistique utilisée
qui doit répondre à des critères précis [24] et fournir des
informations accessibles au lecteur [25]. L’évaluation
quantitative ne sert qu’à la réalisation de méta-analyses.
Le but d’une méta-analyse est d’obtenir, à partir de publi-
cations de qualité portant sur un nombre limité de
patients, des résultats chiffrés portant sur un grand nombre
de patients. Les difficultés sont liées à la possibilité
d’extraction de résultats chiffrés et aux critères statistiques
retenus, variables selon les cas [26, 27]. Les méta-analyses
elles-mêmes ne sont donc pas exemptes de biais. À défaut
de pouvoir faire une méta-analyse, et c’est le cas le plus
courant, les résultats des revues systématiques et des
recommandations se basent sur la « meilleure évidence
scientifique » [28]. Le niveau de preuve scientifique et la
gradation des recommandations (tableau 3) qui en décou-
lent [12] varient selon les auteurs de revues. La question
qui se pose est de savoir combien il faut d’études de
qualité pour atteindre le niveau de preuve souhaitable. La
réponse est au moins une de très haute qualité et concer-
nant la population de patients auxquels les recommanda-
tions doivent s’appliquer [29]. Cette remarque issue d’un
groupe écossais et visant à nuancer le lien entre preuve et
recommandation était nécessaire dans la mesure où la
graduation initialement proposée par Jadad [23] accordait
plus de crédit à une bonne étude de cas qu’à un essai
contrôlé mal randomisé. D’autres auteurs préfèrent utiliser
quatre, voire cinq niveaux de recommandation
(tableau 4). Enfin, en l’absence de toute « preuve scienti-
fique », il ne reste que l’accord professionnel. Une ques-
tion « épineuse » est celle de savoir pourquoi les rédac-
teurs et le comité de lecture des différents journaux ont
laissé publier tant d’articles qui sont considérés
aujourd’hui comme étant de faible valeur scientifique. On
voit bien que le résultat d’une revue systématique dépend
de nombreux critères et que la force des recommandations
peut varier selon que les auteurs ont ou non laissé passer
lors de leurs recherches bibliographiques des travaux de
valeur, simplement parce qu’ils ont été publiés dans une
autre langue.
4. Intégration des résultats dans la pratique clinique
courante. Ceci suppose d’abord une large diffusion des
recommandations, des conférences de consensus, des
résultats des méta-analyses et des revues systématiques
auprès des praticiens censés les appliquer. Les recomman-
dations ne seront bien sûr applicables à un patient donné
que pour autant qu’il ne soit pas différent des patients
inclus dans les études. C’est sans doute l’une des princi-
pales critiques que l’on peut opposer à la médecine fac-
tuelle, eu égard à la sélection drastique des patients inclus
Tableau 2.Critères de qualité d’un essai thérapeutique
selon Jadad [23]
Item Score
A. S’agit-il d’un essai randomisé ? 0/1
B. La procédure de randomisation est-elle correcte ? 0/1
C. S’agit-il d’un essai en double-aveugle ? 0/1
D. La procédure du double-aveugle est-elle correcte ? 0/1
E. Les sorties d’essais sont-elles décrites ? 0/1
Score A+B+C+D+E. De 0-2 : étude de faible qualité ; de 3-5 : étude de grande
qualité
Ta b l e a u 3 .Gradations des recommandations selon la HAS [12]
Niveau de preuve fourni par la littérature
scientifique
Recommandation
Niveau 1 : Preuve scientifique établie
– Essais comparatifs randomisés de forte puissance
– Méta-analyses d’essais comparatifs randomisés
– Analyse de décision basée sur des études bien menées
A
Niveau 2 : Présomption de preuve scientifique
– Essais comparatifs randomisés de faible puissance
– Etudes comparatives non randomisées bien menées
– Etudes de cohortes
B
Faible niveau de preuve scientifique
Niveau 3 :
– Etudes de cas-témoins
C
Niveau 4 :
– Etudes comparatives comportant des biais importants
– Etudes rétrospectives
– Séries de cas
– Etudes épidémiologiques descriptives
D
Ta b l e a u 4 .Niveaux de preuve et gradation des recommandations
utilisées lors d’une étude sur la validation de différentes thérapeutiques
antalgiques pour les douleurs cancéreuses [17]
Niveaux de preuve
I. Méta-analyse d’études contrôlées bien menées
II. Au moins une étude expérimentale bien menée
III. Etudes de qualité satisfaisante, « quasi expérimentales » telles que : étude
contrôlée non randomisée, étude de cohorte, étude de suivi, étude avec
groupe témoin apparié.
IV. Etudes non expérimentales bien décrites, telles que : comparaison de
deux procédures, étude de cas
V. Description de cas cliniques
Force des recommandations
A. Preuves de type I, ou résultats cohérents issus de plusieurs études de
type II, III ou IV.
B. Preuves de type II, III, ou IV, relativement cohérentes
C. Preuves de type II, III, ou IV, non cohérentes
D. Pas ou peu de preuves, ou de type II seulement
Avec cette échelle, l’emploi d’anesthésiques locaux périmédullaires a donné
lieu à une recommandation A, reposant sur des études de type I et IV.
Méthodologie
mt, vol. 13, n° 1, janvier-février 2007
32
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

dans les études scientifiques, lesquelles devraient se situer
plus sur le versant pragmatique que sur le versant explica-
tif [24]. L’application de recommandations à un patient
donné ne dispense pas d’évaluer les risques et bénéfices
potentiels du traitement sur ce patient [30]. La HAS s’est
penchée sur le problème de l’efficacité des recommanda-
tions [31] et souligne que la plupart des travaux s’y réfé-
rant montrent une disparition rapide de leur impact à
l’arrêt des interventions de diffusion. Il faut en effet que les
médecins concernés par une recommandation connais-
sent son existence, soient en accord avec le message
proposé et acceptent d’ajuster leur comportement en
conséquence [32]. Les formations continues sont un bon
moyen pour faire changer les médecins, mais l’enseigne-
ment de la médecine factuelle aux étudiants reste le plus
sûr moyen d’adapter le comportement des futurs méde-
cins. Si, d’après la HAS [31], certaines recommandations
ne sont suivies d’aucun effet, dans d’autres cas, des chan-
gements notables de plus de 50 % ont été observés.
De l’EBM en matière de prise
en charge de la douleur chronique
À propos des difficultés des études cliniques
a) Curieusement, si les critiques abondent à l’encontre
des publications concernant la prise en charge des dou-
leurs chroniques [11, 17, 33, 34], au point que de nom-
breuses modalités thérapeutiques quotidiennement utili-
sées semblent dénuées de toute efficacité d’après les
revues systématiques – il est important de retenir qu’elles
peuvent être efficaces mais qu’il manque d’informations
pour le prouver –, les auteurs de méta-analyses et de
revues soulignent rarement une authentique difficulté de
la pratique quotidienne, à savoir celle de la précision des
cadres nosographiques et de la sémiologie. S’il est facile,
d’après les critères de l’International Headache Society, de
différencier une migraine sans aura d’une migraine
accompagnée, il est beaucoup plus délicat de définir, en
termes cliniques et surtout physiopathologiques, un low
back pain,unfailed back syndrome ou une authentique
fibromyalgie. Il paraît pourtant évident que c’est le dia-
gnostic précis qui conditionne la ou les modalité(s) théra-
peutique(s).
b) Un certain nombre de connaissances concernant le
fonctionnement des voies nociceptives (sensibilisation,
activation de contrôles inhibiteurs d’origine nociceptive),
le rôle de « manipulations » mentales telles que l’hyp-
nose, ou l’efficacité potentielle de médicaments sont
issues d’études réalisées chez des volontaires. Or nul
volontaire n’est indemne de douleurs antérieures, d’où
une appréhension au cours de l’expérimentation. Si l’anti-
cipation d’une douleur a parfois en clinique les mêmes
effets que la douleur elle-même, elle a un rôle identique
dans l’expérimentation [35].
c) La subjectivité de l’expérience douloureuse est à
l’origine de deux difficultés dans la réalisation d’études
cliniques :
–La première concerne les critères d’évaluation de
l’effet d’un traitement. En matière de douleur aiguë,
comme par exemple la douleur postopératoire, les choses
sont assez simples puisqu’à partir de valeurs chiffrées
obtenues sur une EVA on peut calculer différents indices
(SPID = somme des différences d’intensité douloureuse ;
TOTPAR = somme des mesures de soulagement) qui
s’avèrent fiables. D’autres critères plus pertinents mérite-
raient cependant d’être pris en compte, comme le degré
de soulagement, évalué dans 87 % des études, le LOCF
(last observation before remedication over all remaining
time points) qui n’est relevé dans pratiquement aucune
étude, d’après une revue d’estimation de qualité faite en
2004 [36]. Le problème est plus complexe dans la douleur
chronique, multifactorielle, où de multiples échelles sont
proposées pour évaluer les différentes composantes : quel
est alors « le chiffre » ou la combinaison de variables qui
permet de juger de l’efficacité ? À partir de quel pourcen-
tage de réduction y a-t-il bénéfice ? Quels sont les objec-
tifs que vise la prise en charge des patients souffrant de
douleurs chroniques : le retour au travail pour une lom-
bosciatalgie chronique ? Le délai d’action d’un triptan
dans une crise de migraine, ou la disparition des épisodes
douloureux [37] ? Ces difficultés ont conduit à la préconi-
sation du choix judicieux, adapté au contexte des diffé-
rentes populations de patients douloureux, des critères à
évaluer au cours des essais thérapeutiques [38]. Si l’éva-
luation correcte de la douleur et de ses composantes pose
déjà problème chez le patient communicant, la situation
est encore plus difficile chez les patients à fonctions cogni-
tives perturbées, comme par exemple certains cancéreux
[39], ou les sujets âgés chez lesquels, malgré toutes les
recommandations et propositions d’amélioration, l’éva-
luation reste mal faite [40].
–La seconde concerne la réticence à utiliser un pla-
cebo chez des patients qui souffrent, dans des situations
où il n’y a pas « d’étalon-or » thérapeutique. L’idéal, pour
une modalité thérapeutique à propos de laquelle on sou-
haite avoir des informations pertinentes, est de la compa-
rer à la fois à un placebo et à un traitement de référence
[11]. S’il est une croyance aussi ancienne que la méde-
cine, c’est bien celle de l’efficacité du placebo, efficacité
qui vient polluer les essais cliniques. Une revue systéma-
tique concernant l’efficacité du placebo comparé à
l’absence de traitement – en d’autres termes, l’application
des méthodes de la médecine factuelle – conclut qu’il n’y
a pas de « preuves » de l’efficacité des placebos [41] !
L’effet placebo n’est que la résultante de multiples facteurs
tenant à la fois au patient et au thérapeute. Amanzio et al.
[42] ont montré de façon élégante que la connaissance par
le patient de l’usage éventuel d’un placebo – ce qui est le
cas dans les essais cliniques où le patient est informé du
mt, vol. 13, n° 1, janvier-février 2007 33
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

protocole – est elle-même source d’une mise en jeu des
opioïdes endogènes. Cette publication ouvre, comme
souligné dans un éditorial joint [43], la possibilité de se
passer de placebo en comparant les effets d’un traitement
appliqué, d’une part à l’insu du patient, et d’autre part au
vu et au su du patient, sous réserve de pouvoir contourner
le problème éthique.
d) La plupart des essais thérapeutiques médicamen-
teux sont financés par l’industrie pharmaceutique, et dans
la mesure où la vente d’antalgiques constitue pour certains
laboratoires une source importante de revenus, il est licite
de se poser la question du biais que cela risque d’induire.
Moore et al. [44] se sont penchés sur la question, et, eu
égard à la difficulté qu’ils ont eu à trouver des essais à
financement public, ils ont choisi de comparer les publi-
cations avec conflits d’intérêts (les auteurs sont rémunérés
par l’industriel) aux publications sans conflits d’intérêts :
leur conclusion est que le financement par l’industrie
pharmaceutique n’influe pas sur les résultats des essais.
e) La population des patients douloureux chroniques a
une propension à l’automédication, à l’inobservance des
traitements et au nomadisme médical. Le suivi est donc
difficile à assurer au cours d’une étude clinique et la
tentation est parfois grande d’exclure de l’analyse les
patients perdus de vue. Or l’attitude pragmatique veut que
tous les patients soient inclus et l’analyse faite en « inten-
tion de traiter », ce qui permet au lecteur d’avoir des
données facilement compréhensibles du type : « il faut
traiter 10 patients pour découvrir une efficacité qui ne
serait pas survenue avec le placebo », ou encore « chaque
25
e
patient qui reçoit du paracétamol pour une douleur
postopératoire développe un effet secondaire qu’il
n’aurait pas eu avec un placebo » [45].
f) Certaines douleurs chroniques, comme par exemple
des douleurs postzostériennes ou les douleurs de membre
fantôme, seraient en partie dues à un défaut de traitement
des douleurs initiales. Toute la difficulté des modalités
d’analgésie préventive repose sur une stricte planification
des traitements. La simple application de ce concept à la
douleur postopératoire – où, dans la grande majorité des
cas, il n’y a pas de douleur au moment où est débuté le
traitement – a donné lieu à de nombreuses publications
contradictoires [46].
Le regard des praticiens
Les premiers à s’être intéressés à la prise en charge des
patients douloureux chroniques ont été les anesthésistes,
passés maîtres dans l’art de manier les aiguilles et les
opioïdes. Il n’est donc pas surprenant qu’ils aient eu
initialement tendance à utiliser les blocs comme modalité
thérapeutique. De même, il n’est pas étonnant que les
neurochirurgiens proposent des interventions, et que les
rééducateurs utilisent l’arsenal qu’ils maîtrisent. Comme
chacun, c’est bien connu, voit midi à sa porte, ilyaun
« biais de sélection » des articles que l’on retient, parmi
ceux qu’on a lus, et il s’agit bien sûr de ceux qui vont dans
le sens de sa propre pratique [47]. Dans la prise en charge
des patients douloureux chroniques, le credo de la pluri-
disciplinarité est rabâché depuis plusieurs années, mais il
s’agit plus d’une multidisciplinarité de « juxtaposition »
que d’une remise en question pluridisciplinaire des prati-
ques quotidiennes.
Les « preuves » dans le traitement
des douleurs ?
a) En ce qui concerne les douleurs aiguës [18, 21,
48-52]
–Il est des situations bien codifiées par des recomman-
dations, comme la prise en charge d’une crise de colique
néphrétique, ou celle d’une lombalgie aiguë sans irradia-
tion radiculaire, ou encore le traitement des douleurs
postopératoires. Certaines « preuves » publiées à l’issue
du 11° congrès mondial sur la douleur qui s’est tenu à
Sydney en 2005, et concernant entre autres les douleurs
postopératoires [48], sont résumées dans le tableau 5.
–D’autres situations concernant en particulier le
thème de l’analgésie préventive (le cadre des douleurs
tardives après amputation ayant déjà été évoqué
ci-dessus) ne sont pas aussi clairement tranchées. Ainsi en
est-il par exemple de la place de la kétamine qui, en
postopératoire, ne semble pas être à la hauteur des espoirs
qu’elle avait suscités [48] au décours des expérimenta-
tions animales. La kétamine est un anesthésique général,
agoniste des sites phencyclidines, qui possède en outre
d’autres propriétés : inhibition des canaux Na
+
et des
canaux K
+
, inhibition de la recapture neuronale de la
sérotonine et de la noradrénaline, facilitation de l’action
du GABA sur les récepteurs A, faible affinité pour les
récepteurs aux opioïdes, et surtout antagonisme non com-
pétitif pour les récepteurs NMDA, lesquels sont impli-
quées dans toutes les douleurs, et en particulier dans la
sensibilisation des voies nociceptives. Ce dernier méca-
nisme d’action est perceptible dès l’administration à de
très faibles doses (de 1 à 1,5 mg/kg/jour) qui n’entraînent
pas d’effets secondaires, d’où l’utilisation de plus en plus
large de ce produit comme adjuvant de l’analgésie, avec
l’espoir de « prévenir » la douleur postopératoire précoce
et tardive [49, 51, 52]. Une première revue datant de 2004
[51] s’est intéressée à l’effet de la kétamine en tant
qu’adjuvant de l’analgésie opioïde : 37 publications
incluant 2 385 patients ayant reçu de la kétamine (en
bolus intraveineux, en perfusion continue, en ACP, en
épidural) ont été analysées ; avec de la morphine en ACP,
la kétamine n’apporte rien ; par contre, en administration
intraveineuse, que ce soit en bolus ou en perfusion conti-
Méthodologie
mt, vol. 13, n° 1, janvier-février 2007
34
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%
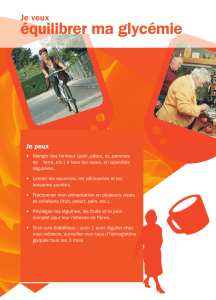
![21.Francis PONGE : Le parti pris de choses [1942]](http://s1.studylibfr.com/store/data/005392976_1-266375d5008a3ea35cda53eb933fb5ea-300x300.png)