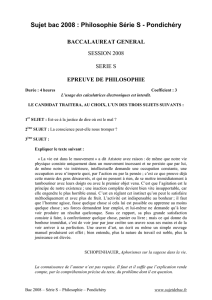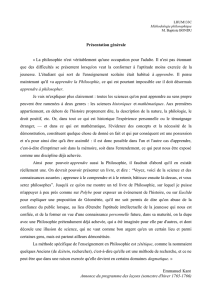Raphaël Enthoven

LE CAFE PHILO SOPHIA FÊTE SES DIX ANS
CONFERENCE-DEBAT AVEC RAPHAËL ENTHOVEN
« LA PHILOSOPHIE ET LE SENS DE LA VIE »
SAMEDI 9 FEVRIER 18H15 SALLE DU TEMPS LIBRE
COLOMBIERS
Dans son premier livre « Un jeu d’enfant : la philosophie », à la fois confession auto-
biographique et essai philosophique, Raphaël Enthoven s’interroge sur la manière dont la
philosophie s’est imposée à lui dès l’enfance, et comment celle-ci « nourrit » sa vie et
réciproquement.. Nous lui demanderons ce soir d’explorer ces rapports qu’entretiennent notre
vie commune avec cette « discipline » qu’est la philosophie : que penser par exemple de
l’idée classique selon laquelle « Philosopher, c’est apprendre à mourir », et donc aussi
« apprendre à vivre » le mieux possible cette vie vouée à une mort inéluctable ? A cette
approche de la philosophie dont le destin serait scellé à la recherche du bonheur, Raphaël
Enthoven fait entendre une voix discordante : « Contrairement à ce que prétendent les
stoïciens, ce n’est pas la philosophie qui prépare à la mort, c’est la mort qui prépare à la
philosophie »… Comment comprendre au juste le sens de cette affirmation ? Peut-être la
philosophie est-elle moins cette discipline qui cherche à nous révéler le sens de cette vie et
donc le chemin qu’il s’agit de suivre – n’est-ce pas l’objet des religions ? - qu’une manière
nouvelle de voir le monde « tel qu’il est », débarrassé le plus possible de significations
illusoires. En quoi ce regard « neuf » s’éloigne d’une philosophie qui fait du « sens de la vie »
son objet privilégié et peut au contraire se rapprocher d’ « un jeu d’enfant » ? Et finalement, la
vie a-t-elle vraiment un sens ?
-Raphaël Enthoven est né en 1975, fils de l’éditeur et écrivain JP Enthoven.
-Enseigne pendant 2 ans à l’Université de Lyon III
-Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure et Agrégé de philosophie
-Intervient en 2002 et 2003 à l’Université Populaire de Caen, fondée par Michel Onfray, où il anime le séminaire
de philosophie générale
-Maître de Conférence à L’Institut d’Etudes Politiques de Paris
-Anime des cycles de leçons sur Spinoza, Bergson et Clément Rosset aux « mardis de la Philosophie », et à la
Bibliothèque Nationale sur « le sens de la vie ».
-Producteur et/ou animateur d’émissions radiophoniques sur France Culture (« Le rendez-vous des politiques »,
« Les vendredis de la philosophie »…)
-Conseiller de la rédaction de « Philosophie Magazine » où il tient la rubrique « Sens et Vie »
Raphaël Enthoven dédicacera son livre : « La Philosophie : un jeu d’enfant » après la
conférence.

Texte d’Albert Camus commenté par Raphaël Enthoven
« Des millions d’yeux, je le savais, ont contemplé ce paysage, et pour moi il était
comme le premier sourire du ciel. Il me mettait hors de moi au sens profond du terme, il
m’assurait que sans mon amour et ce beau cri de pierre, tout était inutile. Le monde est beau,
et hors de lui point de salut. La grande vérité que patiemment il m’enseignait, c’est que
l’esprit n’est rien ni le cœur même, et que la pierre chauffée par le soleil ou le cyprès que le
ciel découvert agrandit limitent le seul univers où avoir raison prend un sens : la nature sans
hommes. Et ce monde m’annihile, il me porte jusqu’au bout, il me nie sans colère. Dans ce
soir qui tombait sur la campagne florentine, je m’acheminai vers une sagesse où tout était déjà
conquis, si des larmes ne m’étaient venues aux yeux, et si le gros sanglot de poésie qui
m’emplissait ne m’avait fait oublier la vérité du monde.
C’est sur ce balancement qu’il faudrait s’arrêter, singulier instant où la spiritualité
répudie la morale, où le bonheur naît de l’absence d’espoir, où l’esprit trouve sa raison dans le
corps. S’il est vrai que toute vérité porte en elle son amertume, il est aussi vrai que toute
négation contient une floraison de « oui ». Et ce chant d’amour sans espoir qui naît de la
contemplation peut aussi figurer la plus efficace des règles d’action : au sortir du tombeau, le
Christ ressuscitant de Piero della Francesca n’a pas un regard d’homme. Rien d’heureux n’est
peint sur son visage - mais seulement une grandeur farouche et sans âme, que je ne puis
m’empêcher de prendre pour une résolution à vivre. Car le sage comme l’idiot exprime peu.
Ce retour me ravit. Mais cette leçon, la dois-je à l’Italie, ou l’ai-je tirée de mon coeur ? C’est
là-bas, sans doute, qu’elle m’est apparue, mais c’est que l’Italie, comme d’autres lieux
privilégiés, m’offrait le spectacle d’une beauté où meurent quand même les hommes, ici
encore la vérité doit pourrir et quoi de plus exaltant ? Même si je la souhaite, qu’ai-je à faire
d’une vérité qui ne doive pas pourrir ? Elle n’est pas à ma mesure. Et l’aimer serait un faux-
semblant. On comprend rarement que ce n’est jamais par désespoir qu’un homme abandonne
ce qui faisait sa vie. Les coups de tête et les désespoirs mènent vers d’autres vies et marquent
seulement un attachement frémissant aux leçons de la terre. Mais il peut arriver qu’à un
certain degré de lucidité, un homme se sente le cœur fermé et, sans révolte ni revendication,
tourne le dos à ce qu’il prenait jusqu’ici pour sa vie, je veux dire son agitation. Si Rimbaud
finit en Abyssinie sans avoir écrit une seule ligne, ce n’est pas par goût de l’aventure, ni
renoncement d’écrivain. C’est « parce que c’est comme ça » et qu’à une certaine pointe de la
conscience, on finit par admettre ce que nous nous efforçons tous de ne pas comprendre, selon
notre vocation. On sent bien qu’il s’agit ici d’entreprendre la géographie d’un certain désert.
Mais ce désert singulier n’est sensible qu’à ceux capables d’y vivre sans jamais tromper leur
soif. C’est alors, et alors seulement, qu’il se peuple des eaux vives du bonheur.
À portée de ma main, au jardin Boboli, pendaient d’énormes kakis dorés dont la chair
éclatée laissait passer un sirop épais. De cette colline légère à ces fruits juteux, de la fraternité
secrète qui m’accordait au monde à la faim qui me poussait vers la chair orangée au-dessus de
ma main, je saisissais le balancement qui mène certains hommes de l’ascèse à la jouissance et
du dépouillement à la profusion dans la volupté. J’admirais, j’admire ce lien qui, au monde,
unit l’homme, ce double reflet dans lequel mon cœur peut intervenir et dicter son bonheur
jusqu’à une limite précise où le monde peut alors l’achever ou le détruire. Florence ! Un des
seuls lieux d’Europe où j’ai compris qu’au cœur de ma révolte dormait un consentement.
Dans son ciel mêlé de larmes et de soleil, j’apprenais à consentir à la terre et à brûler dans la
flamme sombre de ses fêtes. J’éprouvais… mais quel mot ? quelle démesure ? comment
consacrer l’accord de l’amour et de la révolte ? La terre ! Dans ce grand temple déserté par les
dieux, toutes mes idoles ont des pieds d’argile. »
Albert Camus, Noces, « le désert ».

Retour sur l’intervention de Raphaël Enthoven sur « Philosophie et sens de
la vie », à partir d’un texte de Camus (« Noces », « le désert »)
Par Daniel Mercier, le 1er mars 08
Il m’a semblé utile de restituer « quelque chose » de cette conférence, une fois passé « le feu
d’artifice » auquel nous avons assisté !
Ma prise de notes est incomplète (impossibilité de suivre le débit de paroles)
J’ai de plus rajouté quelques mots sur Spinoza, pour la clarté du propos (mais bien sûr avec le
souci de la fidélité au discours de R. Enthoven)
« La philosophie ne donne pas de sens à la vie… Vouloir donner un sens à la vie implique
qu’elle n’en a pas ! On ne demande pas aux philosophes des raisons de vie, mais c’est la vie
qui nous donne des raisons de penser. Le point de dépat de la philosophie, c’est l’expérience
de l’existence au quotidien… elle n’est pas une gymnastique de l’esprit, ni une démarche
psychologique…
Pour Camus, moins on se pose la question du sens de la vie, plus on se réconcilie avec le
monde. Il y a trois temps dans sa pensée :
- L’absurde, avec le mythe de Sisyphe, où il s’agirait de répondre à la question :
« quelle raison ai-je de ne pas me tuer ? »
- La révolte, qui serait l’aptitude à souffrir de ce dont je suis épargné (l’injustice, la
misère présentes dans ce monde)
- « Le premier Homme », c'est-à-dire le temps de l’amour, de la paix…
Or à 23 ans, dans « Noces », Camus, dans une intuition géniale, livre la formulation de
l’amour et de la paix… La philosophie amène à la paix avec l’absence de sens. Camus a
commencé avec la sagesse de l’amour, « où tout est déjà conquis », dans une sorte d’intuition
enfantine.
Lecture du texte de Camus
Le Camus poète donne à la philosophie une fulgurance qu’aucun concept ne peut égaler…
Relation à la vie du « catholique » : il faut s’abstenir ici-bas en vue de la félicité promise.
Celle-ci est en quelque sorte la récompense à l’empêchement de la jouissance.
Relation à la vie de l’hédoniste : devant l’absence de sens (transcendant), il faut jouir chaque
jour « comme si c’était le dernier ». Le plaisir est le palliatif de l’angoisse par rapport à
l’existence.
Dans tous les cas, c’est un calcul. Ce qu’il faut, c’est vivre l’instant « comme si c’était le
premier et non le dernier.». Un instant, c’est ce qui ne se reproduit pas, c’est « le premier et
le dernier de son sens » (Jankelevitch). Chaque instant est une « prime ultime ». Si c’est le
dernier, on le vit dans le manque, comme réponse à une promesse d’angoisse. Jouir, c’est
prendre son temps, remplacer le plaisir par la joie. Tout homme est le premier à mourir… le
premier aussi à voir… Il faut vivre l’instant comme le premier.
Camus fait référence à un état où je suis « hors de moi » (arrogance et fatuité du « Moi,
Monsieur »…). Il évoque un paysage qui le débarrasse de lui-même, de tout ce qui s’interpose
entre lui et le paysage. La philosophie est là pour nous sortir du quotidien, mais en tant qu’il
est ce qu’on fait sans y penser. Car il y a à l’intérieur du quotidien comme un secret
constant… à condition de se débarrasser du moi… On est n’importe qui…
La philosophie ne sert à rien, c’est précisément son utilité. « Seul compte son amour qui fait
crier les pierres » (cf. texte : « Il (ce paysage) me mettait hors de moi au sens profond du
terme, il m’assurait que sans mon amour et ce beau cri de pierre, tout était inutile. Le monde
est beau, et hors de lui point de salut »). Il n’y a pas d’ailleurs puisque le monde est infini.

Aucune position de surplomb n’est possible… Nous appartenons à la Nature… On ne sort
jamais du monde, et celui-ci inclut même notre tentative d’en sortir…
Référence à l’Esthétique de Kant et à ce qu’il dit de la beauté : elle est « sans concept » (elle
n’a pas de règles), mais pourtant elle s’impose à nous et son émotion est universellement
communicable…
Il n’y a point de salut hors du monde, mais le monde est beau et nous le savons.
L’idée d’une « nature sans hommes » (cf. texte) peut être rapprochée de l’Appendice de la 1ère
partie de L’Ethique de Spinoza : le monde (ou Dieu, ou la Nature) est toute réalité et toute
perfection (réalité et perfection sont équivalents pour Spinoza). Tout est toujours achevé… Il
n’y a pas de finalité, d’au-delà du monde. L’homme n’est qu’un élément de celui-ci. La
Nature désigne tout ce qui existe, donc Dieu ne peut-être au-delà (ou bien, c’est qu’il n’existe
pas !). Il est cette Nature même dans sa puissance infinie d’exister. L’univers décrit ici est
dépouillé du regard de l’homme… Cela débouche sur une pensée tragique, ni optimiste, ni
pessimiste. Il n’y a point de salut hors du monde, et c’est l’occasion de la Joie. Dans cette
perspective, la spiritualité peut être rapprochée du sentiment de la singularité : c’est ouvrir les
yeux et voir tout ce qui est caché. La difficulté en réalité, c’est de saisir ce qu l’on a sous la
main… Tout le monde veut surmonter les apparences, or la principale difficulté, c’et
d’assumer les apparences.
Il faut revendiquer un « bonheur sans espoir ». C’est parce que nous sommes tristes que nous
avons besoin de l’espoir. Je dois apprendre au sein du déraisonnable du monde… On a pas
besoin de Dieu pour respecter autrui… C’est comme une évidence que je sens et que je mets
dans mon portefeuille… Nous ne manquons de rien… Contentons-nous de vivre et nous
vivrons contents.
Camus saisit « ce balancement » qui mène de l’ascèse à la jouissance, sans porter de
jugement, en assumant sa condition d’humain… La formule « C’est comme ça » résume ce
qu’on pourrait appeler la « matrice du consentement »… Ou encore « ainsi soit-il ». C’est le
souhait que ce qui arrive arrive. « C’est la vie », comme on dit souvent, sans se douter de la
profonde pertinence d’une telle expression…
Il y aurait deux façons d’appréhender l’existence :
- « Ce qui a été ne peut pas ne pas être »
- « Ce qui a été aurait pu être autrement », ce qui introduit le phantasme d’autres
mondes possibles
Il ne s’agit pas pour autant de dire : « Tout ce qui est doit être ». Aucun jugement moral n’est
impliqué dans l’affirmation de l’inévitabilité du monde… Dans celle-ci, la plus haute
pesanteur coïncide avec la plus haute légèreté.
Retour à la vision du monde de Spinoza : il s’agit paradoxalement à la fois d’un monde où il
n’y a pas de mystère (puisque tout ce qui est, est, est nécessairement), et d’un mode
parfaitement énigmatique : la plus haute nécessité coïncide avec le hasard le plus élevé .
Il y a deux sortes d’étonnement : l’étonnement scientifique à la Newton (pouquoi la pomme
lancée retombe au sol ?) qui tend à sa propre abolition (lois de la gravité) ; mais il y a aussi
une autre sorte d’étonnement qui persévère malgré les réponses apportées. Ca reste
énigmatique. Ce n’est par parce qu’on m’explique quelque chose qu’on en expurge toute la
bizarrerie. Comme lorsqu’on voit pour la première fois ce qu’on a l’habitude de voir…. ».
1
/
4
100%