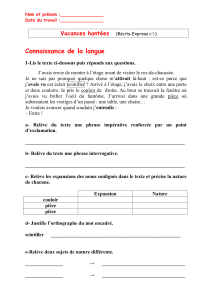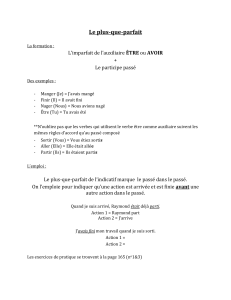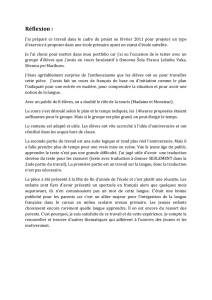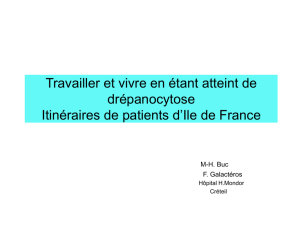Textes_transmission_files/Pessac_SUZANNE LEBEAU

LA#PAROLE#DE#SUZANNE#LEBEAU#
!
Delphine#Lizot#
"#$%&!'(!)*+(,!-.(($'*!/.'*!0$%!!"#$"%&'(!')*"+,$!,#+11'$2002*!3'4+(($!5$6$+'!,+(%!0$!1+,*$!
,$!(.&*$!*$(1.(&*$!(+&2.(+0$!+(('$00$!$&!/.'*!0$%!78!+(%!,#+)-.!'!%')*"+,$9!3'4+(($!5$6$+'!
$%&!'($!+'&$'*$!,$!&-:;&*$!$&!$00$!:1*2&!<'+%2!$=10'%2>$?$(&!/.'*!0+!@$'($%%$9!A.'%!0#+>.(%!
,:1.'>$*&$!0.*%!,'!1.00.<'$!BCDE!0#:&:!78FG!H!I+*2%J!>.&*$!1.(K:*$(1$!(.'%!+!6.'0$>$*%:!$&!+!
K+2&!:1-.%!+>$1!,$%!1.(>21&2.(%!<'$!(.'%!/+*&+)$.(%J!%'*!0+!1*:+&2.(!/.'*!0$!@$'($!/'60219!
3'2&$!H!1$0+J!(.'%!+>.(%!,:1.'>$*&!>.%!&$=&$%!<'2!(.'%!.(&!/+%%2.((:%9!L($!,$%!<'$%&2.(%!
<'2!%$!/.%$!H!0#+*&2%&$!<'2!&*+>+200$!$(!,2*$1&2.(!,$%!$(K+(&%!M!<'.2!,2*$!+'=!$(K+(&%!N!O'$0%!
&-P?$%!+6.*,$*Q!5+! >.2$!<'$!>.'%! +>$4!&*.'>:$!$%&! 1$00$!,$!0#:1*2&'*$!&-:;&*+0$!?+2%!1$0+!
*:%.(($! /.'*! (.'%! 1+*! /.'*! 0$! 1+&+0.)'$! ,#+)-.!' !%' )*"+,$!1$%! <'$%&2.(%! %$! /.%$(&!
:)+0$?$(&99!!
!
Suzanne#Lebeau#
R$! >.'%! *$?$*12$! ,$! ?#2(>2&$*! /.'*! /+*0$*! ,$! ?.(! /+*1.'*%! ,#+'&$'*! ,*+?+&2<'$9! S.(!
/+*1.'*%!200'%&*$!62$(!H!<'$0!/.2(&J!<'+(,!.(!1.??$(1$!H!&*+>+200$*!+>$1!0$%!$(K+(&%J!.(!+!
/$'*9! R$! 1.((+2%! 0$! 12(:?+! /.'*! $(K+(&J! ?+2%! ?+09! E/*P%! 0+! /*.@$1&2.(! 1$! ?+&2(! ,'! K20?!
(:$*0+(,+2%!/*%%.!'0*1(J!.(!%$!,$?+(,+2&!T!+>.(%U(.'%!/$'*!,$!0$!?.(&*$*!+'=!$(K+(&%J!$&!%2!
.'2J! /.'*<'.2!V9! R$! >.'%! /*./.%$! ,$! /+*0$*! ,$! 1$0+J! H! /*./.%! ,'! &-:;&*$! $&! ,$! 0#:1*2&'*$!
,*+?+&2<'$9!
!
! R#+2?$*+2%!/.'*!1.??$(1$*!>.'%!*+1.(&$*!?+!*$(1.(&*$!+>$1!0$!/'6021!,$%!$(K+(&%9!
R#:&+2%! ,#+6.*,! 1.?:,2$(($J! 1#:&+2&! ?+! >.1+&2.(! $&! @$! (#+>+2%! /+%! /$(%:! +'! /'6021! /.'*!
$(K+(&9! D(! /*$?2$*! 02$'! /+*1$! <'$! 0$! &-:;&*$! /.'*! $(K+(&! (#$=2%&+2&! <'+%2?$(&! /+%9! R#:&+2%!
1.?:,2$(($!$&!&*+>+200+2%!/.'*!0$%!+,'0&$%J!<'+(,!.(!?#+!,$?+(,:!,$!@.'$*!/.'*!0$%!$(K+(&%9!
A.'%!%.??$%!+'!,:6'&!,$%!+((:$%!FWX8J!@#+2!78!+(%J!@Y+2?$!/+%%2.((:?$(&!0$!&-:;&*$!$&!@$!
%'2%!1.?:,2$(($!<'+(,!@$!*$(1.(&*$!0$%!$(K+(&%9!R$!@.'$!'($!".0.?62($!,+(%!'($!".?$,2+!
,$00Y! +*&$! .Z! 0$! I2$**.&! $%&! ?'$&9! [.'%! 0$%! @.'*%! +/*P%! 1-+1'($! ,$%! *$/*:%$(&+&2.(%J! 0$%!
$(K+(&%!<'2!>2$(($(&!?$!>.2*!?$!/+*0$(&!(.*?+0$?$(&!$&!<'+(,!20%!>.(&!>.2*!0$!I2$**.&J!20%!
%#+,*$%%$(&!H!0'2!/+*!)$%&$%9!C$%!<'$%&2.(%! .(&!%'*)2!M! D%&U1$!<'#20%! 1*.\+2$(&!<'$! 0$!I2$**.&!
:&+2&!>*+2?$(&!?'$&!N!]Z!1$!%2&'$!1$&&$!K+?$'%$!K*.(&2P*$!$(&*$!*:+02&:!$&!K21&2.(!N!1.??$(&!
0$%!$(K+(&%!/$*1$>+2$(&U20%!0$!0+()+)$!$&!0$%!1.,$%!,$!0+!%1P($!N!D%&U1$!<'$!0$!0+()+)$!1.*/.*$0!
$%&! '(! 0+()+)$! <'2! :&+2&! /0'%! /*P%! ,$%! $(K+(&%J! <'2! 0$%! *[email protected](&! ,2*$1&$?$(&! ,+(%! ,$%! 4.($%!
%$(%260$%! <'$! 0$! &-:;&*$! $&! 0$%! ?.&%! ($! 0$%! *[email protected])($(&! /+%! (:1$%%+2*$?$(&!N! [.'&$%! 1$%!
<'$%&2.(%!.(&!K+2&!<'$!@$!?$!%'2%!2(&:*$%%:$!/+%%2.((:?$(&!+'!/'6021!$(K+(&9#
R#+2!1-.2%2!0$!@$'($!/'6021!%+(%!%+>.2*!$=+1&$?$(&!1$!<'$!1$0+!2?/02<'$J!1$!<'$!1$0+!%'//.%$!
,+(%! 0+! ?+(2P*$! ,$! /$(%$*J! ,#:1*2*$J! ,$! K+2*$! ,'! &-:;&*$! $&! ,$! @.'$*9! 5+! 1.?:,2$(($! <'$!
@Y:&+2%!+!,Y+6.*,!/$(%:!H!'($!K.*?+&2.(!<'2!%$*+2&!,2*$1&$?$(&!*$02:$!H!'(!@$'!/.'*!$(K+(&9!
".??$!@#+>+2%!:&:!2?/*$%%2.((:$!/+*!1$&&$!*$0+&2.(!,$%!$(K+(&%!+'!I2$**.&!?'$&J!@$!?$!%'2%!
,2%!<'#20!K+00+2&!<'$!@$!&*.'>$!'($!K.*?+&2.(!1.*/.*$00$9!!R$!%'2%!/+*&2$!:&',2$*!0$!?2?$!H!I+*2%!
1-$4! ^&2$(($! C$1*.'=9! C+(%! 1$&&$! :1.0$J! @#+2! 6$+'1.'/! +//*2%9! A.&+??$(&! 0#:1.(.?2$! ,'!
)$%&$! /.'*! ,2*$! 0#$%%$(&2$0! $&! @#+2! 1.?/*2%! 1$! <'$! @$! 1-$*1-+2%! ,+(%! 0$! &*+>+20! 1.*/.*$0!M! '(!
0+()+)$!?:&+/-.*2<'$9!!
!
5#+((:$!%'2>+(&$J!@$!%'2%!/+*&2$!/.'*!0+!I.0.)($J!1.(('$!,$/'2%!0+!K2(!,$!0+!%$1.(,$!)'$**$!
?.(,2+0$! /.'*! %+! &*+,2&2.(! ,$! &-:;&*$! @$'($! /'60219! RY+2! 1-.2%2! _*.10+`J! /$&2&$! >200$! .Z! @$!

/.'>+2%! 1.(&2('$*! '($! K.*?+&2.(! 1.*/.*$00$! 1-$4! [.?+%4$`%a2J! /*.K2&$*! ,$%! %&+)$%! ,$! @$'!
1-$4!b*.&.`%a2J!$&!.Z!@#+2!/'!?$!K.*?$*!+'!/.'>.2*!?:&+/-.*2<'$!,$!0+!?+*2.(($&&$9!
!
D(!*$>$(+(&! ,$! I.0.)($J!@#+2!:&:! $()+):$! ,+(%!0+!1.?/+)(2$! /!' %2+3%1!' 4-.!*.J! .Z! @#+2!@.':!
,+(%!,$'=!%/$1&+10$%!M!/$'#-15%',!16!*..!7&!!$&!/!'8$.',$&97+9!5$!,:1+0+)$!$(&*$!0$!,2%1.'*%!
,$%!$(K+(&%!<'$!@#+00+2%!*$(1.(&*$*!+/*P%!0$%!*$/*:%$(&+&2.(%!$&!0$%!&$=&$%!<'$!@$!@.'+2%!:&+2&!
&$00$?$(&! )*+(,! <'$! @$! ?$! %'2%! ?2%$! H! 0Y:1*2&'*$9! 5$%! &$=&$%! :&+2$(&! 6$+'1.'/! &*./!
?.*+02%+&$'*%! /.'*! 0$%! $(K+(&%J! ,Y'($! K+(&+2%2$! +*&2K212$00$J! %+(%! *+12($%! ,+(%! 0+! *:+02&:! $&!
,Y'($! $%&-:&2<'$! ,Y'($! /+'>*$&:! ,:%.0+(&$9! E! 0#:/.<'$J! 20! \! +! <'+*+(&$! +(%J! ,$'=! >.2$%!
*.\+0$%! /.'*! /+*0$*! +'=! $(K+(&%!M!0+! K+(&+2%2$! $&c.'! 0$! ,2,+1&2%?$9! B0! K+00+2&! d1#:&+2&! 0+!
1.??+(,$e!K+2*$!*f>$*!0$%!$(K+(&%'-7!0$'*!+//*$(,*$!<'$0<'$!1-.%$9!5$%!K+2*$%!*f>$*!/+*1$!
<'#20%! %.(&! K*+)20$%! $&! 2((.1$(&%! $&! 0$'*! +//*$(,*$! <'$0<'$! 1-.%$! /+*1$! <'#20%! %.(&! $(!
/*.1$%%'%!,#+//*$(&2%%+)$9!3'//.%+2&U.(!<'#+**2>:!H!0#;)$!+,'0&$!.(!+**f&$!,#+//*$(,*$!N!!
C+(%!1-+1'($!,$%!,$'=!>.2$%J!0$%!1*:+&$'*%!*:+02%+2$(&!,$!&$?/%!H!+'&*$!,$!/$&2&%!?2*+10$%!,$!
%$(%J! ,$! %'6&202&:J! ,#2(&$002)$(1$! $&! ,$! ?'*%! +6+&&'%! /$*?$&&+(&! ,$! &*+(%1$(,$*! 0+!
1.??+(,$9!S+2%!0$!102>+)$!$(K+(&%c+,'0&$%!:&+2&!&.&+09!!
!
R#+2! :1*2%! '(! /*$?2$*! &$=&$! Ti#Jean( voudrait(
ben(s’marier,(mais…!$&!/.'*!?.(&$*!1$!&$=&$J!
@$! K.(,2%! +>$1! b$*>+2%! b+',*$+'0&! 0+!
1.?/+)(2$! ,$! &-:;&*$! /!' :$11-7&!.9! 3+(%!
?#:&$(,*$! %'*! 1$&&$! /*$?2P*$! /:*2.,$!
,#:1*2&'*$! ,$%! +((:$%! FWXgUFWh8! <'$!
@#+//$00$! ;+1*-(!' (<*""-)!")!J! /.'*! 0+!
*:%'?$*!M! @#+>+2%! 1-.2%2! 0+! >.2$! ,2,+1&2<'$9! R$!
%+>+2%! 0$%! $(K+(&%! $=&*f?$?$(&! 2(&$002)$(&%J!
@$! 0$%! %$(&+2%! .'>$*&%! +'=! *:+02&:%! ,'! ?.(,$!
$&! @$! 1*.\+2%! $(1.*$! <'$! (.'%! 0$%! +,'0&$%J!
+>2.(%!H! 0$%! .'>*2*! H! 0+! *:+02&:!,'!?.(,$! <'2!
0$%!$(&.'*$9!R$!?$!%'2%!0+(1:$!,+(%!1$&&$!>.2$!
,2,+1&2<'$J!?f?$!%2J!<'+(,!A21.0+%!i+'*$!/+*0$!,'!&-:;&*$!,'!"+**.'%$0!$&!$(&*$!+'&*$%!,'!
&$=&$! =*>?!$"' 6-7(1$*%' 8!"' &<,$1*!1@' ,$*&Q! 20! :1*2&! <'$! (.'%! ($! (.'%! %.??$%! /+%! %2&':%!
1.??$! ,$! >*+2%! +,'0&$%! +\+(&! ,:12,:! ,#+>.2*! *+2%.(9! D(! $KK$&! 1.??$! +,'0&$%! 1*:+&$'*%!
+>2.(%!/*2%!,$%!*2%<'$%!2??$(%$%!+>$1!0$%!$(K+(&%9!C+(%!1$!%/$1&+10$!.Z!0+!/+*&212/+&2.(!,$%!
$(K+(&%!:&+2&!&*P%!2?/.*&+(&$J!20%!+>+2$(&!'(!/.'>.2*!*:$0!%'*!0$!,:*.'0$?$(&!,'!!%/$1&+10$9!
5$%!$(K+(&%!:&+2$(&!%'*!%1P($J!-+6200:%!1.??$!0$%!/$*%.((+)$%!,$!0#:/.<'$9!5$!&2&*$!=*>?!$"'
6-7(1$*%'8!"'&<,$1*!1@'+((.(1$!0+!0+()'$!,'!/$&2&!>200+)$9!5+!>2$200$!S+*2$!<'2!+11'$200+2&!0$%!
$(K+(&%J!0$'*! /+*0+2&! ,+(%! 0+! 0+()'$! ,$! 0#:/.<'$9! 5$%! $(K+(&%! :&+2$(&! /0+1:%! ,+(%! 0#$%/+1$!
%1:(2<'$J! 1-+1'(! 1-.2%2%%+2&! '(! ?:&2$*! ,#:/.<'$J! 6'1-$*.(! .'! ,*+>$'*J! $&! 0#+\+(&! K+2&J!
:&+2$(&!1+/+60$%!,#$(&*$*!,+(%!0$!1.(&$!,$!0+!"-+%%$Ub+0$*2$9!
!
C$! 1$%! g! /*$?2P*$%! +((:$%! ,#'($! :1*2&'*$! T!2((.1$(&$!V! .Z! @$! ?$! %$(&+2%! 1.??$! '($!
>:*2&+60$! +,'0&$! ,$>+(&! '(! /'6021! ,#$(K+(&%! 1Y$%&UHU,2*$! '($! +,'0&$! <'2! +! ,$%! 1-.%$%! +!
+//*$(,*$! +'=! $(K+(&%J! '($! <'$%&2.(J! .'&*$! 1$00$! ,$! 0+! K*.(&2P*$! $(&*$! K21&2.(! $&! *:+02&:J! +!
%'*)2&!<'2!(#+!@+?+2%!1$%%:!,$/'2%!,$!?$!-+(&$*!M!O7*';!7%'&$6-*1'!%'(+)*(!1'(!')!'97*'!&%'.!'
,!*..!71';-71'7"'!"#$"%'A'O'2!/$'&!,:12,$*!,$!1$!<'2!$%&!0$!?$200$'*!/.'*!,$'=!1$(&%!$(K+(&%!

*:'(2%! ,+(%! '($! %+00$! $&! <'2J! 0$! /0'%! %.'>$(&J! ($! %+>$(&! ?f?$! /+%! 1$! <'#20%! >.(&! >.2*N! R$!
>$(+2%!,$!,:1.'>*2*!0+!*$%/.(%+6202&:!,$!0Y+'&$'*9!
!
j!0#:/.<'$J!@#+2!,:K2(2!+2(%2#.!',!*..!71M!'($!%2&'+&2.(!,*+?+&2<'$!1*:,260$J!,$%!/$*%.((+)$%!
<'2! >2>$(&! ,$%! 1.(&*+,21&2.(%! $&! '($! 0+()'$! /.'*! /+*0$*! ,'! ?.(,$9! 5$! ?$200$'*! %.'%U
$(&$(,+2&!+'%%2!,$%!2(&$(&2.(%!,2,+1&2<'$%!?f?$!,2%1*P&$%9!B0!K+00+2&!2(K.*?$*!0$%!$(K+(&%!,$%!
,*.2&%! <'#.(! >$(+2&! ,$! 0$'*! *$1.((+k&*$9! "Y:&+2&! '($! :/.<'$! ,$! )*+(,%! *$(.'>$+'=!
/:,+).)2<'$%!$&!,$!0+!*:>.0'&2.(!&*+(<'200$!+'!O':6$19!
!
!
O'+&*$! )*+(,$%! ,+&$%! ,+(%! ?.(! /+*1.'*%J! .(&! K+2&! 1-+()$*! ?+! ?+(2P*$! ,#:1*2*$! /.'*! 0$%!
$(K+(&%J!,$!/$(%$*!0$!/'6021!,#$(K+(&!$&!,$!/$(%$*!0+!*$0+&2.(!$(&*$!0#+*&2%&$!$&!0$%!$(K+(&%9!!
!
1979,#Une(lune(entre(deux(maisons.!!
S.(! K20%! $%&! (:! $(! FWXlJ! /*$%<'$! $(!
?f?$! &$?/%! <'$! 0$! "+**.'%$09! E>$1! 0'2!
@$! *$,:1.'>*$! 0$! /0+2%2*! ,#$=/0.*$*!
0#$%/+1$!H!<'+&*$!/+&&$%J!,$!(.??$*!0$%!
1-.%$%J! ,$! &*.'>$*! +'%%2! /.:&2<'$! 0$!
1+?2.(!,$! /.'6$00$! <'$!0$!)*+(,! 1-f($!
,+(%! 0$! >$(&! ,$! @+(>2$*9! R$! 0Y+?P($! +'!
&-:;&*$9!5$%!%+00$%!%.(&!/0$2($%!,$!/$&2&%J!
&*./! /$&2&%! /.'*! 0$%! %/$1&+10$%! <'#.(!
/*:%$(&+2&9!R$!0$%!.6%$*>$J!@$!0$%!*$)+*,$!
:1.'&$*J! %$! /+%%2.(($*J! %$! 0+%%$*! /'2%!
*$>$(2*! +'! %/$1&+10$! $&! *$&*.'>$*!
0#2(&:*f&! +/*P%! +>.2*! /$*,'! 0$! K209! R$! ?$!
*$?$&%!H!02*$!I2+)$&J! _+00.(J!_2((21.&&!M! @$!*$02%!0$'*%! &-:.*2$%!%'*!0$! ,:>$0.//$?$(&!,$!0+!
/$(%:$! 1.)(2&2>$J! ,'! ,:>$0.//$?$(&! /%\1-.?.&$'*J! ,$%! +1<'2%! 2(&$00$1&'$0%J! /-\%2<'$%J!
:?.&2K%9!5+!/$&2&$!$(K+(1$!$&!%$%!*:>.0'&2.(%!62.0.)2<'$%!$&!2(&$00$1&'$00$%!?$!/+%%2.(($(&9!
R#$(%$2)($!+'%%2!G!@.'*%!/+*!%$?+2($!H!,$%!/$&2&%!<'2!.(&!$(&*$!G!$&!g!+(%9!RY:1*2%!B"!' .7"!'
!"%1!'(!7C',$*&-"&#/.'*!0$%!/$&2&%J!$(!$%%+\+(&!,$!&*.'>$*!0$!*$)+*,!<'#$'=!/$'>$(&!/.*&$*!
%'*! 0$! ?.(,$9! R$! 1-+()$! 1.?/0P&$?$(&! ?+! /.%&'*$! ,Y+'&$'*! M! +'! 02$'! ,$! *$%&$*! ,$6.'&!
1.??$!'($!+,'0&$!$&!,$!0$%!*$)+*,$*!,#$(!-+'&J!@$!?Y+%%.2%!/+*!&$**$!+>$1!$'=!$&!@$!*$)+*,$!
0$!?.(,$!0$%!\$'=!H!0+!-+'&$'*!,$!0$'*%!\$'=J!?$!0+2%%+(&!2(%/2*$*!/+*!0$'*!T2(1.?/:&$(1$!
0+()+)2P*$V! <'$! @$! &*.'>$! ,#'($! :?.'>+(&$! %2?/0212&:! $&! ,Y'($! *$,.'&+60$! $KK21+12&:!
/.:&2<'$!/.'*!1-+()$*!0+!/$*1$/&2.(!,$%!1-.%$%J!,$!0Y+'&*$!$&!,'!?.(,$999!!
L(!$=$?/0$!+>$1!?+!K200$!"+?200$!H!&*.2%!+(%9!A.'%!%.??$%!$(!>.2&'*$!$&!@#:1.'&$!0+!*+,2.9!
](! +((.(1$! <'#.(! +! *$&*.'>:! 0$! 1.*/%! ,#'(! -.??$! ,2%/+*'! <'$0<'$%! @.'*%! /0'%! &m&9! C2=!
?2('&$%!/0'%!&+*,!"+?200$!?$!,2&!%.()$'%$!M!T!['!&$!*$(,%!1.?/&$!?+?+(J!20%!.(&!*$&*.'>:!0$!
1.*/%!$&! /+%! 0+! &f&$QV!R#+2!*$K+2&! $(! $%/*2&! 0$%!,2=!?2('&$%! ,$! %.(! %20$(1$!$(!2?+)2(+(&! 0$%!
2?+)$%!<'2!%Y:&+2$(&!6.'%1'0:$%!,+(%!%+!&f&$9!!
n$(*2! S21-+'=! ,2%+2&M! T5$%! ?+(<'$%! ,$! 0#$(K+(&! K.(&! %.(! ):(2$9V! 3+! 1.?/*:-$(%2.(! ,'!
?.(,$! $%&! ($'>$9! ]*! (#$%&U1$! /+%! 0$! K.(,$?$(&! ,'! &*+>+20! ,$! 0Y+*&2%&$! <'$! ,$! ,.(($*! ,'!
?.(,$!'($!0$1&'*$!($'>$!$&!'(2<'$!N!B"!'.7"!'!"%1!'(!7C',$*&-"&'?#+!1.(>+2(1'$!,$!*$%&$*!
$(! 1.(&+1&! :&*.2&! +>$1! 0$%! $(K+(&%! ,'*+(&! &.'&! 0$! /*.1$%%'%! ,#:1*2&'*$! +K2(! ,$! &*.'>$*!

0Y:<'2026*$J!&.'@.'*%!2(%&+60$!$&!/*.>2%.2*$J!$(&*$!1$!<'$!@$!%'2%J!?.2!H!'(!?.?$(&!,$!?+!>2$!
$&!0$!/'6021!<'$!@$!>$'=!&.'1-$*9!#
L($! +'&*$! <'$%&2.(! 1*'12+0$! %Y$%&! +@.'&:$! M! 1$00$! ,'! ,:1+0+)$! $(&*$! 0Y+*&2%&$! $&! 0$%! /'6021%!
,Y$(K+(&%!U!/+*!0Y;)$J!0Y$=/:*2$(1$!U!$&!0+!*$0+&2.(!,Y+'&.*2&:!<'#20!2?/.%$9!5#+*&2%&$!,$>+(&!0$!
/'6021!$%&!$(!*$0+&2.(!,$!/.'>.2*!$&!,#+'&.*2&:J!?+2%!0$!/'6021!%+2&!<'$0!+*&2%&$!20!>+!+00$*!>.2*9!
5#+,'0&$!$%&!0'2!+'%%2!$(!*$0+&2.(!,$!/.'>.2*!$&!,#+'&.*2&:!,$>+(&!0$%!$(K+(&%9!C.(1!<'+(,!@$!
?$!/0+1$!1.??$!+*&2%&$!$&!1.??$!+,'0&$!,$>+(&!'(!/'6021!,#$(K+(&J!@$!%'2%!,+(%!'(!,.'60$!
/.'>.2*!,#+'&.*2&:J!<'2!/$'&!f&*$!$=&*f?$?$(&!,2KK2120$!H!1.(&*m0$*9!RY+2!,:12,:!,$!/*$(,*$!1$!
,:1+0+)$! <'$! @$! &*.'>$! K.(,+?$(&+0J! +K2(! ,Y$(! K+2*$! '($! K.*1$! 1*:+&2>$! M! @Y$(! +2! K.'200:! 0$%!
2(&$*%&21$%J!0$%!/.%%260$%!$&!0$%!2?/.%%260$%J!0$%!/2P)$%J!0$%!K+'%%$%!/2%&$%!$&!1#$%&!,$>$('!'(!
(+)$.$D!'#-"($%!71' <'2!?Y+!.602):$!H!,:>$0.//$*!'($!1'0&'*$!,'!<'$%&2.(($?$(&J!H!*$%&$*!
/*P%!,$%!$(K+(&%!,'*+(&!0$!/*.1$%%'%!,$!1*:+&2.(J!H!,:K2(2*!/*:12%:?$(&!1$!<'$!?.2J!K$??$J!
+,'0&$J!12&.\$(($J!@$!>$'=!/+*&+)$*!+>$1!1$!/'6021!H!'(!?.?$(&!/*:12%!,$!?+!>2$9!RY+2!/*2%!0$!
1-$?2(!/+*K.2%!$=&:('+(&!,Y'($!/$*/:&'$00$!(:).12+&2.(!$(&*$!?.2U?f?$!$&!0$%!$(K+(&%!%'*!
0$%!2?+)$%J!0$%!?.&%J!0$%!K.*?$%!/.'*!,2*$!1$!<'$!@$!>$'=!,+(%!?+!0+()'$!,Y+'&$'*!%+(%!/.'*!
+'&+(&!.'602$*!0+!&+200$!,'!/'6021!<'$!@$!>$'=!*[email protected](,*$!.'!($!@+?+2%!.'602$*!<'2!@$!%'2%9!!
!
1986#avec#Gil#l’adaptation#du#roman#d’Howard#Buten,#Quand(j’avais(cinq(ans,(j’m’ai(tué.#
R$!?$!,$?+(,+2%!<'.2!:1*2*$!<'+(,!b$*>+2%!$%&!*$>$('!,$!&.'*(:$!+>$1!1$!*.?+(!<'2!,:1*2&!
'($! %.12:&:! $&! %$%! &+6.'%! H! &*+>$*%! 0$! *$)+*,! ,#'(! $(K+(&! ,$! -'2&! +(%9! R$! %'2%! &.?6:$!
+?.'*$'%$!,'!*.?+(!$&!@Y+2!,:12,:!,#$(!K+2*$!'($!+,+/&+&2.(!/.'*!0$!&-:;&*$J!0.2(!,#2?+)2($*!
0+!1.??.&2.(!<'$!0$!%/$1&+10$!+00+2&!/*.>.<'$*9!D(!FWhlUhXJ!%2?/0$?$(&!/*.(.(1$*!0$!&2&*$!
+'!&:0:/-.($!$&!>.'%!+>2$4!'(!2??$(%$!%20$(1$!+'!6.'&!,'!K209!5$!*:%'?:!,$!0#-2%&.2*$!M!'(!
$(K+(&!,$!-'2&!+(%!$%&!/0+1:!,+(%!'($!2(%&2&'&2.(!/%\1-2+&*2<'$!/+*1$!<'#20!+!:&:!&*.'>:!('!
,+(%! '(! 02&! +>$1! '($! 1+?+*+,$! ,$! %.(! ;)$J! /+*! 0+! ?P*$! ,$! 0+! /$&2&$9! 5$! &2&*$! %.'0$>+2&! '(!
%20$(1$! :0.<'$(&J! 0$! *:%'?:J! '(! %20$(1$! &$**2K2+(&9! R$! (#:&+2%! /+%! H! 0+! ,2KK'%2.(J! .(! ?$! 0#+!
*+1.(&:9!I+*!1.(&*$J!@$!K'%!H!&.'%!0$%!?.?$(&%!,'!/*.1$%%'%!,$!1*:+&2.(9!R#+>+2%!0'!0$!&$=&$!
+'=! $(K+(&%! ,+(%! 0$%! 10+%%$%J! @#:&+2%! +00:$! 0$%! >.2*! $(! 0$'*! /+*0+(&! ,$! 1$&&$! -2%&.2*$! $&! @$!
1.((+2%%+2%!,:@H!0+!*$0+&2.(! /+%%2.((:$! <'$! 0$%! $(K+(&%! $(&*$&$(+2$(&! +>$1! 0$!/$&2&!b209!R#+2!
?+0)*:!&.'&!:&:!6.'0$>$*%:$!/+*!0#:?.&2.(!<'2!%#$%&!,:)+):$!,$!0+!/*$?2P*$!*$/*:%$(&+&2.(9!!
!
!
!
5$!,2%/.%2&2K!%1:(2<'$!M!'(!0.()!1.**2,.*!<'2!K+2&!0$!02$(!$(&*$!0#2(%&2&'&2.(!/%\1-2+&*2<'$!,#'(!
1.&:J!0$!6'*$+'!,'!,.1&$'*!A:>:0:!K+1$!H!0+!1-+?6*$!,$!b20J!0$!/+%%+)$!K+1$!H!0+!%+00$!.Z!%$!
@.'+2$(&! &.'&$%! 0$%! %1P($%! $&! ,$! 0#+'&*$! 1m&:! ,'! /+%%+)$! ,#+'&*$%! /2P1$%! ,$! 0#2(%&2&'&2.(!
/%\1-2+&*2<'$9! 5$! /'6021! $(! 62K*.(&+0J! &*P%! /*P%! ,$%! +1&$'*%9
/+%%+2&!,+(%!0$!/+%%:J!1Y$%&UHU,2*$!0+!*$(1.(&*$!$(&*$!b20!$&!R$%%21+!$&!0+!%1P($!+>$1!0+!?P*$J!
0#:10+2*+)$!>$(+2&!,'!/0+(1-:!$&!:&+2&!$(!1.'0$'*9!
!
5$!@.'*!,$! 0+! /*$?2P*$J! 0#:?.&2.(! :&+2&! H! 1.'/$*! +'! 1.'&$+'9!5$%!$(K+(&%!:&+2$(&! +&&$(&2K%J!
%20$(12$'=J! ,$! 1$&&$! +&&$(&2.(! %2! 2(&$(%$! <'$! @Y+2?$! +'! &-:;&*$9! 5$%! +,'0&$%! +'! 1.(&*+2*$J!
:&+2$(&!,:%$?/+*:%9!I+%!'(!,$%!+,'0&$%!,+(%!0+!%+00$!(#+!/.*&:!%.(!+&&$(&2.(!%'*!0$%!$(K+(&%!
/*:%$(&%! <'2! %'2>+2$(&! ,#'($! :1.'&$! /+%%2.((:$9! 5$! %/$1&+10$! %Y.'>*+2&! %'*! 0+! 1.0P*$! ,$! 0+!
?P*$!,+(%!0$!/+%%:!$&!%$!&$*?2(+2&!+>$1!0+!1.0P*$!,$!b20!,+(%!0#2(%&2&'&2.(!/%\1-2+&*2<'$J!<'2!
,:10+*$! T!R#+2! *2$(! H! K+2*$! 212!V9! B?+)2($4!M! ,$%! $**$'*%! %\(&+=2<'$%! ,+(%! 0$! &2&*$J! 0$%! ?.&%!
%'212,$! $&! $(K+(&%! +11.0:%J! '(! ,2%/.%2&2K! %1:(2<'$! <'2! (#200'%&*+2&! *2$(J! ($! ?.(&*+2&! *2$(! $&!
K+2%+2&!H!/$2($!%')):*$*!,$%!02$'=J!:>.<'+(&!'($!2(&$(%2&:!,*+?+&2<'$!&$00$!<'$!0$%!+,'0&$%!
$'=U?f?$%! /$'>$(&! ,2KK2120$?$(&! %'//.*&$*! <'+(,! 20%! >.(&! +'! &-:;&*$! $&! 0#-2%&.2*$! ,#'(!
$(K+(&!<'2!%$!*$&*.'>$!,+(%!'($!%2&'+&2.(!&$**260$9!5$%!+,'0&$%!.(&!:&:!&$00$?$(&!6.'0$>$*%:%!
<'$!0$!%/$1&+10$!,$!E*.!$%&!,$>$('!,+>+(&+)$!'(!K+2&!,$!%.12:&:!<'#'(!:>:($?$(&!1'0&'*$09!
Pour( la( première( fois( j’ai( senti( qu’il( y( avait( des( limites( à( ce( que( l’on( peut( présenter( aux(
enfants(et(que(ces(limites(ne(viennent(pas(des(enfants(mais(des(adultes(qui(les(entourent.!
R$!%'2%!+00:$!>.2*!0$%!$(K+(&%!,+(%!0$%!10+%%$%!+/*P%!$&!@$!0$'*!+2!/.%:!0+!<'$%&2.(9!R+?+2%!0$%!
$(K+(&%!?#.(&!,2&!<'$!1$!%/$1&+10$!:&+2&!&*./!,'*J!<'#20!(#:&+2&!/+%!/.'*!$'=9!E'!1.(&*+2*$!&.'%!
0$%!$(K+(&%!?#.(&!,2&!T!/.'*!0+!/*$?2P*$!K.2%!@#+2!>'!,'!>*+2!&-:;&*$!V9!!
!
R#+2!+0.*%! :&:!6.?6+*,:$! ,$!<'$%&2.(%! /.'*!0$%<'$00$%! @$!(#+>+2%! /+%!,$! *:/.(%$9!EU&U.(!0$!
,*.2&!,$!/*:%$(&$*!+'=!$(K+(&%!,$%!%2&'+&2.(%!<'#20%!(#.(&!/+%!1.(('$%N!EU&U.(!0$!,*.2&!,$!0$%!
6.'0$>$*%$*N!EU&U.(!0$!,*.2&!,$!0+2%%$*!'($!K2(!$(!%'%/$(%J!,$!($!/+%!1.(10'*$!<'+(,!0#-2%&.2*$!
%.'0P>$!,$%!,:6+&%! ,$! %.12:&:! 1.?/0$=$%N! ".??$(&! '(! +,'0&$! /$'&U20! +11$/&$*!,$!($! /+%!
/*$(,*$!/.%2&2.(!$&!,$!0+2%%$*!0$%!$(K+(&%!,+(%!0$!K0.'N!5$%!+*&2%&$%!.(&U20%!0$!,*.2&!,$!/+*0$*!
+'=!$(K+(&%!,'! ?.(,$! ,+(%! 0$<'$0! 20%! >2>$(&! .'! ,.2>$(&U20%! $(!2(>$(&$*!'(!/0'%! *+%%'*+(&N!
](&U20%!0$!,*.2&!,$!/+*0$*!,#'(!?.(,$!!2?/+*K+2&N!!
D&!62$(!<'#+&&+<':$! @$! ($! ?$! %$(&+2%! @+?+2%! 1.'/+60$J! *$%/.(%+60$! 62$(! %o*! ?+2%! /+%!
1.'/+60$9!D&!%2!@$!%$(&+2%!0+!1.0P*$!,$%!+,'0&$%J!@#:&+2%!1+/+60$!,#\!K+2*$!K+1$!%+(%!?$!%$(&2*!
&.'1-:$! :?.&2>$?$(&! /+*1$! <'$! @$! %+>+2%! /.'*<'.2! $(! &+(&! <'#+,'0&$! @#+>+2%! +,+/&:! 1$!
*.?+(9!R#+>+2%!%$(&2!,+(%!1$!*.?+(!'(!*$)+*,!,#$(K+(&!%'*!0$!?.(,$!<'2!0#$(&.'*$J!'(!*$)+*,!
/+*K+2&$?$(&! 1*:,260$! $&! /+*K+2&$?$(&! %+2(9! C+(%! 0$! *.?+(! 20! \! +! '($! %1P($! $(&*$! ,$'=!
/%\1-2+&*$%J! 0$! ,.1&$'*! A:>:0:! 1-+*):! ,'! 1+%! ,$! b20! $&! 0$! ,.1&$'*! p',\+*,! <'2! %#$%&! 02:!
,#+?2&2:! +>$1! 0#$(K+(&! $&! /$(%$! <'$! b20! (#+! *2$(! H! K+2*$! ,+(%! 0#2(%&2&'&2.(! /%\1-2+&*2<'$9!
".??$!1#:&+2&!'($!%1P($!+'!0+()+)$!/%\1-2+&*2<'$!&*P%!/.2(&'!$&!<'$!@$!($!1.(&*m0+2%!/+%!,'!
&.'&!1$!0+()+)$J!@$!?$!%'2%!,2%!T!3#20!K+'&!1.'/$*!'($!%1P($J!1$!%$*+!1$00$U0H!q!V!/+*1$!<'$!0$%!
$(K+(&%!($!1.?/*$(,*.(%!/+%!/0'%!<'$!?.29!j!?+!)*+(,$!%'*/*2%$J!$00$!%Y$%&!*:>:0:$!f&*$!0+!
/*:K:*:$! ,$%! $(K+(&%! <'2! (#$(! 1.?/*$(+2$(&! /+%! 0$%! ?.&%! ?+2%! <'2! $(! %+2%2%%+2$(&!
/+*K+2&$?$(&!0$%!$(@$'=9!B0%!:&+2$(&!*+%%'*:%!,$!>.2*!<'#'(!+,'0&$!/.'>+2&!,:K$(,*$!'(!$(K+(&!
$&!?$&&*$! %.(! /.%&$! $(! ,+()$*!/.'*! ,:K$(,*$! '($! %2&'+&2.(! 2(@'%&$9! "#$%&!1$! <'$! @#+//$00$!
1$&&$!1.(K2+(1$!$(!0#+,'0&$!<'$!0$%!$(K+(&%!+2?$(&!+>.2*9!!
!
E*.! ?#+! +//*2%! <'$! 0+! 1.?/*:-$(%2.(! ,$%! $(K+(&%! $%&! %'6&20$J! )0.6+0$J! /*.K.(,$! <'#$00$! >+!
/0'%!0.2(!<'$!1$!<'$!0#.(!/$'&!2?+)2($*J!/*:>.2*J!,:K2(2*!$&!<'$!1$!($!%.(&!/+%!0$%!$(K+(&%!<'2!
2?/.%$(&!,$%!02?2&$%!H!1$!<'$!0#.(!/$'&!0$'*!/*:%$(&$*9!B0%!%.(&!,2%/.(260$%!$&!%+(%!/*:@'):%9!
5$%!+,'0&$%!/+*!1.(&*$J!.(&!,$%!2,:$%!/*:12%$%!%'*!1$!<'2!/$'&!f&*$!.'!($!/$'&!/+%!f&*$!T!,2&!
+'=! $(K+(&%! V9! C$%! 2,:$%! %'6@$1&2>$%J! ):(:*+0$?$(&! 6+%:$%! %'*! ,$%! %.'>$(2*%! ,#$(K+(1$J!
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%