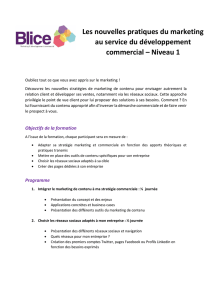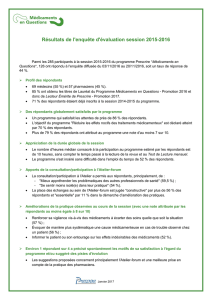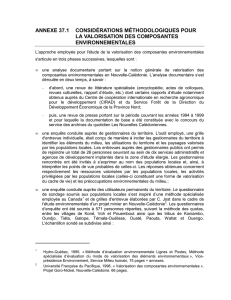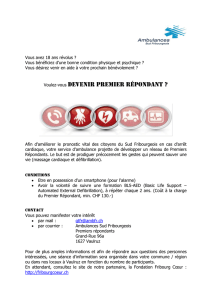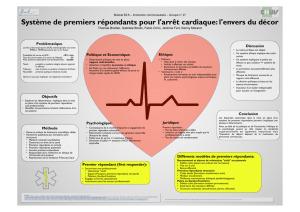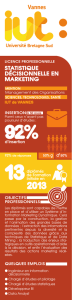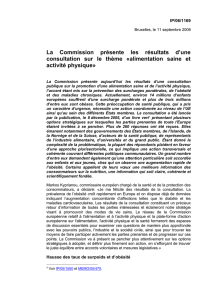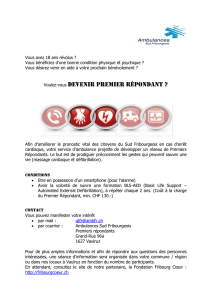Consommation alimentaire alternative

1
Consommation alimentaire alternative :
Perception et comportement d’enseignants-chercheurs en gestion
Angélique RODHAIN
Maître de Conférences
CR2M – Université Montpellier 2
IUT de Béziers
Adresse personnelle :
867 avenue Paul Parguel
34 090 MONTPELLIER
06 75 91 39 03
Adresse professionnelle :
IUT de BEZIERS
17, quai du Port Neuf
34 500 BEZIERS
04 67 11 18 11
Remerciements :
L’auteur remercie Sandra Camus pour sa participation dans la conception du guide
d’entretien, ainsi que tous les enseignants-chercheurs ayant accepté d’ouvrir les portes de leur
cuisine…

2
Consommation alimentaire alternative :
Perception et comportement d’enseignants-chercheurs en gestion
Résumé :
L’objectif de cet article est premièrement de donner une définition de la consommation
alternative à partir de la représentation d’enseignants-chercheurs en gestion. Or, sont
alternatifs des produits qui ne seraient pas passés par le circuit de la grande distribution.
Deuxièmement, à partir du récit des répondants, est examiné l’écart existant entre une attitude
globalement positive envers un autre mode de consommation et le comportement. La théorie
de la neutralisation explique cet écart pour les personnes peu impliquées : elles trouvent des
raisons cohérentes permettant à leurs actes de ne pas être en accord avec leurs valeurs. En
revanche, les répondants plus impliqués restent culpabilisés par cet écart, malgré leurs actions
plus en accord avec leurs valeurs.
Mots-clés :
Alternatif, qualitatif, enseignant-chercheur, alimentaire.
Summary :
This article aims first at giving a definition of an alternative consumption from management
researchers’ perception. Products are considered as alternative only once they are bought out
of supermarkets. Second, from interviewees’ life narratives, we examine the existing gap
between a positive attitude towards this different kind of consumption and a behaviour far
from being engaged. The neutralization theory explain this gap for those who are involved:
they rationalize their behaviour in order not to feel incoherent with their deep values. In the
other hand, people involved still feel guilty by the gap even if their behaviour correspond
more with their values and self-concept.
Key words:
Alternative, qualitative research, researcher, food.

3
Consommation alimentaire alternative :
Perception et comportement d’enseignants-chercheurs en gestion
INTRODUCTION
Toutes les dernières enquêtes l’affirment : les Français sont de plus en plus sensibles aux
valeurs citoyennes et éthiques pour leurs achats. Travail des enfants, « made in France »,
respect des conditions de travail, fabrication non polluante, sont autant de critères auxquels les
Français se disent de plus en plus vigilants. Pourtant s’il est vrai que les achats dits éthiques
(produits du commerce équitable, produits biologiques, produits assurant un respect de règles
éthiques ou environnementales) croissent plus rapidement que la moyenne, il n’en reste pas
moins qu’ils demeurent assez marginaux dans l’hexagone. Par exemple, selon la dernière
étude du CREDOC1 datant de 2006, 18% des Français sont « convaincus » par les valeurs
citoyennes. Or, ces personnes sont appelées « convaincues » alors qu’ayant acquis au moins
un produit éthique au cours du semestre, un plancher qui reste bien faible. Ainsi, on constate
un écart assez important entre les déclarations et les comportements dès lors qu’il s’agit
d’achat éthique.
L’objet de cet article consiste alors à donner un éclairage à ce décalage entre l’attitude envers
une consommation différente - nommée ici alternative - et le comportement. Précisons que
l’adjectif alternatif porte dans son acception actuelle à lui seul une réflexion sur le système
économique, comme le définit le Petit Larousse « qui propose de concevoir autrement le
système de production et de consommation ».
Ce faisant, nous avons choisi d’interroger une population particulièrement restreinte : celle
des enseignants-chercheurs en gestion. La raison de ce choix réside tout d’abord dans le fait
que l’enseignant-chercheur en gestion est censé connaître davantage le système économique
et les modes de gestion des entreprises que la population en général. Ensuite, est émise
l’hypothèse d’un enseignant-chercheur habitué à discourir et donc capable de décrire et
d’analyser sa propre consommation. En tant qu’expert, il est alors intéressant de comprendre
sa vision d’une consommation jugée différente et de voir comment il fait le lien entre ses
connaissances, ses opinions et ses actions. Enfin, c’est une cible intéressante pour son
1 CREDOC enquête « Conditions de vie et aspiration des Français », début 2006, dans CREDOC,
Consommation et modes de vie, n°201, mars 2007.

4
appartenance à la population des consommateurs de produits éthiques car bénéficiant d’un
niveau d’éducation et d’un pouvoir d’achat relativement élevés.
En d’autres termes, les questions sous-jacentes sont : sur quels critères une consommation
serait-elle jugée alternative? Des produits particuliers peuvent-ils être considérés comme
alternatifs ? Quelle est l’attitude des répondants vis-à-vis d’une consommation différente ?
Est-ce qu’il existe des écarts entre l’attitude et le comportement des répondants ? Si écarts il y
a, comment ces derniers peuvent-ils s’expliquer ? Existe-t-il des stratégies pour les réduire ?
Le sujet d’étude est réduit aux produits alimentaires, ces derniers étant de loin ceux sur
lesquels portent davantage les critères éthiques2.
L’article est articulé en trois parties. Dans un premier temps, il s’agit d’établir un état des
lieux des différents types de consommation que l’on pourrait nommer alternative dans le
secteur alimentaire : seront abordés les produits du commerce équitable, produits biologiques,
produits de terroir, authentiques, portant des labels de qualité ou de provenance et les
alicaments.
Dans un deuxième temps, un éclairage sera réalisé sur la problématique et la méthodologie de
l’étude avant de présenter dans un troisième temps une analyse des réponses obtenues. Une
proposition de définition de la consommation alternative sera donnée après avoir fait un
détour sur le vocabulaire marketing utilisé par les répondants. Enfin, nous nous consacrerons
à comprendre les raisons de l’écart entre une attitude favorable envers une consommation
alternative et un comportement majoritairement classique.
UNE CONSOMMATION ALTERNATIVE
On connaît actuellement une certaine forme de résistance à la consommation classique
(Fournier, 1998, Kozinets, 2002, Roux, 2006). Communément appelé consomm’action ou
consommation politique ou encore responsable, chaque acte de consommation peut être
considéré comme un acte politique ayant des conséquences économiques, écologiques et
sociétales. Dubuisson-Quellier et Lamine (2003) distinguent deux types d’actions : le boycott
et le buycott, ce dernier consistant à « promouvoir la production et la consommation de
produits qui font l’objet de certification de leur valeur éthique : c’est le cas de produits
nationaux, d’éco-labels, produits garantis sans OGM, ou des produits issus du commerce
2 A la question « Pour quels types de produits pensez-vous qu’il soit le plus important aujourd’hui d’avoir des
engagements de citoyenneté de la part des entreprises ? », les sondés répondent à 48% pour les produits
alimentaires suivi de loin par le textile à 18% puis les produits pharmaceutiques à 11%, selon une enquête du
CREDOC parue dans Les 4 pages de statistiques Industrielles du SESSI, n°170, décembre 2002.

5
équitable » (p.2). François-Lecompte et Valette-Florence (2006) ont, quant à eux, précisé
cette distinction entre non achat et achat en mettant en lumière cinq facteurs de la
consommation socialement responsable : le refus d’acheter à une entreprise jugée
irresponsable, le recours à l’achat partage, la préférence pour les petits commerces, préférence
pour les produits domestiques et la réduction du volume de consommation.
Roux (2006) détermine trois motifs de résistance des consommateurs :
- pour une expression libertaire : la résistance apparaît alors comme un moyen de réaffirmer
son autonomie face à un système d’influence (consistant à consommer, mais autrement, en
détournant l’usage des produits ou en affirmant une fidélité pour des produits hors du
commun, ou en détournant les circuits classiques pour des circuits parallèles) ;
- comme sanction de comportement non-éthique des firmes : la résistance consiste alors à
recourir au non-achat et au bouche-à-oreille négatif ;
- comme engagement citoyen : la résistance est encore plus ancrée et réside dans la recherche
d’une diminution de la consommation dans un plaidoyer pour la décroissance.
Dans cette distinction, la consommation alternative apparaît selon Roux (2006) comme une
réaction des consommateurs allant jusqu’à remettre en cause le statut d’interlocuteur unique
joué par les entreprises, d’où la recherche de circuits parallèles et de recours aux échanges
entre consommateurs, pour échapper au marché classique. Dans cette position, la
consommation alternative est définie surtout à partir du circuit de distribution. Tel n’est pas
toujours le cas. Par exemple, Bézaudin et Robert-Demontrond (2007) rappellent que le terme
était au départ utilisé pour désigner ce qui sera nommé par la suite le commerce équitable.
Ainsi la notion de consommation alternative pourrait faire référence aussi bien aux produits
qu’aux circuits de distribution.
Dans une optique différente, en nous focalisant sur les produits, nous nous posons la question
de l’existence de produits alimentaires considérés comme intrinsèquement alternatifs pour le
consommateur. Nous posons alors dans un premier temps la consommation
alternative comme une forme de consommation qui vise à explorer des solutions autres que
celles de la consommation de masse actuelle. Nous proposons ainsi d’élaborer un tour
d’horizon de produits pouvant être considérés comme différents dans le secteur alimentaire.
Ce faisant, nous tentons d’établir un inventaire de produits offrant une distinction par rapport
à une offre globale. Cet inventaire n’a d’autres prétentions que nourrir une réflexion des
consommateurs les amenant à définir ce qui peut ou non faire partie d’une consommation
alternative. C’est ainsi que produits du commerce équitable, produits biologiques, produits de
terroir, authentiques, portant des labels de qualité ou de provenance et les alicaments sont
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
1
/
31
100%