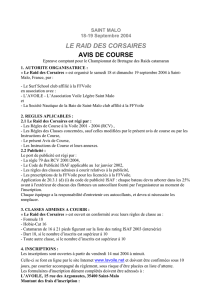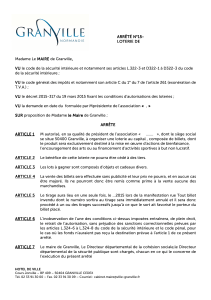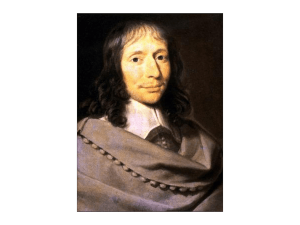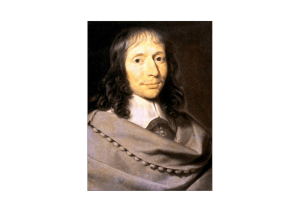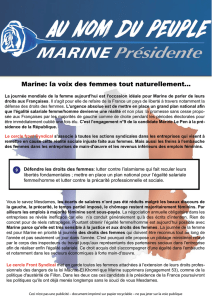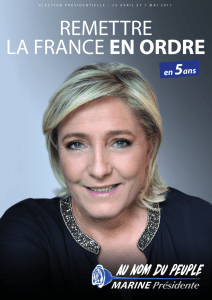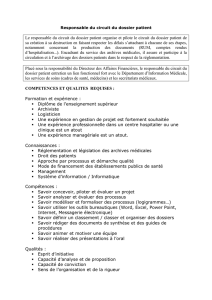en version pdf - Université de Caen Normandie

Compléments de Michel Aumont pour son ouvrage intitulé :

2
(octobre 2013)

3
Sommaire
1 - Granville et ses corsaires _______________________________________________________ 4
2 - Comment j’ai réalisé mon travail _________________________________________________ 5
3 - Les Granvillais au fil des conflits _________________________________________________ 7
4 - Comparaison avec les autres ports ________________________________________________ 8
5 - Armateurs __________________________________________________________________ 11
6 - Navires ____________________________________________________________________ 15
7 - Les hommes d’équipage _______________________________________________________ 20
8 - Les campagnes ______________________________________________________________ 22
9 - Les résultats ________________________________________________________________ 25
10 - Bibliographie ______________________________________________________________ 26
11 - Sources ___________________________________________________________________ 39

4
1 - Granville et ses corsaires
Jusqu’au milieu du XVIIe siècle, Granville est un petit port qui ne se distingue guère des autres. On y
pratique la pêche côtière, surtout celle des huîtres, et un peu la pêche morutière à Terre-Neuve. C’est au XVIIIe
siècle, sous Louis XV, que la cité bas-normande s’affirme pleinement dans la vie maritime, en fixant
efficacement sa destinée dans la pêche morutière, au point de disputer âprement la suprématie à Saint-Malo. Il
faut dire que Granville ne manque pas d’atouts : un noyau d’armateurs compétents et ambitieux, mais aussi un
quartier maritime important, qui compte de nombreux gens de mer, dont les compétences sont clairement
reconnues. Granville est alors considérée comme une véritable pépinière d’excellents matelots, susceptibles
d’alimenter avantageusement les équipages des vaisseaux de Sa Majesté.
Mais lorsqu’une guerre éclate, l’activité morutière se trouve aussitôt interrompue. Il n’est pas question,
évidemment, de prendre des risques inutiles en s’aventurant jusqu’à Terre-Neuve, quand on sait que l’ennemi
navigue sur les mêmes eaux. C’est là que Granville se distingue de bien d’autres ports : il se lance dans la
guerre de course, alors que d’autres ne le font pas (Dieppe, Les Sables-d’Olonne ou Le Havre par exemple) ou
très peu.
À compter du règne de Louis XIV jusqu’à la chute de Napoléon Ier, Granville pratique régulièrement la
guerre de course. Toute une population littorale se retrouve ainsi impliquée dans une aventure maritime où le
désir de faire fortune côtoie constamment le risque d’y laisser sa vie, son bien et ses illusions. Portée par des
armateurs particulièrement entreprenants et audacieux, l’activité du port bas-normand est éclatante. Des
navires de toutes tailles – du simple lougre de 3 tonneaux aux grandes frégates, pouvant jauger jusqu’à 530
tonneaux – se retrouvent armés pour le meilleur et pour le pire. Les satisfactions des uns côtoient les déceptions
des autres. Granville devient alors le 3e port corsaire métropolitain français sous Louis XVI par le nombre
d’armements et par la valeur des prises rapportées, de quoi contenter tout le monde.

5
2 - Comment j’ai réalisé mon travail
Une réalité à recomposer.
Quoi de plus naturel pour un Granvillais, qui vit au bord de la mer, que de s’intéresser au passé maritime de
son port ? Quoi de plus naturel alors pour ce même Granvillais (moi) que de s’intéresser aux corsaires de son
port ? Surtout lorsque l’on constate que le sujet n’a encore jamais été abordé sérieusement par les érudits locaux
et par les historiens. Seulement voilà ! L’intégralité des archives maritimes du port de Granville a disparu lors
du bombardement de la ville de Saint-Lô, le 6 juin 1944. Tout a brûlé et l’on n’a rien récupéré des archives de
l’Amirauté, de celles du juge de paix, celles du Tribunal de commerce ainsi que la grande majorité des archives
notariales. Bref ! Tout ce qui aurait pu normalement constituer le fondement essentiel des sources pour un
historien désireux d’étudier le phénomène de la guerre de course dans un port a définitivement disparu.
Heureusement, j’avais encore les archives de l’Inscription maritime granvillaise à ma disposition, au Service
Historique de la Marine à Cherbourg, et je savais qu’il existait des traces dans les archives voisines.
Avec obstination, j’ai décidé de persévérer dans l’étude des corsaires granvillais et de mettre au point une
stratégie de contournement dont la logique me paraissait simple : puisque tout avait disparu, il me fallait
rechercher autre part tout ce qui concernait Granville, pour recomposer cette réalité disparue à la façon d’un
puzzle. Je partais du principe suivant : si les Granvillais avaient écrit des lettres et des comptes-rendus, il
suffisait de chercher ce courrier chez les destinataires pour en retrouver le contenu. En outre, en recherchant
dans les archives du grand Ouest de la France, je pouvais retrouver les rapports que les capitaines établissaient
à leur arrivée dans les ports qu’ils fréquentaient.
J’ai donc consacré toutes mes vacances et mes temps libres à parcourir les différentes archives entre Paris et
Brest, entre Rouen et Nantes, plus Bordeaux, pour y repérer des renseignements susceptibles de m’éclairer sur
les corsaires de ma ville.
En province, je trouvais des rapports de prise, des liquidations de prises, de gros dossiers qui précisaient le
déroulement des campagnes en mer. Dans les archives parisiennes, je retrouvais la correspondance entretenue
avec le ministère de la Marine, que ce soit celle de Granville ou bien celle de Saint-Malo. C’est là que j’ai
découvert les documents les plus précieux, comme des états de navires engagés dans la course, des états de
prises avec leurs gains, des explications sur des campagnes ou des circonstances particulières, les directives
ministérielles, des mémoires, des comptes-rendus d’inspections, etc…
Parallèlement à toutes ces démarches, je recherchais tout ce qui avait été écrit sur les corsaires en général, des
ouvrages de vulgarisation aux thèses, non seulement pour augmenter mes connaissances personnelles sur le
sujet mais aussi pour faire le point sur ce qui avait été étudié par les historiens et surtout, ce qui n’avait pas
encore été étudié. Il ressortait clairement que les aspects juridiques et économiques avaient été généreusement
abordés, mais que l’aspect social ne l’avait encore jamais été. Cela tombait bien. Cela correspondait à ce qui
me passionnait : l’aventure dans sa dimension humaine. Le fonds de l’Inscription maritime, conservé au
Service historique de la marine de Cherbourg, contenait suffisamment d’informations pour travailler dans ce
sens. Il m’était même possible de me livrer à une prosopographie. C’est pourquoi, j’ai très vite entrepris la
création d’une importante base de données sur mon ordinateur personnel. Je savais qu’elle me servirait par la
suite.
Dès lors, la problématique de ma thèse m’apparaissait évidente à partir des questions que je me posais : Qui
étaient les corsaires granvillais ? Quels efforts le port bas-normand a-t-il autrefois consenti dans la guerre de
course ? Ces efforts furent-ils importants par rapport à d’autres ports corsaires, comme Saint-Malo ou
Dunkerque ? Quelles étaient les motivations des différents acteurs ? Quelle était la vie menée à bord par les
équipages ? Les risques encourus ? et, corollaire de ce questionnement, quel regard critique peut-on jeter sur
le destin des corsaires en général ? Ma problématique devenait donc fondamentalement sociale et culturelle.
En conséquence, je devais d’abord étudier Granville à travers sa trajectoire, ses activités, sa population et ses
infrastructures, pour resituer la cité dans son contexte historique, du XVIIe siècle jusqu’au Premier Empire.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
1
/
49
100%