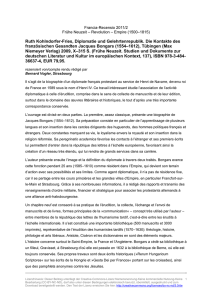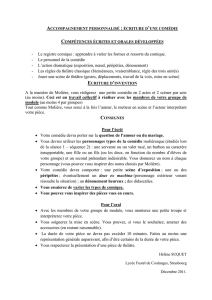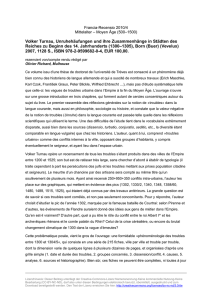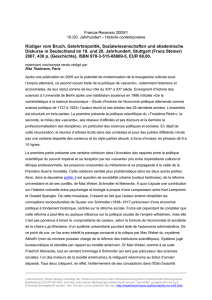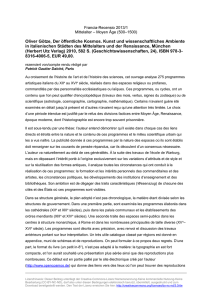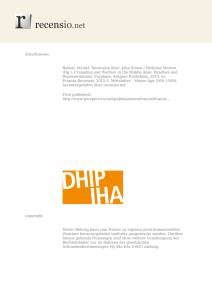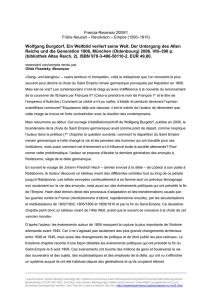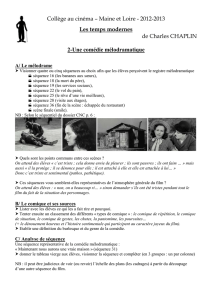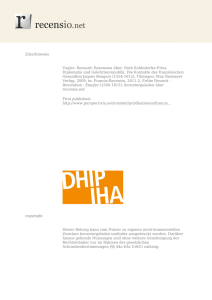Le théâtre comique français et la représentation

discussions 5 (2010)
Goulven Oiry
Le théâtre comique français et la représentation de la ville:
rouages et usages d 'un espace-miroir (1550–1630)
Résumé:
A la charnière des XVIe et XVIIe siècles, farceurs et acteurs comiques interviennent au cœur même de
la ville: dans la rue, dans des collèges ou dans les premières salles spécifiquement dévolues à l 'art
théâtral. En outre, de Cicéron aux humanistes de la Pléiade, le théâtre du rire est pensé comme le
plus ›réaliste‹ des genres dramatiques: et c 'est à lui qu 'il revient de représenter la vie urbaine.
A partir de textes comiques de la Renaissance et des débuts de l 'âge baroque, nous réfléchirons aux
finalités sociales de la représentation, sur scène, de la cité. Le théâtre est le lieu où la ville se donne
en spectacle. L '›écran‹ de la comédie nourrit la conscience et la compréhension que le public a de son
espace.
Zusammenfassung:
Im späten 16. Jahrhundert traten die Schauspieler und Komödianten der Farce mitten in der Stadt auf,
ob auf der Straße, in Kollegs oder in den ersten Theaterhäusern. Außerdem galt das Lustspiel, von
Cicero bis zu den Humanisten der Pléiade, als die ›realistischste‹ aller dramatischen Gattungen: Ihm
kam es zu, das Stadtleben darzustellen.
Die Textanalyse von Lustspielen aus der Frühen Neuzeit wird ermöglichen, die soziale Tragweite der
theatralen Darstellung der Stadt auf der Bühne zu ermessen. Das Theater ist der Ort, an dem die
Stadt sich zur Schau stellt. Insofern steigert die Komödie als eine Art Projektionsfläche beim Publikum
das Bewusstsein und das Verständnis des eigenen Stadtraums.
Introduction
<1>
»J 'ay tousjours ouy dire que Paris estoit le purgatoire des plaideurs, l 'enfer des mules et le paradis
des femmes«1, s 'exclame le vieillard Girard dans la comédie d 'Odet de Turnèbe intitulée Les Contens
(1584). Chacun sera libre d 'aller vérifier la pertinence de ces allégations: pour l 'heure, nous nous
intéresserons à la dramaturgie comique2, et à la façon dont elle représente la ville. Les recherches
1 Odet de Turnèbe, Les Contens, scène 6 de l 'acte IV; Paris 1983 (Société des Textes Français Modernes), p.
115.
2 Textes de référence:
L 'Andrie de Térence, traduite par Charles Estienne (1ère publication: 1542 / édition moderne: Luigia Zilli (éd.),
Théâtre français de la Renaissance, La Comédie à l 'époque d 'Henri II et de Charles IX. Première Série, vol. 6
(1541–1554), Florence, Paris 1994);
L 'Eugène d 'Etienne Jodelle (1552 / Michael J. Freeman (dir.), Exeter 1987, Textes Littéraires, LXV)
La Trésorière et Les Esbahis de Jacques Grévin (1558 et 1560 / Elisabeth Lapeyre (éd.), Paris 1980, Société des
Textes Français Modernes);
Le Brave de Jean-Antoine de Baïf (1567 / Simone Maser (éd.), Genève 1979, Textes Littéraires Français);
Les Corrivaus de Jean de La Taille (1573 / Denis L. Drysdall (éd.), Paris 1974, Société des Textes Français
Modernes);
La Reconnue de Rémy Belleau (1577 / Jean Braybrook (éd.), Genève 1989, Textes Littéraires Français);
Le Laquais et Les Esprits de Pierre de Larivey (1579 / Madeleine Lazard, Luigia Zilli (éd.), 1987, Société des
Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

que nous avons engagées dans le cadre du doctorat nous amènent à poser frontalement la question
du rapport entre espace et discours, entre spatialisation et sémantisation, entre la réalité spatiale et
ses représentations sociales.
<2>
Le théâtre comique de la Renaissance et de l 'âge baroque nous place en effet au cœur d 'une double
préoccupation. Le théâtre est d 'abord un lieu concret: c 'est un espace social, situé au cœur de la ville.
A la charnière des XVIe et XVIIe siècles, farceurs et acteurs comiques interviennent au cœur même de
la cité: dans la rue, dans des collèges, ou dans les premières salles spécifiquement dévolues à l 'art
dramatique. Le théâtre comique, de surcroît, ›fabrique‹ de l 'espace. L 'art du théâtre repose sur la mise
en scène, qui suppose elle-même une mise en espace. Le genre comique, en particulier, de Cicéron
aux humanistes de la Pléiade, est pensé comme le plus ›réaliste‹ des arts dramatiques: et c 'est à lui
qu 'il revient de représenter la vie urbaine. Les traités de rhétorique et d 'architecture associent à la
comédie un décor citadin. La ville est donc à la fois l 'espace où se tient la représentation et l 'espace
représenté sur scène. Le théâtre s 'affirme comme »un lieu de parole dans la cité et sur la cité«3.
<3>
Le spectacle comique de la Renaissance et des débuts de l 'âge baroque permet de faire jouer la
notion d 'espace dans la pluralité de ses acceptions, et dans la variété de ses ›fonctionnements‹:
espace réel, espace fantasmé; espace physique, espace symbolique; espace social, espace littéraire.
A partir de textes comiques, nous réfléchirons à la spécificité du lieu théâtral au sein de l 'espace
urbain. Il s 'agira en définitive d 'apprécier les finalités sociales de la représentation, sur scène, de la
cité.
1. Le théâtre du rire: un spectacle vivant, pleinement inscrit dans
l 'espace urbain
<4>
Les farces, les sotties et les parades sont des spectacles comiques dont l 'origine remonte au Moyen
Âge, et qui continuent à être joués tout au long de la Renaissance. Les farces agrémentent les fêtes
Textes Français Modernes, et: Michael J. Freeman (éd.), Genève 1987, Textes Littéraires Français);
La Néphélococugie, ou La Nuée des cocus de Pierre Le Loyer (1579 / Miriam Doe, Keith Cameron (éd.), Genève
2004, Textes Littéraires Français);
Les Contens d 'Odet de Turnèbe (1584 / Norman B. Spector (éd.), Paris 1964, Société des Textes Français
Modernes);
Le Fidèle et Les Tromperies de Pierre de Larivey (1611 / Paris 1989, Collection du répertoire. L 'Illustre-Théâtre ,
et: Keith Cameron, P. Wright (éd.), Exeter 1997, Textes Littéraires);
Les Œuvres de Tabarin avec les Adventures du capitaine Rodomont, la Farce des bossus et autres pièces
tabariniques (1622 / Georges d 'Harmonville (éd.), Paris 1858;
Charles Mazouer (éd.), Farces du Grand Siècle, Paris 1992, Le Livre de Poche classique.
3 Christian Biet, Christophe Triau, Qu 'est-ce que le théâtre?, Paris 2006 (Folio Essais), p. 189.
Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

carnavalesques religieuses et calendaires, mais aussi les réunions de corporations. Elles sont de mise
aussitôt qu 'un groupe est rassemblé pour une occasion qui invite aux réjouissances. Elles
interviennent ainsi lors de représentations publiques: lors des cérémonies officielles (mariage princier,
entrée d 'un haut dignitaire dans une ville), comme lors des événements les plus quotidiens (foires,
marchés, noces). Elles sont pratiquées par des joueurs occasionnels, dont les basochiens sont la
meilleure illustration: ces jeunes gens tapageurs sont des clercs, avocats ou procureurs, qui aiment à
s 'adonner à un théâtre turbulent et truculent, qui se produisent dans les Palais de justice de Paris,
Toulouse, Bordeaux, Grenoble, Dijon, Poitiers ou encore Rouen.
<5>
C 'est du milieu des collèges que naît en France la révolution théâtrale de la seconde moitié du
XVIe siècle: la comédie ›à l 'antique‹ vient concurrencer la farce médiévale française. Les maîtres de
ces collèges, qui sont autant d 'humanistes érudits, se livrent à un patient travail de traduction, de
commentaire et d 'édition, jusqu 'à remettre en lumière la comédie ›à l 'italienne‹ – que cette Italie soit
celle des Latins ou celle de la Renaissance, celle de Térence ou celle de Machiavel. Pourtant, c 'est
bien dans la rue qu 'est représentée pour la première fois une comédie sur le sol français: il s 'agit
d 'une pièce de Bibbiena, la Calandria, jouée en 1548 à l 'occasion de l 'entrée solennelle à Lyon de
Catherine de Médicis et d 'Henri II4.
<6>
L 'art dramatique, dans la période qui retient notre attention, s 'intègre sans peine aux autres
manifestations d 'une vie sociale qui est elle-même fortement théâtralisée. L 'écart est souvent faible
entre la représentation et la réalité, entre la scène et la rue. Avant même de se constituer en genres
littéraires, farces et comédies font pleinement corps avec une ville qui leur sert d 'écrin. Immergé dans
la vie de la cité, le ›théâtre comique‹ renvoie à des lieux multiples: à l 'espace social vers lequel
converge un ›public‹, à l 'espace matériel où le spectacle est joué (rue ou bâtiment), enfin au dispositif
scénique proprement dit (tréteaux ou salle à l 'italienne). Ce dispositif scénique fonctionne comme un
système perceptif, sensoriel, cognitif: il impose un point de vue sur l 'action mise en scène. Or, de
1550 à 1630, le rire passe peu à peu de la rue à la salle5. L 'espace public est le milieu ›naturel‹ de la
farce: le spectacle se joue à l 'air libre. L 'avènement de la comédie fait à l 'inverse de l 'espace citadin
un décor artificiel: le spectacle se donne dans un ›sanctuaire‹ clos. Ce nouvel agencement spatial
comprend un caractère normatif et prescriptif plus nettement marqué: il constitue un modèle
d 'ordonnancement de l 'espace, il en vient à fonctionner comme un vecteur de bonnes pratiques
4 Voir Charles Mazouer, Le Théâtre français de la Renaissance, Paris 2002 (Champion), p. 175.
5 Daniel Vaillancourt, Le spectacle du lieu public: éléments d 'esthétique urbaine, dans: Les arts du spectacle dans
la ville (1404-1721), Paris 2001 (Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance, 24), p. 205-236, ici p.
207.
Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

sociales. En rentrant dans les salles, le spectacle comique met progressivement en sourdine la verve
bouffonne qui est l 'apanage de la farce: c 'est une comédie ›honnête‹, policée et érudite que l 'on
cherche à imposer. Il complique de surcroît son rapport à la ville: laquelle est à la fois à l 'extérieur et à
l 'intérieur du théâtre, re-présentée.
2. Le théâtre du rire, miroir de la ville
<7>
Les genres comiques revendiquent une fonction de miroir de la vie sociale. La comédie, en particulier,
se définit comme imitatio vitae, speculum consuetudinis, imago veritatis: imitation de la vie, miroir des
mœurs, image de vérité. Ces définitions, héritées de Cicéron6 et devenues topiques, sont relayées par
la préface aux œuvres de Térence attribuée au grammairien Donat. La conception d 'une comédie-
miroir est reprise par les théoriciens humanistes, notamment par Jacques Peletier dans son Art
poétique de 1555: »La Comédie a été dite par Live Andronique, le premier Ecriteur de Comédies
Latines, le miroir de la vie: parce qu 'en elle s 'introduisent personnes populaires«7. Le dramaturge Jean
de La Taille, auteur des Corrivaus (1573), assure en des termes comparables que sa pièce
»représentera comme en un miroir le naturel & la façon de faire d 'un chascun du populaire«8. Quand il
s 'agira de caractériser la comédie, Molière et Boileau resteront fidèles à la métaphore9.
<8>
La comédie nous donnerait ainsi accès à des comportements ›naturels‹. Elle se propose de nous faire
entrer dans la vie conjugale, familiale ou professionnelle des protagonistes. Elle se définit par son
ambition réaliste. Or la réalité dont le théâtre du rire vient témoigner est avant tout citadine.
<9>
Le spectacle comique reflète d 'abord l 'espace urbain dans sa matérialité physique. Il offre une image
de la topographie emblématique de la ville. Il dit aussi les perceptions ou les représentations
fantasmatiques qui s 'attachent à une cité. La comédie française des années 1550-1630 met Paris à
6 Cicéron, De Republica, IV, 11 (le fragment manque dans le texte qui est parvenu jusqu 'à nous).
7 Jacques Peletier, Art poétique, Second livre, chapitre VII, dans: Traités de poétique et de rhétorique de la
Renaissance, Paris 1990 (Le Livre de Poche classique), p. 277.
8 Jean de La Taille, Les Corrivaus, (voir n. 2), Le Prologue, p. 57.
9 »Ce sont miroirs publics«, avance Uranie à la scène 6 de La Critique de l 'Ecole des femmes (Molière, Œuvres
complètes, I, Paris 1971 (Bibliothèque de la Pléiade), p. 658). Dorante lui fait écho: Lorsque vous peignez les
hommes, il faut peindre d 'après nature. On veut que ces portraits ressemblent; et vous n 'avez rien fait, si vous n 'y
faites reconnaître les gens de votre siècle« (ibid., p. 661). Boileau confirme: »Chacun, peint avec art dans ce
nouveau miroir, / S 'y vit avec plaisir, ou crut ne s 'y point voir: / L 'avare, des premiers, rit du tableau fidèle / D 'un
avare souvent tracé sur son modèle; / Et mille fois un fat, finement exprimé, / Méconnut le portrait sur lui-même
formé« (Nicolas Boileau, L 'Art poétique, chant III, vers 353–358; in: Satires, Epîtres, Art Poétique, Paris, 1985
(Poésie), p. 249).
Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

l 'honneur: ses quartiers, ses ponts, ses églises, ses cabarets, ses lieux de prostitution (Champ-
Gaillard sur la rive gauche, Champ Huleu sur la rive droite), ses prisons (Conciergerie et Châtelet).
Mais certaines des pièces de Pierre de Larivey – comme Les Tromperies – sont troyennes, La
Reconnue de Rémy Belleau a pour cadre Orléans, La Néphélococugie de Pierre le Loyer nous fait
entrevoir Toulouse. Les villes sont toujours plus qu 'un arrière-plan: elles sont un élément essentiel de
la dramaturgie, un enchevêtrement de ruelles et de recoins qui permettent aux personnages de
fomenter tromperies et complots. Dans Le Brave de Baïf, les protagonistes escaladent les toits des
maisons, pour s 'espionner. Ce type d 'acrobaties citadines peut céder la place à des courses-
poursuites: à l 'acte V des Contens d 'Odet de Turnèbe (1584), le domestique Antoine fait le tour des
églises parisiennes de l 'actuel quatrième arrondissement (avec quelques détours possibles par les Ier,
Ve et VIe), à la recherche de la fausse dévote Françoise. Les efforts du valet restent vains puisque
l 'entremetteuse Françoise, qui se fait passer pour prude, reste hors d 'atteinte. Mais les démarches
d 'Antoine font l 'objet d 'un récit haletant:
<10>
»ANTOINE: J 'ay fait comme je pense près de deux lieuës depuis une heure par ceste ville
pour trouver Françoise, mais au diable si je l 'ay peu jamais rencontrer. J 'ay esté en son
logis, où j 'ay trouvé une petite fille qui m 'a dit qu 'elle estoit allée ouïr le salut au Saint-Esprit.
Où je suis allé en toute diligence, pensant l 'y trouver, mais elle n 'y estoit pas. De là j 'ay esté
à Saint-Jean, Saint-Gervays, Saint-Paul, Saint-Antoine, l 'Ave-Maria, pour voir si je la
trouverois, d 'autant qu 'elle est plus souvent aux eglises qu 'à sa maison. Après, j 'ay passé
par les Blancs-Manteaux, les Billetes, Sainte-Croix, et m 'en suis venu à Saint-Merry, Saint-
Jacques, Saint-Eustache, Saint-Germain, et autres eglises et lieux de devotion. Mais jamais
je n 'ay trouvé personne qui m 'en peust dire certaines nouvelles«10.
<11>
Le spectateur de l 'époque déchiffrait instantanément les références: le jeu des repérages sollicitait sa
connaissance pratique des lieux. Le lecteur ou l 'historien du XXIe siècle peut adopter un regard plus
distancié sur ces allusions spatiales, et reconstituer la configuration du Paris religieux, voire bigot, de
la fin du XVIe siècle. Mais la cartographie que dessinent nos pièces comiques est surtout d 'un autre
ordre: le théâtre du rire s 'avère être à l 'écoute des soubresauts de la ville comprise comme espace
social et politique. Le »continent social«11 que fait émerger la comédie est d 'essence éminemment
urbaine. Les figures mises en scène sont de moyenne ou de basse extraction: membres du clergé,
hommes d 'armes, médecins, avocats, artisans, marchands, financiers, bourgeois, domestiques. Les
titres des farces sont à cet égard évocateurs, ils font souvent référence à des types sociaux-
professionnels: Le Chaudronnier, Le Savetier et le Tavernier, etc. Ces représentants du peuple citadin
10 Odet de Turnèbe, Les Contens (voir n. 1), scène 1 de l 'acte V, p. 117–118.
11 Mazouer, Le Théâtre français de la Renaissance, (voir n. 4), p. 322.
Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%