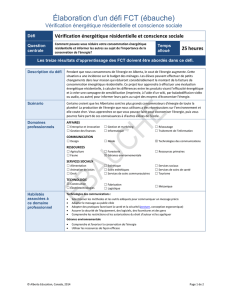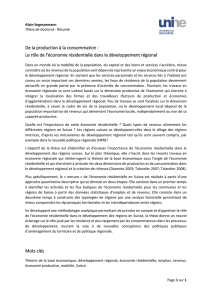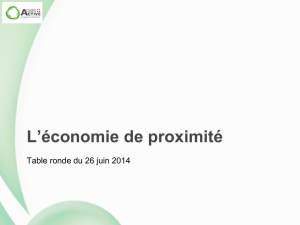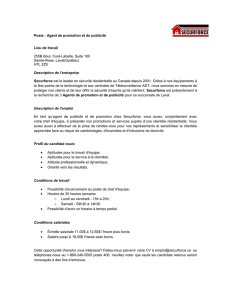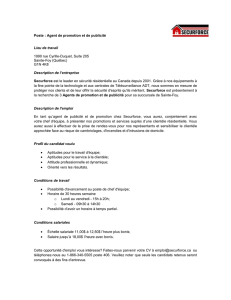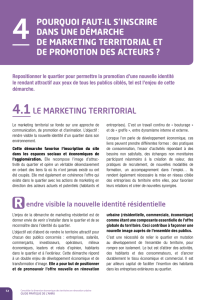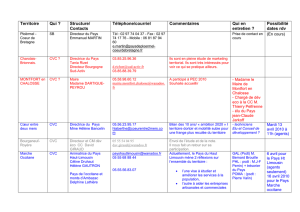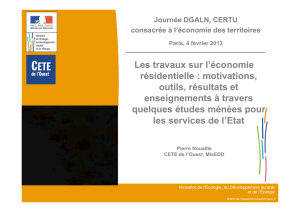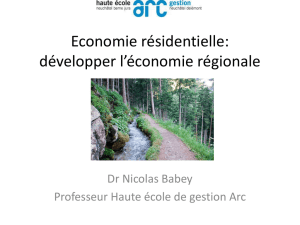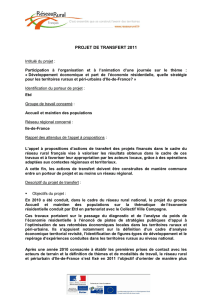L`économie résidentielle et le développement local : conséquence

PREFECTURE DE REGION MIDI-
PYRENEES
L’économie résidentielle et le
développement local :
conséquence ou levier ?
Rapport
Octobre 2007
Philippe Estèbe
Yves Janvier
Sophie Tievant
Laurent Davezies

SOMMAIRE
1. Synthèse de l’étude .......................................................................................... 3
2. Objet et méthode de l’étude ............................................................................. 12
3. Les principales composantes de la base économique des pays de Midi-
Pyrénées ........................................................................................ 17
Quatre types de pays en Midi-Pyrénées............................................................... 17
Quel impact de la base économique sur les fondamentaux des pays ? ........... 23
4. La prise en compte des enjeux de l’économie résidentielle par les pays.... 40
Pays Albigeois Bastides ........................................................................................ 43
Pays d’Armagnac ........................................................................................ 47
Pays Bourian ........................................................................................ 51
Pays Lauragais ........................................................................................ 55
Pays Midi-Quercy ........................................................................................ 60
Pays Pyrénées Cathares 64
Pays Ruthénois ........................................................................................ 67
Pays Vallée des Gaves ........................................................................................ 72
5. Entretiens conduits avec des “entrepreneurs résidentiels” ......................... 76
6. Annexe : données sur les unités urbaines des pays de Midi Pyrénées..... 107
2

1. Synthèse de l’étude
L’économie résidentielle est entrée dans le vocabulaire courant depuis plusieurs
années, grâce notamment aux travaux pionniers de Laurent Davezies. Elle fait
l’objet, notamment dans les territoires ruraux, de jugements extrêmement tranchés.
Pour les uns, il s’agit de l’avenir du monde rural, dès lors que l’agriculture est
résiduelle, du moins en termes de population occupée. Pour les autres, il s’agit d’une
« fausse économie », qui entretient l’illusion de l’activité, alors qu’elle n’est alimentée
que par des revenus venant de l’extérieur, et donc renforce la dépendance du
territoire.
Dans ce travail, avec le service étude du SGAR de Midi-Pyrénées, nous n’avons pas
pris parti ; nous ne sommes ni pour, ni contre l’économie résidentielle (bien au
contraire). L’économie résidentielle, autrement dit, la présence, dans un territoire, de
personnes porteuses de revenus qui proviennent d’activités menées ailleurs que
dans ledit territoire, est un phénomène réel. Notre propos n’est ni d’en faire
l’apologie, ni le procès, mais de le comprendre, ou du moins de participer à sa
compréhension et à celle des conséquences qu’il entraîne.
Cette étude a cherché à identifier le poids de l’économie résidentielle dans les pays
de Midi-Pyrénées, à comprendre la manière dont les acteurs du développement local
en tiennent compte et, éventuellement, l’utilisent comme un levier pour le
développement.
L’étude a enfin permis de rencontrer différents « entrepreneurs résidentiels » qui
permettent de cerner le nouveau visage de l’économie rurale, autant, sinon mieux
que l’approche statistique.
Définitions
La richesse d’un territoire infra national (ce que l’on appelle la « base économique »)
provient de deux sources :
- les revenus de la production de biens et de services que les agents économiques
localisés dans le territoire « vendent » à l’extérieur ; on parle alors de base
« productive ».
- les revenus liés à la résidence dans le territoire de personne qui n’y travaillent pas,
mais qui sont susceptibles de dépenser : il s’agit principalement des retraités, des
résidants actifs dans d’autres territoires et des touristes.
L’ensemble de ces revenus (productifs+résidentiels) détermine un niveau de
demande potentielle, qui, à son tour alimente des activités domestiques, tournées
vers la satisfaction des besoins de la population résidante, qu’elle travaille, ou non,
dans le territoire considéré.
3

1. Le poids de l’économie résidentielle dans les Pays de Midi-Pyrénées
Composition du revenu basique des ménages dans les
pays de Midi-Pyrénées (2000)
17%
9%
15%
28%
19% Basique productif privé
Salaires publics
Salaires résidentiels
importés
Revenu des retraites
Dépenses touristes
Dans leur ensemble, les pays de Midi-Pyrénées sont fortement alimentés par les
revenus d’origine résidentielle : pour l’ensemble des pays (le calcul est fait hors unité
urbaine, pour saisir la réalité de l’espace rural), les deux premières sources de
revenu sont les retraites (28 % du revenu) et les dépenses touristiques (19% du
revenu). Cependant, cette donnée d’ensemble recouvre d’importants contrastes.
Un premier résultat de l’étude réside dans la permanence de pays ruraux dont
l’économie, en Midi-Pyrénées, est essentiellement productive. La grande périphérie
régionale, celle qui est faiblement sous influence métropolitaine, continue d’être un
territoire de production, soit industriel, soit agricole, soit les deux. Cela n’est pas
totalement surprenant et correspond à une géographie nationale : les emplois
industriels (du moins dans une définition restrictive de l’emploi industriel1) sont
proportionnellement plus nombreux en milieu rural qu’en milieu urbain. Grâce à une
industrie agroalimentaire très importante (1er employeur industriel en Midi-Pyrénées)
mais aussi grâce à une activité industrielle qui s’est maintenue, voire développée
dans les espaces ruraux (par exemple dans le pays de la vallée de la Dordogne
lotoise), tous les pays de Midi-Pyrénées ne sont pas uniquement voués aux revenus
résidentiels. 7 pays sur 32 présentent ce profil productif. Parmi ceux-ci, l’Armagnac
présente la composante productive la plus élevée des bases de Midi-Pyrénées.
1 Les emplois strictement industriels de pure « production » sont, on le sait, désormais minoritaires
dans le procès de fabrication. Ainsi, la proportion d’emplois industriels dans la population active est-
elle à Colomiers, inférieure à Lacaune par exemple.
4

Armagnac
25%
9%
7%
29%
17% Basique productif privé
Salaires publics
Salaires résidentiels
importés
Revenu des retraites
Dépenses touristes
Les autres pays se partagent en trois grandes catégories :
− Les pays périurbains, dont les ménages disposent d’un revenu caractérisé,
par rapport à la moyenne des pays, par une proportion supérieure de salaires
importés, touchés dans les pôles d’emplois (villes centre notamment) et
« ramenés » au domicile, du fait de la dissociation entre domicile et travail.
Parmi ceux-ci, le pays du Girou-Tarn, aux portes de Toulouse, présente la
plus forte composante de salaires importés.
Girou-Tarn-Frontonnais
14%
7%
32%
27%
5% Basique productif privé
Salaires publics
Salaires résidentiels
importés
Revenu des retraites
Dépenses touristes
− Les pays de retraités, dont les ménages disposent d’un revenu caractérisé,
par rapport à la moyenne des pays, par une proportion dominante (supérieure
à 30 %) de pensions de retraites. C’est le pays des Coteaux, sur le plateau
de Lannemezan, qui illustre le mieux cette catégorie.
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
1
/
116
100%