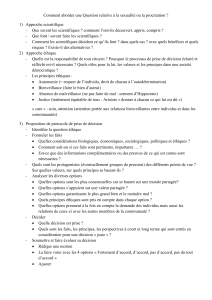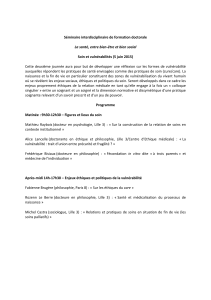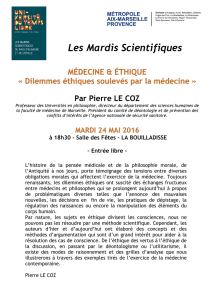Répertoire analytique de l`éthique sociale

Répertoire analytique de l’éthique sociale
Principes méthodologiques.
I - Motivations générales
Une première motivation de cette entreprise est simplement classificatoire. Il s’agit de
contribuer, dans des domaines inévitablement limités, à répertorier les normes ou principes qui
structurent la vie sociale et les discussions sur l’existence collective. Ces règles constituent une
sorte de patrimoine commun offrant de multiples ressources pour la coordination, l’entente
pacifique ou l’action coopérative. Elles présentent souvent une relative indépendance par rapport
aux détails des organisations ou des activités particulières.
La littérature est évidemment immense dans ce domaine, puisqu’elle recoupe au moins la
philosophie morale et politique, ainsi que la branche normative des sciences économiques, de la
science politique et d’autres sciences sociales. Toutefois, les chances d’une classification
systématique - au moins dans des domaines limités - apparaissent plus sérieuses depuis que l’on
peut avoir recours aux analyses conduites dans des cadres conceptuels unifiés et complètement
explicites au regard du traitement de l’action et des choix (notamment en théorie des jeux, dans la
théorie des choix collectifs, en logique normative et dans les parties systématiques de la
philosophie morale et politique).
De plus, une classification fondée sur les propriétés que vérifient les diverses règles ou normes
présenterait l’intérêt de faire apparaître immédiatement certaines raisons d’adoption ou de rejet.
Les études de cas réalisées dans ce programme contribuent, d’un point de vue méthodologique, à
relier systématiquement les normes à leurs propriétés. Dans des sociétés à dominante
individualiste et marquées par les exigences de pluralisme, il faut chercher de ce côté la véritable
source de l’autorité en morale. La clarification des raisons potentielles d’adoption ou de rejet est
particulièrement importante pour favoriser le recours choisi à tel ou tel principe dans des activités
d’organisation ou de conception institutionnelle.
- 1 -

Le projet pourrait rencontrer les préoccupations des chercheurs cherchant à expliquer
l’acceptation ou le rejet des normes sociales sur la base de la compréhension individuelle des
propriétés de ces normes. Il peut aussi contribuer à développer des outils pour une analyse
pluraliste des dispositifs normatifs, dans laquelle on s’interroge sur les relations entre les
principes que peuvent accepter les individus à titre personnel (en fonction des valeurs qu’ils
jugent importantes ou prioritaires) ceux qu’il est possible de concrétiser par des normes
communes à l’usage d’une pluralité d’individus.
Le classement ou la présentation des règles selon leurs principales propriétés oblige par ailleurs
toujours à reconstituer un cadre analytique de référence (concernant les actes, les états du monde,
les intentions, projets ou maximes par exemple) dans lequel une règle donnée et ses propriétés
peuvent recevoir une formulation claire, là où l’usage courant se contente souvent de l’implicite.
Il convient alors d’en donner une représentation aussi succincte que possible. Concrètement, cela
se traduit par la formulation explicite de principes, par la mise en évidence de “définitions” et
“conditions” importantes au moyen desquelles on aborde des secteurs de la réalité sociale ou
politique, et par l’inclusion de “modèles” consistant en définitions et conditions permettant
conjointement de parvenir à certaines conclusions (“propriétés”) ou à des solutions définies.
L’inclusion d’exemples complètement développés est aussi appréciable à titre illustratif.
Par exemple, il est bien connu que les ambiguïtés des arguments sur la liberté proviennent en
partie de la signification attribuée à des termes et expressions tels que : acte, choix, cause d’un
état de fait, intervention, empêchement, abstention, circonstance, « droit à », « droit de », etc. Il
est également connu que les définitions retenues ne peuvent pas être indépendantes les unes des
autres : on rencontre plutôt un cadre d’analyse plus ou moins complet relatif à l’action et à
l’interaction. De ce fait, il est important de mettre en évidence ce qui est nécessaire pour pouvoir
donner une signification et/ou une concrétisation à une certaine propriété des règles éthiques (par
exemple, dans le cas des libertés personnelles, leur compatibilité mutuelle). Nous souhaitons
enfin rendre manifeste, autour de certaines questions, la réalité d’un progrès cumulatif dans la
compréhension des règles éthiques. Réduire l’éthique à l’opinion personnelle ou à l’histoire des
civilisations est réducteur: nous comprenons aujourd’hui des choses que l’on ne comprenait pas
hier.
- 2 -

II- Exigences et propositions méthodologiques
1) Neutralité culturelle
Il n’est pas question ici de privilégier par principe une tradition intellectuelle ou une autre.
Chacun mobilise ce qu’il connaît mais aucune tradition particulière ne se trouve investie d’un
quelconque privilège quant à la proposition de principes d’éthique sociale. Il ne s’agit pas de
contribuer à un savoir de type traditionnel. Au contraire, l’une des hypothèses sous-jacentes à ce
programme est que certaines choses appellent une compréhension objective dans le domaine de
l’analyse des normes d’éthique sociale (en les saisissant notamment dans leur rapport avec les
modalités de l’interaction sociale) sans les rapporter de manière exclusive à une "culture" et une
"histoire" données.
2) Interprétation complète
Il apparaît particulièrement important de mentionner explicitement les contextes d’interaction
dans lesquels certaines propriétés peuvent être rapportées à telle ou telle règle, ce qui suppose
tout d’abord qu’au moment où l’on examine ses propriétés, la règle elle-même soit formulée
d’une manière qui possède un sens compréhensible dans les contextes en question. Il faut donc
poser des règles d’interprétation explicites et aussi complètes que possible pour éviter de
considérer des règles ou normes susceptibles de se voir attribuer simultanément différentes
significations.
3) Explicitation du cadre d’analyse dans la formulation des propriétés des règles et non pas
dans l’énoncé initial de la règle
Certaines études consacrées aux règles ou normes sont théoriquement construites au sein d’un
cadre d’analyse particulier: par exemple, si l’on étudie les différents types de « fonctionnelles de
choix social » qu’il est possible de construire dans le cadre analytique des choix collectifs, ou
encore, si l’on étudie le statut et les propriétés de l’exception dans un cadre analytique proposé
par la logique normative. Mais notre objet n’est pas ici d’offrir des manuels consacrés à théories.
L’ambition fondamentale du programme est de contribuer à la synthèse de ce qui est acquis à
propos des règles « réelles »: celles auxquelles les acteurs sociaux font appel concrètement pour
définir ce qui leur semble correct au point de vue éthique.
- 3 -

C’est dans un deuxième temps (en vue de l’étude des propriétés des normes) que l’on rattache les
normes à un cadre analytique particulier. On peut juger nécessaire, alors, de mobiliser des entités
théoriques (liées dès l’origine à un cadre d’analyse et de description précis, parfois dans langage
symbolique). Il faudra préciser d’emblée les règles de la correspondance avec le vocabulaire de
l’observation: les descriptions courantes de l’action, de l’interaction sociale et des règles qui
peuvent les encadrer.
4) Propositions pour la conception des entrées
Pour concrétiser les exigences précédentes, on peut tenter de partir d’une règle formulée en
langage naturel (par exemple « attribuer un droit de libre choix du vêtement à une personne »)
avant d’indiquer comment une règle de ce type (c’est-à-dire un principe effectivement mobilisé
dans la vie réelle) se laisse comprendre dans différents cadres analytiques connus (ayant un
rapport précis avec les arguments courants) et quelles propriétés on peut lui rapporter grâce aux
aperçus obtenus dans ces différents cadres. En somme, les différents cadres d’analyse sont traités
comme des moyens d’apercevoir les propriétés des règles éthiques.
Mais il se trouve que certaines propriétés sont rapportées à certaines règles en l’absence de toute
référence précise à un cadre théorique connu. Par exemple, de très nombreuses doctrines morales
et politiques admettent la possibilité de l’attribution à tous d’un certain nombre de libertés de
base identiques pour tous. Donner à tous des libertés de base constitue une règle d’éthique
sociale. Il peut être utile de proposer alors une reconstitution de cadres d’analyse implicites
courants et une présentation succincte des cadres d’analyse dans lesquels cette propriété est
effectivement vérifiée, pour certaines classes (à préciser) de « libertés » et de circonstances. Cela
devrait favoriser la mise en communication des acquis de l’analyse avec l’explication sociale des
croyances et attitudes, ainsi que la théorie du rôle des principes dans la coordination ou la
coopération sociales.
L’énumération des propriétés des règles éthiques est, de manière indissociable, l’énumération de
certains rapports entre ces règles. On ne retient pas l’hypothèse d’une différence de nature
évidente entre des règles intrinsèquement « éthiques » et d’autres qui, à l’exemple des règles
d’efficacité ou des principes de gestion ou de politique, ne le seraient pas. Toutes les règles qui
intéressent la vie collective, dans tous les domaines, sont traitées de manière uniforme. Mais la
- 4 -

sélection des entrées du répertoire doit concerner des classes de règles qui appellent des questions
éthiques.
La théorie abstraite des choix collectifs et la philosophie morale ont montré que certains des
principes qui permettent de formuler les propriétés importantes des règles éthiques sont de nature
essentiellement transversale ; on les retrouve identiquement dans de très nombreux domaines et,
au prix de reformulations parfois complexes, ils peuvent être mobilisés dans différents cadres
d’analyse. Ces principes - unanimité, universalisation, impartialité, égalité, légalité, traitement
uniforme… - apparaissent donc comme le ferment possible d’une description unifiée des
propriétés des règles éthiques.
Il n’est pas certain qu’il soit utile de chercher à les définir. Il faut plutôt tenter de leur donner une
formulation claire dans différents cadres d’analyse (courants ou savants) et de répertorier leurs
formulations les plus utiles.
Quels sont les types d’objets qu’il convient de répertorier? Les classes d’objets suivantes sont
retenues :
- règles de choix des actions (maximes individuelles)
- règles de coordination des choix d’actions de différents individus (principes d’organisation,
règles sociales, types de règles juridiques)
- règles d’évaluation des états de la société.
Chaque entrée du répertoire consiste en applications successives de critères ou conditions, après
la description initiale d’une classe de règles, éventuellement accompagnée d’indications sur leur
formulation dans différents cadres d’analyse. Un cas idéal serait celui où l’on épuise les possibles
en donnant « dans toutes les cases » une description utile des propriétés vérifiées; c’est le cas où
l’on procède à une énumération complète des différentes situations possibles sous une cascade
donnée d’hypothèses. Mais on peut aussi indiquer les propriétés connues dans différents sous-cas
sans donner de précisions concernant ce qui se passe dans les autres sous-cas recensés.
Dans ce programme, le pari est fait d’une certaine continuité entre, d’une part, les propriétés
précises établies dans des cadres analytiques dérivés de théories et, d’autre part, les propriétés
« hautement plausibles » ou « attribuées sur la base d’arguments solides », qui apparaissent
depuis très longtemps dans la tradition de la philosophie morale et politique et dans les diverses
traditions morales; par exemple: la prise de conscience d’un antagonisme entre la légitimation du
- 5 -
 6
6
1
/
6
100%