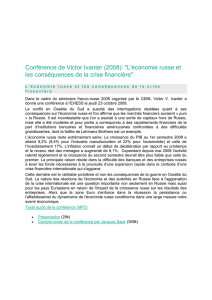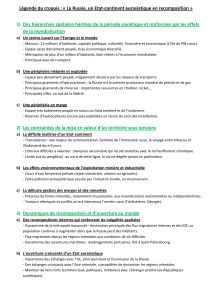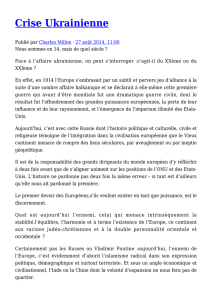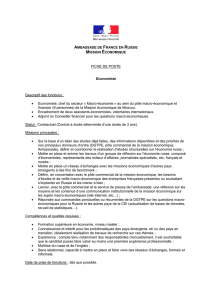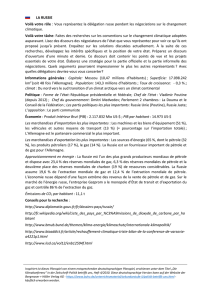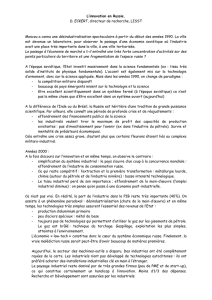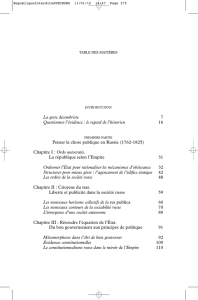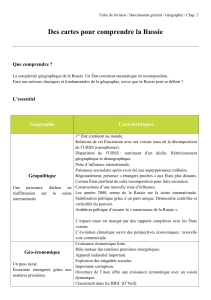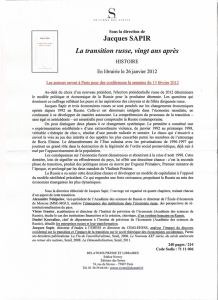Les Relations récentes entre la Russie et les Etats

Les Relations récentes entre la Russie et les Etats-Unis
Par : Gilles TROUDE, chercheur au DESC de l’Université de Paris
III-Sorbonne Nouvelle. Il est l’auteur d’un ouvrage, « Yougoslavie,
un pari impossible?
Lors du sommet de Davos, en février 2000 en Suisse, un médecin russe donna l’ordre
au conducteur de l’ambulance d’emmener son patient directement à la morgue. « Pourquoi? »
supplia le patient, « Je ne suis pas encore mort! ». « Taisez-vous », répondit le médecin, «
nous ne sommes pas encore arrivés! » [1].
Cette plaisanterie, qui circulait à Moscou à l’époque, décrit parfaitement l’état d’esprit des
relations entre les Etats-Unis et la Russie, lors de l’avènement de Vladimir Poutine au
pouvoir.
Depuis l’éclatement de l’Union Soviétique en 1991, la Fédération de Russie, qui a repris son
siège aux Nations Unies, et souhaiterait en assurer la continuité, est « en mal de politique
étrangère », selon l’expression de Marie Mendras [2]. « Nous n’avons ni alliés, ni amis, ni
ennemis », constatait amèrement un diplomate russe à la veille de la conférence de
Rambouillet en 1999 [3] .
Certes, il y a bien eu la tentative de création de la Communauté des Etats Indépendants, mais
nous verrons qu’à part la Biélorussie, et, dans une moindre mesure, l’Arménie, la plupart de
ses membres ne suivent nullement la Russie dans sa politique étrangère.
Rappelons brièvement les faits : bien que sa superficie en fasse encore le plus vaste pays du
monde, la population de la Russie ne représente qu’à peine plus de la moitié de celle de
l’Union Soviétique : 150 millions d’habitants contre 245 pour l’URSS. Mais surtout, la
terrible crise financière de 1998, faisant suite à une libéralisation trop rapide, a ramené le
Produit National Brut de la Fédération de Russie, selon certains experts, à quelque 6 % de
celui des Etats-Unis d’Amérique, pour une population inférieure de moitié [4]. Même si cette
estimation peut être entachée d’une forte marge d’erreur - de l’ordre de 50%, compte tenu de
la déficience des moyens de mesure statistiques -, il convient d’avoir ces chiffres en tête
lorsqu’on examine les rapports entre les deux puissances. Avec 600 milliards d’Euros, le «
poids économique » de la Russie dans le monde économique serait du même ordre que celui
du Canada, ou des trois pays scandinaves réunis, mais seulement la moitié de celui de la
France ou de la Grande-Bretagne (respectivement 1.358 et 1.355 milliards d’Euros en 1999).
Mais ces éléments purement économiques - on pourrait dire « boursiers » - ne tiennent pas
compte de la puissance militaire de la Russie. Celle-ci a hérité de sa devancière son immense
arsenal nucléaire, équivalent, sinon supérieur, ainsi que nous le verrons, à son homologue
américain, bien que l’on ignore dans quel état il se trouve, compte tenu du manque de moyens
financiers pour l’entretenir. Une chose est certaine : à la différence de l’Ukraine, qui a décidé
de se déclunéariser - au moins sur le plan militaire - la Russie dispose encore de son entière
capacité de dissuasion, autrement dit, de résister à toute attaque nucléaire de quelque pays

qu’elle provienne, y compris des Etats-Unis, et de contre-attaquer en lançant ses missiles
intercontinentaux contre les principales villes de l’agresseur, sans capacité de riposte sérieuse.
Les experts militaires américains en sont parfaitement conscients , et cet élément n’a pas cessé
d’être pris en compte dans les relations globales des diplomates américains avec la Russie.
Celles-ci, selon Laurent Rucker, ont connu trois phases avant l’arrivée du président Poutine au
pouvoir. Dans un premier temps,de 1991 à 1993, qualifiée parfois de « période romantique »,
la Russie, convertie aux dogmes occidentaux, abandonne le marxisme-léninisme et souscrit
naïvement aux soi-disant « valeurs universelles » : démocratie, libéralisme économique,
privatisations massives etc.. Elle adhère au Fonds Monétaire International, à la Banque
Internationale pour la Reconstruction et le Développement, et, dans le conflit yougoslave,
reconnaît, dès 1992 - sans contrepartie - l’indépendance de la Slovénie, Croatie, de la
République Yougoslave de Macédoine (FYROM), et de la Bosnie-Herzégovine.
Bien que ceci soit formellement contraire aux dispositions des Accords d’Helsinki dont
l’U.R.S.S. a été la co-initiatrice, et qui prévoyaient l’intangibilité des frontières existantes en
Europe, la Russie, son héritière, vote les résolutions du Conseil de Sécurité de l’O.N.U.
imposant des sanctions contre la République Fédérale de Yougoslavie, et accepte de fournir
près d’un millier d’hommes à la Force de maintien de la paix des Nations Unies
(FORPRONU) envoyée en Croatie [5] . Bien mieux, elle envisage l’adhésion à l’OTAN
comme un « objectif politique à long terme »[6] !
Dans un deuxième temps, de 1993 à 1998, la diplomatie russe amorçait une première réaction,
et son chef, Andreï Kozyrev, déclarait dès 1993 : « l’avenir de l’Europe de l’Est réside dans sa
transformation non pas en une sorte de zone-tampon, mais en un pont reliant l’Est et l’Ouest
du continent » [7]- première tentative timide de définition d’objectifs pour la diplomatie russe
- .
Plus net encore, le Président Boris Eltsine, pressé par son opposition, notamment le chef du
parti libéral-démocrate Vladimir Jirinovski, déclare, dans son adresse à la nation de février
1994 : « Nous aimons à répéter que la Russie est un grand pays, ce qui est une réalité, mais
alors que notre politique étrangère corresponde à cette réalité! 1994 doit mettre un terme à la
politique des reculs internationaux » [8] .
Ceci se traduit, dans le conflit yougoslave, par la tentative d’aboutir à un armistice dans
l’ensemble du pays. En 1994, elle accède au rang de membre du « groupe de contact » formé
avec les quatre autres « grandes puissances » ( Etats-Unis, Allemagne, France et Grande-
Bretagne) pour rechercher une solution pacifique au conflit, en liaison avec l’Organisation des
Nations-Unies.
La Russie s’oppose à la levée de l’embargo sur les livraisons d’armes effectuées aux Etats
issus de l’éclatement de la Yougoslavie, levée souhaitée par la diplomatie américaine, afin
d’aider les Musulmans et les Croates de Bosnie-Herzégovine supposés « plus faibles » que les
Serbes bosniaques (doctrine de l’équilibre des forces). Elle demande une condamnation du
nouvel Etat croate, présidé par Franjo Tudjman, pour sa politique en Bosnie-Herzégovine, et
surtout pour son « nettoyage ethnique » des 600.000 Serbes de Krajina croate en quelques
jours en août 1995 (Opération Tempête), opération de type « blitzkrieg » soutenue et
conseillée par les services secrets américains. La Russie, alliée traditionnelle de l’ancienne
Serbie pendant deux siècles, s’efforce de défendre les intérêts du peuple serbe, face à la
Croatie soutenue par l’Allemagne, et à la partie musulmane bosniaque aidée par les Etats-

Unis, sans toutefois avaliser les initiatives du Président Slobodan Milosevic. C’est ainsi que,
lorsque des avions serbes, qui n’avaient pas respecté la zone d’exclusion aérienne de Bosnie,
sont abattus par l’OTAN en février 1994, la Russie ne conteste pas le bien-fondé de
l’intervention de l’Alliance, basée sur la résolution 781 du Conseil de sécurité qu’elle a elle-
même signée [9] .
Lors des accords de Dayton, la Russie n’est pas invitée à assister directement aux
négociations qui se déroulent « à huis clos » sur la base militaire américaine de l’Ohio, mais,
lors de la signature officielle des accords à Paris, le 14 décembre 1995, entérinée par un vote
du Conseil de sécurité de l’ONU le lendemain, un rôle lui est octroyé dans l’ IFOR
(Implémentation Force), et une brigade de parachutistes russes de 1.400 soldats est dépêchée
en Bosnie-Herzégovine. Cette brigade fera beaucoup parler d’elle par la suite.
Pour ménager les susceptibilités russes, et contourner la difficulté juridique liée au fait que la
Russie ne fait pas partie de l’OTAN, une solution particulièrement élégante fut trouvée à ce
dilemme. Lors d’une réunion informelle des Ministres de la Défense de l’OTAN à
Williamsburg en Virginie, le Secrétaire américain à la défense William Perry négocia des
arrangements avec le Ministre russe de la Défense Pavel Gratchev. Ces discussions furent
facilitées par l’invitation lancée à un représentant éminent du Grand Etat-major russe, le
général Léonti Chestov, de venir au SHAPE à Bruxelles pour se familiariser lui-même avec
les procédures et la terminologie de l’OTAN.
Il fut convenu que le contingent russe serait placé sous le contrôle opérationnel du SACEUR
(Commandement Allié Suprême de l’OTAN pour l’Europe) situé à Mons en Belgique, par
l’intermédiaire du général Chestov agissant en tant qu’Adjoint au SACEUR pour les forces
russes, et sous le contrôle tactique du Commandant américain de la Division Multinationale
Nord, basée à Tuzla en Bosnie septentrionale [10].
Il nous paraît important de souligner - détail révélateur de la subtilité des rapports américano-
russes dans la pratique - que les généraux russes déclarent ne coopérer qu’avec « les militaires
américains », donc d’égal à égal, et non avec l’OTAN. Les généraux américains précisent que
les ordres écrits ne porteront pas l’en-tête de l’OTAN, mais celui de l’Armée américaine, et
que les vues de l’Adjoint russe seront systématiquement prises en compte - sans toutefois
qu’il puisse opposer son veto au général Joulwan, chef du SACEUR, qui, pour des raisons
d’efficacité militaire bien compréhensibles, aura le dernier mot (principe de la chaîne de
commandement unique) -.
Sur le terrain, la coopération entre les militaires russes et les forces alliées est symbolisée par
le fait que des patrouilles mixtes russo-américaines opèrent dans le couloir délicat de Brcko
en Bosnie du Nord-Est, corridor de 4 km. de large reliant seul la zone serbe de Banja Luka à
l’ouest à celle de Pale à l’est - y compris dans la ville même - [11].
La crise du Kosovo : détérioration des relations américano-russes
L’arrivée d’Evgueni Primakov à la tête du Ministère russe des Affaires Etrangères en janvier
1996 marque un tournant dans les relations russo-américaines. Désormais, la Russie refuse un
monde unipolaire dominé par les Etats-Unis, mais s’oriente vers un monde multipolaire,
comportant des relations privilégiées avec des puissances comme la Chine, l’Inde, l’Union
Européenne, et laissant à la Russie une plus grande marge de manœuvre [12].

Le 16 juin 1998, le Président Eltsine reçoit le Président yougoslave Slobodan Milosevic à
Moscou, et le général Leonid Ivachov, responsable de la coopération internationale au
ministère de la Défense, déclare : « Si l’OTAN lance une attaque contre la Yougoslavie, la
Russie pourrait reprendre une complète coopération militaire avec Belgrade, y compris en
violant l’embargo sur les armes » [13] .
A la conférence de Rambouillet, en février 1999, la Russie refuse de donner sa caution à une
solution qui n’est pas signée par la délégation yougoslave, ce qui provoque une rupture au
sein du groupe de contact. Selon le représentant russe, Boris Maïorski, le volet militaire de
l’accord a été signé « dans notre dos » (allusion à l’annexe prévoyant la libre circulation des
troupes de l’OTAN dans la totalité du territoire yougoslave, y compris la Serbie, annexe
présenté au dernier moment par la délégation américaine, et qui a provoqué le refus de signer
de la délégation yougoslave, qui était auparavant d’accord sur le volet civil) [14] .
Cependant, la Russie, bien que son opinion publique soit très critique à propos des
bombardements du « pays frère » durant 77 jours par l’OTAN, ne réagit pas militairement, et
il faudra attendre le « coup » de l’aéroport de Pristina, dans la nuit du 12 juin 1999, pour
qu’elle réapparaisse enfin au premier plan de l’actualité mondiale : un contingent russe
provenant de la SFOR en Bosnie-Herzégovine, traversait la frontière yougoslave au nez et à la
barbe des troupes de l’OTAN déployées tout autour du Kosovo, et occupait par surprise la
zone aéroportuaire de sa capitale Pristina, afin de préparer le terrain à l’arrivée de 2.500
parachutistes en provenance de Russie. Il prenait de vitesse, ainsi, les troupes d’assaut
américaines, françaises et britanniques occupées à déblayer péniblement les champs de mines
placés par les soldats yougoslaves avant leur départ sur toutes les voies d’accès au Kosovo
(excepté, curieusement, celle empruntée par les militaires russes!).
L’opinion mondiale se souviendra de l’énorme éclat de rire du président Boris Eltsine à la
télévision, ravi d’avoir joué « un bon tour » à l’OTAN et notamment aux généraux américains
qui la dirigent. Cependant, sur le plan diplomatique, ce « coup d’éclat » n’aura guère de
suites, puisque, contrairement à son attente, la Russie n’obtiendra pas de secteur propre
d’occupation au Kosovo, alors que cette « faveur » était accordée à des nations réputées
moins puissantes militairement, telles que l’Italie et l’Allemagne. Pour cette dernière, il
s’agissait d’un grand retour sur la scène internationale, puisque, pour la première fois depuis
le désastre de 1945, son armée participait pleinement à une opération internationale en dehors
de ses frontières.
Ce n’était pas la seule humiliation que subissait la Fédération de Russie en cette année de
1999, puisqu’aux cérémonies marquant le cinquantième anniversaire de l’OTAN; du 23 au 25
avril à Washington, tous les membres de la CEI, sauf la Russie, mais y compris la Biélorussie,
croyaient bon de répondre à l’invitation américaine. Bien plus, l’Azerbaïdjan du Président
Aliev se déclarait prêt à accepter des bases de l’OTAN, et la Géorgie, par la voix du Président
Chevarnadzé, déclarait que « l’OTAN n’est pas une organisation agressive, (mais) une force
réaliste qui peut établir la paix partout où cela est nécessaire » [15]. Rappelons que ces deux
chefs d’Etat sont d’anciens dirigeants de l’URSS, le Président Aliev étant même un ancien
cadre du KGB comme Vladimir Poutine.
Il est vrai que ces propos étaient tenus avant l’intervention de l’OTAN au Kosovo, ce qui en
diminue considérablement la portée, nous semble-t-il.

En Asie centrale, l’Ouzbékistan annonçait en avril 1999 son adhésion au GUAM, qui devenait
ainsi le GUUAM, alliance régionale formée par la Géorgie, l’Ukraine; et l’Azerbaïdjan en
1996, auxquels s’était jointe la Moldavie en 1997. Seules, apparemment, la Biélorussie et
l’Arménie résistaient aux « sirènes » occidentales, pour le moment du moins..
L’avènement de Vladimir Poutine : un tournant dans les relations russo-américaines?
Le 31 décembre1999, l’on sait que le Président Boris Eltsine, malade et vieillissant,
démissionnait et transmettait le pouvoir à son « dauphin désigné », Vladimir Poutine, élu
triomphalement à la présidence de la Fédération de Russie moins de trois mois plus tard.
Après son ascension fulgurante, le nouveau président, âgé de moins de 50 ans, sportif, et en
pleine santé, sera-t-il tenté de restaurer la puissance russe, et de devenir « Vladimir le Terrible
», ainsi que s’interroge Paul-Marie de la Gorce, en souvenir du tsar Ivan IV (1533-1584),
appelé le « Grand Rassembleur de la terre russe» par les historiens de ce pays [16] ?
Il est bien entendu trop tôt pour le dire, mais, dès sa première année à la tête du pays, son
empreinte personnelle a modifié sensiblement la politique étrangère de la Russie, notamment
vis-à-vis des Etats-Unis. Dès le 14 mars 2000, la secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères,
Madeleine Albright, lançait dans le Figaro un avertissement au nouveau maître de la Russie.
Tout en reconnaissant que la première impression était favorable (« quelqu’un de capable et
d’énergique, de franc et direct, ayant une bonne connaissance des dossiers et des choses
positives à dire sur les réformes économiques, l’état de droit et le contrôle des armements »),
elle déclarait : « Nous devons faire comprendre à la Russie que cette guerre (de Tchétchénie)
doit être réglée par voie politique et non militaire » [17] .
Mais, curieusement, lors de sa première rencontre avec Vladimir Poutine, le 2 février 2000, la
même Madeleine Albright, dans le communiqué commun publié à l’issue de l’entretien, ne
faisait aucune mention de la Tchétchénie, considérée comme une affaire interne (rappelons
que la Tchétchénie fait partie de la Fédération de Russie), mais traitait des menaces contre le
traité ABM et de l’élargissement de l’OTAN [18] .
Le Président Clinton allait dans le même sens, en déclarant « qu’il reconnaissait à la Russie le
droit de combattre le terrorisme, mais non de violer les Droits de l’Homme » [19]. Ce sont
d’autres pays occidentaux, et en premier lieu la France, qui seront partisans d’une politique
beaucoup plus interventionniste vis-à-vis de la Russie dans la campagne de Tchétchénie,
appuyés en cela par de nombreuses organisations non-gouvernementales (Human Rights
Watch, Médecins sans frontières, Médecins du monde etc.) ainsi que par les partis écologistes
des pays d’Europe occidentale. Peut-être les autorités américaines partageaient-elles le même
sentiment à propos de ce qui se passait en Tchétchénie, mais du moins restèrent-elles discrètes
sur le sujet, tant, pour elles, l’objectif primordial était d’arriver à un accord avec les Russes
sur le problème de la négociation globale de la réduction des armements - problème
planétaire, mettant en jeu peut-être l’avenir de l’espèce humaine, et non plus conflit ethnique
très localisé -.
Pourquoi « l’équilibre de la terreur», ainsi qu’on a pu l’appeler, était-il remis en cause? La
réponse tient en quelques mots : c’était le projet de système de défense anti-missiles (National
Defense Missile System) élaboré par le Pentagone, pour se protéger des nouvelles menaces
que représentent des Etats jugés imprévisibles ou agressifs, désignés du nom infâmant de «
rogue states », que l’on peut traduire par « Etats-voyous »[20], tels que la Corée du Nord, qui
dispose d’une industrie nucléaire, l’Irak, qui a réussi à enrichir l’uranium dans des
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%