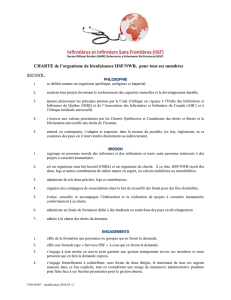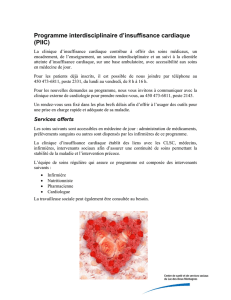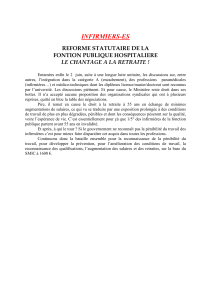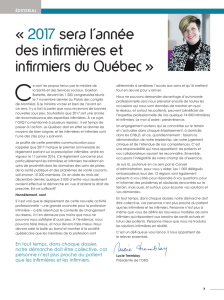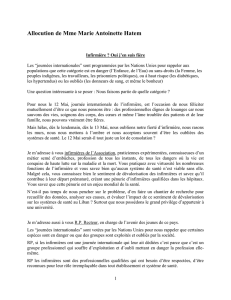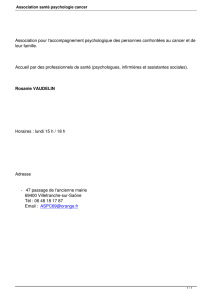Questions éthiques relatives à la composition

DÉONTOLOGIE pratique
POUR LES INFIRMIÈRES CANADIENNES
juin 1998 Numéro ISSN 1480-9990
QUESTIONS
ÉTHIQUES RELATIVES
ÀLACOMPOSITION
APPROPRIÉE DU
PERSONNEL
INTRODUCTION
Les récentes compressions budgétaires et les modifications du système de
soins de santé ont incité les établissements à remanier le personnel soignant
pour recourir à différentes catégories et compétences. En conséquence, les
infirmières* de tout le pays doivent relever de nouveaux défis. Il leur faut
assumer leurs responsabilités professionnelles et éthiques, et veiller à la
sécurité des clients malgré les mises à pied et la délégation des tâches infir-
mières à d’autres catégories de travailleurs de la santé. L’Association des
infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) a élaboré deux énoncés de poli-
tiques qui portent sur cette situation. Ce sont : Un soutien nécessaire pour
des soins infirmiers sécuritaires 1et Le personnel de santé non réglementé
assurant le soutien des soins infirmiers 2. Ces deux énoncés invitent les
infirmières à assumer le rôle qui leur revient pour garantir des soins sécuri-
taires et de qualité dans tous les milieux de pratique.
Les opinions sont partagées quant au bien-fondé des changements dans la
composition du personnel et de l’emploi de personnel de santé non régle-
menté.** L’objet du présent document, toutefois, n’est pas de se prononcer
en faveur ou contre l’utilisation d’une certaine catégorie de personnel soi-
gnant dans le système de soins de santé. Il démontre plutôt comment le
Code de déontologie des infirmières autorisées 3de l’AIIC peut aider les
infirmières à aborder des questions éthiques dans leur milieu de pratique,
qui découlent de changements dans la répartition et les attributions du per-
sonnel. Le code sera utile aux infirmières qui souhaitent s’assurer que leur
milieu clinique favorise l’emploi de la bonne catégorie de personnel, au
bon endroit, au bon moment et lui confie des responsabilités appropriées.
COMMENT LE CODE AIDE LES
INFIRMIÈRES
« Les infirmières peuvent s’inspirer du nouveau Code de déontologie des
infirmières autorisées pour prendre des décisions et exercer quotidienne-
ment dans le respect de l’éthique professionnelle lorsqu’elles auront à vivre
ce genre de tendances et de conditions. » (AIIC, 1997, p. 1-2) Comme on le
voit, le code aide les infirmières à aborder les questions éthiques concer-
nant l’emploi du personnel soignant approprié dans leur milieu de pratique.
Le code s’applique à toutes les infirmières, qu’elles exercent dans un milieu
de pratique clinique où elles délèguent les soins à d’autres catégories de
personnel soignant; dans l’enseignement où elles conçoivent des pro-
grammes de formation pour les aides; dans l’administration où elles doi-
vent prendre des décisions sur la répartition des ressources; dans la
recherche où elles élaborent des programmes pour évaluer le rendement, en
termes de coûts et de qualité, de différents éventails de compétences.
L’ORIENTATION PRÉCISE QUE PRO-
CURE LE CODEDEDÉONTOLOGIE
DES INFIRMIÈRES AUTORISÉES
Le code guide les infirmières sur deux aspects de la pratique infirmière
étroitement liés à la composition appropriée du personnel, qui consistent :
1) à donner des soins conformes à une pratique éthique, et 2) à exercer une
influence sur les politiques et à participer à leur élaboration, examen et
révision. Le code peut aider les infirmières qui travaillent avec le personnel
soignant de différentes catégories à donner des soins sécuritaires et
conformes à l’éthique, par la délégation appropriée des tâches et une super-
vision adéquate. Les mesures à prendre en cas d’incompétence ou de man-
quement aux règles de sécurité et de conduite sont précisées, et des sugges-
tions sont offertes pour l’application du code à des situations particulières.
Les infirmières qui souhaitent participer activement à l’élaboration des
politiques trouveront dans le code des conseils visant à l’instauration de
milieux de pratique propices à des soins sécuritaires et de qualité.
V
IOLATION DES RÈGLES D
’
ÉTHIQUE
Les conseils d’éthique que donne le code dans des situations où une action,
ou l’inaction, se traduirait par une violation des règles d’éthique, ont une
portée prescriptive. Ils renseignent l’infirmière et les autres personnes sur
ce qui est acceptable et sur ce qui ne l’est pas. Par exemple, une infirmière
de chevet peut devoir déléguer une tâche à du personnel soignant qui n’a
pas été formé pour remplir cette tâche. La valeur de Responsabilité consti-
tue une prescription dans cette situation. L’énoncé de responsabilités cor-
respondant à cette valeur veut que « Les infirmières... prennent des mesures
de prévention ainsi que des mesures correctives pour protéger les clients
contre des soins qui ne sont pas sécuritaires, compétents ou conformes à
l’éthique. » (AIIC, 1997, p. 19)
UNPROBLÈME ÉTHIQUE
Le code donne des conseils lorsque la situation engendre un problème
éthique et qu’il n’existe pas de réponse toute prête. Il faut réfléchir pour
pouvoir prendre une décision appropriée. Par exemple, l’infirmière admi-
nistratrice qui prend une décision sur l’intégration des aides dans une situa-
tion clinique donnée doit tenir compte de la réduction des ressources, des
compétences et des habiletés du personnel en place et la plus grande impor-
tance que revêt l’autonomie du client. L’énoncé de responsabilités qui
guide l’infirmière dans cette situation a trait à la valeur de Responsabilité :
« Qu’elles travaillent dans le domaine clinique, de l’administration, de la
recherche ou de la formation, les infirmières ont pour responsabilité profes-
sionnelle de garantir la qualité des soins prodigués par les gens de la pro-
*Dans ce document, infirmière signifie infirmière autorisée ou, au
Nouveau-Brunswick, infirmière immatriculée.
** Dans ce document, les travailleurs de la santé non réglementés sont
appelés aides).

fession. Cette responsabilité peut varier, mais elle a toujours pour fin ulti-
me la prestation de soins infirmiers sûrs, de qualité et conformes à
l’éthique. » (AIIC, 1997, p. 19)
UNE SITUATION DE DÉSARROI
ÉTHIQUE
Le code est moins impératif dans les cas de désarroi éthique où l’infirmiè-
re se sent compromise au point de vue éthique et où elle ressent de la cul-
pabilité et de l’anxiété. Cette situation peut survenir lorsque les attributions
des catégories de personnel sont modifiées et que les soins infirmiers sont
dispensés par un personnel soignant dont les compétences sont d’un autre
niveau. Le nombre d’infirmières est alors réduit pour chacun des postes et
la charge des infirmières s’en trouve augmentée car elles doivent assumer
la supervision d’un plus grand nombre de personnes qui donnent des soins.
Même si un niveau de sécurité minimum est maintenu dans les soins infir-
miers, l’infirmière peut ressentir un désarroi éthique; elle a moins de temps
à consacrer aux évaluations approfondies, à un enseignement adéquat et au
soutien des clients qui se traduiraient par une haute qualité des soins infir-
miers. L’énoncé des responsabilités de l’infirmière dans cette situation relè-
ve de la valeur des Milieux de pratique propices à des soins sécuritaires,
compétents et conformes à l’éthique. « Les infirmières exercent dans le
respect de l’éthique en s’efforçant de fournir les meilleurs soins possibles
étant donné les circonstances. Elles s’efforcent aussi, individuellement ou
en collaboration avec d’autres, d’améliorer les milieux de pratique en pre-
nant la défense de leurs clients chaque fois que c’est possible. » (AIIC,
1997, p. 23)
Par soins infirmiers de qualité,on entend des soins qui s’ap-
puient sur des bases théoriques et qui ont pour objet d’obtenir
chez le client des résultats mesurables. Ils s’inscrivent dans le
cadre de la démarche infirmière, qui comprend l’évaluation du
client,la définition du problème, la planification des soins, l’in-
tervention et son évaluation des soins. (AIIC,1995).
QUI D’AUTRE PEUT AIDER LES
INFIRMIÈRES
Les associations provinciales d’infirmières et les organismes de réglemen-
tation de la profession aident grandement les infirmières et les personnes
qui prennent des décisions sur la répartition des ressources humaines, y
compris sur les différents rôles que peut assumer le personnel soignant
pour satisfaire les besoins d’une variété de clients. Ils peuvent aussi réali-
ser des programmes pour aider les organismes à examiner les décisions qui
ont des répercussions sur les milieux de pratique. Pour s’assurer que les
soins aux clients sont sécuritaires, nombre d’organisations ont élaboré des
guides pour la prise de décisions qui décrivent les démarches pour évaluer
le niveau de soins le plus approprié dans une situation de soins de santé
donnée. Les syndicats d’infirmières jouent un rôle essentiel en plus de ser-
vir de ressources aux infirmières de chevet et de faire la liaison pour trans-
mettre aux décisionnaires les préoccupations de leurs membres ayant trait à
une dotation en personnel conforme à la sécurité.
Les normes d’exercice de la profession infirmière guident les infirmières
dans leur pratique. Celles-ci peuvent aussi recourir à une procédure de
documentation, par l’entremise de leur association professionnelle ou de
leur syndicat, qui les aide à garantir la sécurité et la qualité des soins. La
capacité d’étayer sur des documents leurs préoccupations concernant la
qualité et la sécurité des soins est une compétence que doivent maîtriser
toutes les infirmières autorisées. Le fait de réunir de la documentation sur
ces préoccupations protège le bien-être du client et réduit la responsabilité
professionnelle et légale de l’infirmière.
Les infirmières aux prises avec des questions relatives à la sécurité et à la
qualité des soins ne se préoccupent pas uniquement de leurs responsabilités
professionnelles et déontologiques, elles s’inquiètent aussi des enjeux juri-
diques. Pour obtenir des services dans ce domaine, elles peuvent s’adresser
à la Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada (SPIIC),
en composant le 1-800-267-3390.*** Les infirmières peuvent aussi discu-
ter de leurs préoccupations ayant trait à la responsabilité légale avec les
services juridiques de leur association professionnelle. 4
EXEMPLES TIRÉS DE LA
PRATIQUE
Les exemples suivants illustrent l’usage que l’on peut faire du Code de
déontologie des infirmières autorisées et d’autres sources de renseigne-
ments. Nous présentons deux situations dans lesquelles les infirmières, de
leur propre chef ou en groupe, sont intervenues pour favoriser des soins
compétents, sécuritaires et éthiques. L’infirmière qui étudie ces cas trouve-
rait utile de consulter le guide d’étude du code intitulé Déontologie quoti-
dienne : Le Code mis en pratique 5, pour obtenir des renseignements com-
plémentaires qui aideront à mieux aborder ces situations.
1ER CAS :TRAVAILLER ENSEMBLE À
DESSOINS DE QUALITÉ
Le cas sera examiné à la lumière des « Mesures à prendre en cas d’incom-
pétence ou de manquement aux règles de sécurité et d’éthique » que vous
trouverez à la page 26 du code.
• • • • •
Dans le cadre de la restructuration des services d’un grand centre de soins
tertiaires, un modèle de soins propose de faire appel à des aides-infir-
mières. On prévoit que leur rôle sera d’assister au soin des clients en
accomplissant des tâches déléguées par des infirmières autorisées et de tra-
vailler sous leur surveillance dans tous les domaines cliniques. Les infir-
mières auxiliaires autorisées ne feront plus partie de l’équipe soignante.
Des exemples de fonctions dont devront s’acquitter les aides sont : donner
les bains, faire les lits, prendre les signes vitaux et changer des pansements
simples. On recrutera les aides auprès du personnel domestique, des por-
teurs et des préposés aux soins. Ils recevront une formation sur le tas de
quatre semaines.
La restructuration portera le ratio clients-infirmière de 5:1 à 8-10:1 dans les
salles et de 1-2:1 à 3:1 dans les unités de soins de phase aiguë. Toutes les
infirmières auxiliaires et un grand nombre d’infirmières autorisées perdront
leur emploi à la suite du remaniement.
Les infirmières de l’hôpital sont perturbées par ces changements et elles
sont mécontentes. La sécurité d’emploi entre certes en ligne de compte.
Mais il y a plus. Elles sont aussi préoccupées par le maintien de la sécurité
et de la qualité des soins. Les représentants syndicaux locaux ont organisé
une réunion de toutes les infirmières pour discuter des mesures à prendre
dans cette situation.
La première mesure consiste à « obtenir tous les détails voulus sur la
situation et peser les risques » associés aux changements d’effectifs propo-
sés. Les infirmières sont au courant de la situation financière difficile de
l’hôpital. Elles savent qu’il faut plus qu’une simple suppression de lits
pour équilibrer le budget. Les consultants américains à qui on a fait appel
pour aider au remaniement ont recommandé une approche de « soins axés
*** Les infirmières membres d’associations qui se prévalent des services
offerts par la SPIIC peuvent obtenir une protection responsabilité pro-
fessionnelle pour des cas qui ont trait aux services infirmiers. Les
membres de la Registered Nurses Association of British Columbia
(RNABC) sont couverts par la RNABC Captive Insurance
Corporation, qu’elles peuvent joindre en composant le
1-800-565-6505.

sur le client », que l’hôpital a adoptée. Les infirmières décident donc de
faire des lectures sur l’utilisation des aides dans les grands hôpitaux améri-
cains et de se familiariser avec la documentation qui préconise le recours
aux infirmières autorisées pour donner des soins sécuritaires de qualité aux
clients. 6
On a déterminé que la question primordiale ici était la sécurité des clients.
Les infirmières craignent que l’utilisation d’aides ne garantisse pas des
soins sécuritaires. Elles appréhendent d’être tenues responsables pour des
soins sur lesquels elles n’ont aucun contrôle. Elles savent trop bien que la
clientèle de l’hôpital se compose de plus en plus de grands malades qui
requièrent des soins complexes. Elles redoutent donc leur éloignement du
chevet du client où elles seront remplacées par des aides pour des périodes
plus étendues, et l’atteinte à la sécurité et à la qualité des soins infirmiers
qui en résultera.
Les infirmières doivent ensuite « vérifier les lois, politiques, directives et
procédures en vigueur » associées à la question du changement de l’éven-
tail de compétences que l’hôpital propose. Un document qu’elles trouvent
particulièrement utile est le guide de leur association professionnelle qui
détermine la catégorie appropriée de personnel soignant dans une gamme
de complexité de soins aux patients et une variété de milieux de pratique.
À l’aide de cette documentation, elles déterminent les aspects des soins
que les aides peuvent donner aux patients dont l’état est stable.
La consultation de la documentation à leur disposition en vertu de leur
convention collective permet aux infirmières de se familiariser avec les
procédures nécessaires pour rapporter et documenter des situations de soins
aux clients qui ne sont pas sécuritaires. De nombreuses infirmières sont
surprises d’apprendre qu’elles ont l’obligation de rapporter ces cas à l’au-
torité compétente en vertu de la disposition sur la responsabilité profes-
sionnelle de leur convention collective.
La troisième étape consiste à « consulter, au besoin, des collègues,
d’autres membres de l’équipe [de soins de santé], et l’association profes-
sionnelle d’infirmières de leur province. » Les infirmières consultent leur
association professionnelle et leurs représentants syndicaux qui les
conseillent sur la meilleure méthode d’exprimer leurs préoccupations aux
infirmières gestionnaires de l’établissement. Les infirmières consultent
ensuite leurs infirmières gestionnaires pour qu’elles les aident à transmettre
leurs préoccupations aux décisionnaires de l’établissement. Les infirmières
gestionnaires organisent un forum pour que les infirmières aient la possibi-
lité d’exprimer leurs inquiétudes et pour leur fournir des éclaircissements
sur les changements proposés. Après avoir résumé et documenté les préoc-
cupations des infirmières, les infirmières gestionnaires ont décidé de faire
un exposé aux gestionnaires de l’échelon suivant.
Les infirmières gestionnaires se sont ainsi attachées à « essayer de régler
le problème de la façon la plus directe possible et en veillant à l’intérêt de
tous les intéressés. » Après de considérables délibérations, l’hôpital a déci-
dé d’employer des aides selon le nouvel éventail de compétences prévu
dans le cadre du nouveau modèle de soins. Il a toutefois été entendu que
les aides ne travailleraient pas dans les unités de soins intensifs. La prise
des signes vitaux et le changement des pansements seraient éliminés de
leurs fonctions.
Les infirmières de chevet ont pris des mesures pour « tenir les intéressés
informés des points non résolus...», en particulier la préparation adéquate
des aides et des infirmières pour les aider à assumer leurs nouvelles res-
ponsabilités. Les infirmières, par l’entremise des conseils de leurs unités,
ont fait part aux infirmières monitrices et aux infirmières gestionnaires de
leurs besoins de formation en cours d’emploi pour endosser leur nouveau
rôle et assumer leurs responsabilités de délégation de tâches et de supervi-
sion des aides. Les infirmières ont aussi demandé qu’une procédure d’éva-
luation soit instaurée pour estimer l’emploi des aides en termes de coût-
efficacité, des résultats cliniques et de la satisfaction des clients et des
employés. On a déterminé que cette question devait être classée comme
une priorité de l’hôpital et du comité d’assurance de la qualité des unités,
et qu’ils devaient l’examiner.
2ECAS :LES GESTES PERSONNELS
POUR ASSURER DES SOINS SÉCURI-
TAIRES
La présentation du cas suivant fait appel au Modèle circulaire de décisions
éthiques élaboré par Janet Storch en 1992 (Voir figure). Ce modèle est
utile dans les situations éthiques qui comportent plusieurs « étapes » de
prise de décisions. Chaque décision peut devoir être examinée à la lumière
des décisions antérieures. Les questions éthiques sont observées à travers
une « lentille » qui permet de discerner les aspects personnels, profession-
nels, sociaux, éthiques et juridiques de la décision à prendre. Une descrip-
tion plus détaillée du modèle est donnée dans Déontologie quotidienne : Le
Code mis en pratique.• • • • •
Rita est infirmière gestionnaire dans un établissement de soins de longue
durée. Ces dernières années, les pensionnaires sont plus âgés et plus frêles.
Actuellement, de nombreux résidents ont besoin de traitements médicaux
tels qu’une thérapie intraveineuse, un cathéter urinaire et un respirateur.
L’éventail actuel de personnel dans l’établissement comprend des infir-
mières autorisées, des infirmières auxiliaires autorisées et des aides-infir-
mières. Cet arrangement donne de bons résultats au chapitre de la sécurité
et de la qualité des soins. Le directeur de l’établissement a demandé à Rita
d’examiner la possibilité de modifier l’éventail des compétences pour
réduire les coûts. Il a suggéré que les aides-infirmières soient formées pour
s’acquitter de fonctions additionnelles, incluant l’administration des médi-
caments aux pensionnaires dont l’état est stable. Une fois que les aides
auront été formées, elles remplaceront les infirmières auxiliaires autorisées.
Rita est consciente du besoin d’épargner, mais elle ne se sent pas capable,
au chapitre de l’éthique, d’accepter la proposition du directeur.
1. Information et identification
Le problème. Rita essaie d’éclaircir le dilemme en établissant les faits.
Elle convient que la situation financière est déplorable. Pour que l’établis-
sement continue de fonctionner sans augmenter la charge financière des
pensionnaires, il faut effectuer des compressions budgétaires. Rita recon-
naît que les changements proposés par le directeur réduiraient les coûts des
soins, mais elle se demande quels effets ils auraient sur la qualité des soins
aux pensionnaires et sur la qualité de la vie au travail des employés.
Les personnes. Les personnes touchées par cette décision comprennent les
employés, les pensionnaires et la direction de l’établissement, et les
familles des pensionnaires.
Les composantes éthiques. Les composantes éthiques de la situation
incluent : 1) le risque de ne pas maintenir la sécurité et la qualité des soins
aux clients; 2) l’absence de consultation des pensionnaires et de leurs
familles sur le nouvel éventail de compétences proposé; 3) la position diffi-
cile des aides-infirmières qui doivent assumer des responsabilités pour les-
quelles elles ne sont peut-être pas formées.
2. Clarification et évaluation
Rita réfléchit aux principes éthiques d’autonomie, de bienfaisance, de non-
malfaisance et de justice pour l’aider à déterminer les enjeux éthiques. Elle
juge que l’autonomie est une question qui concerne les pensionnaires et
leurs familles. Ils ne sont peut-être pas tout à fait au courant de la portée de
la décision qui modifiera la répartition des employés et l’attribution de cer-
taines tâches, et ils n’ont pas participé à la prise de décisions. Elle pense
aussi à l’autonomie des infirmières, à la préoccupation qu’elles ont de don-
ner des soins de qualité aux pensionnaires, et à la relation fondée sur la
confiance qu’elles ont tissée avec eux. En examinant la bienfaisance et la
non-malfaisance, Rita soupèse les risques qu’encourent les pensionnaires,
et l’engagement des employés à travailler pour le bien des pensionnaires.
Le principe de justice est aussi pertinent car l’enjeu porte uniquement sur
l’attribution de ressources adéquates pour garantir la sécurité et la qualité
des soins infirmiers.

Attentes sociales. Rita doit considérer la confiance des pensionnaires et de
leurs familles qui s’attendent qu’elle-même et l’établissement dispensent des
soins de qualité qui sont sécuritaires. Les pensionnaires et leurs familles se
sont dits inquiets de la complexité grandissante des soins requis par les
clients. On s’attend en outre que les familles dispensent de plus en plus de
soins infirmiers informels. Le personnel infirmier de l’établissement commen-
ce tout juste à s’habituer au modèle courant de soins. De nombreuses infir-
mières ont exprimé leur insatisfaction au sujet d’une décision antérieure qui a
permis aux infirmières auxiliaires autorisées d’administrer les médicaments.
Exigences juridiques. L’infirmière autorisée est responsable, en droit, des
soins infirmiers dispensés. Rita reconnaît que, si le travailleur a les compé-
tences nécessaires (connaissances, habiletés, jugement et attitude) de prodi-
guer des soins sécuritaires et rentables, les employés qui relèvent de son
autorité n’ont pa de quoi s’inquiéter. En examinant l’aspect légal de la
situation, elle n’est pas gênée par certaines tâches que le directeur souhaite
confier aux aides, tandis qu’elle se fait du souci pour d’autres.
Un certain nombre de normes de pratique professionnelle ont une influence
sur la décision de Rita. Elle revoit le Code de déontologie des infirmières
autorisées qui déclare que : « Les infirmières gestionnaires interviennent ...
pour prévenir les dommages ultérieurs lorsque la sécurité du client est mise
en péril par un manque de ressources...» (AIIC, 1997, p. 27) Les valeurs du
code appuient les actions de Rita en ce qui a trait à la Santé et au bien-être, au
Choix, à l’Équité, à la Responsabilité et aux Milieux de pratiques propices à
des soins sécuritaires, compétents et conformes à l’éthique.
D’autres normes de pratique professionnelle que Rita peut consulter sont
les normes provinciales de pratique infirmière et les lignes directrices de
son association provinciale d’infirmières qui déterminent le niveau appro-
prié de compétences du personnel soignant dans des situations cliniques
précises, pour des clients donnés.
Conflit de valeurs. Les valeurs de Rita et celles des employés et du direc-
teur sont en conflit. Rita est certaine que les valeurs des infirmières de
l’établissement, et celles de la plupart des pensionnaires et de leurs
familles, sont semblables aux siennes. Tous souhaitent le maintien de la
qualité et de la sécurité des soins. Par contre, elle croit que la priorité du
directeur est de fournir des soins au plus bas prix. Elle se demande si elle
pourra discuter avec lui de ce conflit afin qu’ils puissent en arriver à une
compréhension de leurs valeurs réciproques pour résoudre le problème.
Rita envisage quatre options pour résoudre son problème : 1) Elle peut pré-
senter son problème au directeur; 2) Elle peut faire un exposé au Conseil
d’administration sur les soins de qualité et sécuritaires en espérant influen-
cer leur décision; 3) Elle peut trouver des solutions de rechange pour rédui-
re les coûts et les présenter au directeur et au Conseil d’administration; 4)
Elle peut démissionner.
3. Action et revue
Rita décide que son premier geste doit être d’exprimer ses préoccupations
au directeur. Malgré sa conviction que la seule solution possible est la sien-
ne, il écoute Rita lui exposer clairement ses inquiétudes. Bien qu’il ne soit
pas prêt à modifier sa proposition, il accepte toutefois d’y intégrer les pré-
occupations de Rita lorsqu’il fera un exposé au Conseil d’administration. Il
les présentera comme « des défis devant être relevés ». À la prochaine
réunion du Conseil, le directeur expose les difficultés financières de l’éta-
blissement et les changements qu’il propose à la répartition du personnel
pour y remédier. Rita donne une vue d’ensemble des exigences accrues des
soins aux pensionnaires. Elle présente les rôles et responsabilités du per-
sonnel soignant, et ses inquiétudes face aux répercussions possibles des
changements proposés sur la capacité de l’établissement de dispenser des
soins sécuritaires. Pour tenir compte des préoccupations de Rita, le Conseil
accepte d’examiner des solutions de rechange visant la réduction des coûts
avant de modifier la répartition du personnel et les responsabilités. Rita est
consciente qu’il ne s’agit que d’un report temporaire des compressions
budgétaires. Elle se réunit avec le personnel infirmier, puis avec le Conseil
des pensionnaires pour discuter du besoin de réduire les coûts et trouver
des solutions de rechange. Elle présente ensuite ses propositions au direc-
teur et elle est consciente que la décision peut encore être influencée.
Déontologie pratique est publié par la Division des politiques, de la
réglementation et de la recherche de l’Association des infirmières
et infirmiers du Canada (AIIC).
Tous les membres de l’AIIC peuvent obtenir un exemplaire gratuit
de cette publication. Pour renseignements ou pour obtenir d’autres
exemplaires, prière de communiquer avec les Publications de
l’AIIC.
Pour renseignements additionnels, communiquer par la poste, télé-
copieur ou courrier électronique :
Association des infirmières et infirmiers du Canada
50 Driveway, Ottawa (Ontario)
Canada K2P 1E2
Téléc. : (613) 237-3520
Téléphone : 1-800-361-8404 ou (613) 237-2133
Courriel : [email protected]
Site web : www.cna-nurses.ca
ISSN 1480-9990
CONCLUSION
Ce document porte sur une question avec laquelle nombre d’infirmières
canadiennes sont aux prises, les milieux de pratique pouvant ne pas avoir
l’éventail approprié de personnel soignant pour dispenser des soins de qua-
lité et sécuritaires. Les cas cités démontrent comment le Code de déontolo-
gie des infirmières autorisées et un modèle de prise de décisions éthiques
aident les infirmières à aborder de difficiles problèmes dans des situations
de pratique. Les cas décrivent les gestes que peuvent poser les infirmières
lorsqu’elles croient que les décisions relatives à la répartition du personnel
et à l’attribution des responsabilités sont inappropriées. Il est important
qu’elles reconnaissent le rôle que leurs associations professionnelles, leurs
syndicats et l’AIIC peuvent jouer pour traiter des questions liées à l’emploi
de différentes catégories de personnel soignant. En outre, les infirmières
doivent toujours garder à l’esprit que le Code de déontologie des infir-
mières autorisées leur donne le pouvoir et la responsabilité de favoriser et
d’assurer le maintien de soins de qualité et sécuritaires.
RÉFÉRENCES
1. Association des infirmières et infirmiers du Canada (1996). Énoncé de
politique : Un soutien nécessaire pour des soins infirmiers sécuritaires.
Ottawa : AIIC.
2. Association des infirmières et infirmiers du Canada (1995). Énoncé de
politique : Le personnel de santé non réglementé assurant le soutien des
soins infirmiers. Ottawa : AIIC.
3. Association des infirmières canadiennes (1997). Code de déontologie
des infirmières autorisées. Ottawa : AIIC.
4. P. McLean (1995). « Reduced resources and liability risks ». The
Canadian Nurse/L’infirmière canadienne, 91 (10), p. 51-52; B. Sibbald
(1997). « Delegating away patient safety ». The Canadian
Nurse/L’infirmière canadienne, 93 (2), p. 22-26.
5. Association des infirmières et infirmiers du Canada (1998). Déontologie
quotidienne : Le Code mis en pratique. Ottawa : AIIC.
6. S.E. Melberg (1997). « Effects of changing skill mix ». Nursing
Management, 28 (11), p. 47- 48; E.C. Murphy, S. Ruch, J. Pepicello et M.
Murphy (1997). « Managing an increasingly complex system ». Nursing
Management, 28 (10), p. 33-36; J. Shamian et B. Chalmers (1996). Nurse
effectiveness: health and cost-effective nursing services. Toronto: WHO
Collaborating Centre/Mount Sinai Hospital.
1
/
4
100%