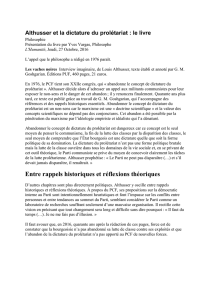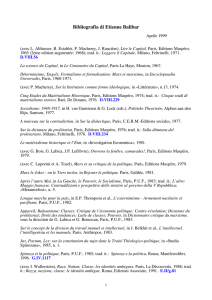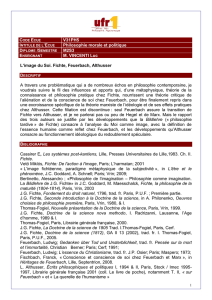Mon univers de pensée est aboli. Je ne puis plus penser

Jean Guitton
suis-je semblable à cet homme dont parlait
Oscar Wilde et qui, à force d'enseigner la par-
faite connaissance de Dieu, avait perdu le par-
fait amour deDieu. Hélas Je n'ai certainement
pas une parfaite connaissance de Dieu, mais j'ai
souvent eu l'impression de faire celui qui avait
la parfaite connaissance de Dieu, mais qui en
avait perdu l'amourje pense que l'apostolat est
très beau, mais il demande, du moins chez
nous, une certaine mise en scène... f ai souvent
ressenti ce malaise quand j'allais inscrire au
tableau les
annonces de nos réunions. Alors,
j'aurais cent fois voulu être dans une Trappe,
inconnu, ignoré de tous
les regards, etseul avec
le silence et le parfait amour de Dieu. Je vous
avoue que c'estlàpourmoi un
cas de conscience
très grave... Je suis resté dans la nuit pour vous
écrire
et pour vous dire très simplement
ce qui
m'a longtemps et sourdement torturé cette
année... Et c'est à vous que je pense, qui m'avez
donné la si grande joie de savoir que plus que
jamais je vous aimais et f allais revenir plus
pur
vers le Christ. »
En juillet 1972, Althusser m'avait écrit une
longue lettre où il retraçait l'origine de notre
amitié :
« Cher Jean G., vous auriez dû m'appe-
ler
au temps
de votre solitude à l'hôpital.
Je
serais venu : vous êtes quelqu'un que je n'ou-
blie pas.
Pourquoi vous
pouvez tenir à
moi
?Je
ne sais. Pourquoi je puis tenir à vous :je crois le
savoir. Quand je suis arrivé à Lyon, en 1936, en
khâgne, je n'étais rien et je le savais : un voya-
geur sans bagages, un adolescent sans passé, un
étudiant sans culture. Mes grands-parents
étaient des paysans pauvres du Morvan : le
grand-père était parti sous Jules Feriy, comme
garde forestier dans les bois les plus sauvages
d'Algérie. Mes parents issus d'eux ont fait ce
qu'ils ont pu. Ma mère avait été institutrice six
mois, avant son mariage. Mon père, parti de
rien à treize ans travaillait dans une banque.
Ma mère nous fit, croyant bien faire, donner, à
ma soeur et à moi, des leçons de piano et violon,
et nous emmenait tous les dimanches aux
"Concerts classiques". Ça ne "passait" pas. Je
n'étais pas un 'héritier». En classe j'étais sou-
vent le premier ruais je n'y croyais pas, du toc !
A Lyon, je vous ai rencontré, et il s'est passé
quelque chose de singulier; une vraie rencon-
tre. Vous ne m'avez pas appris grand-chose (n'y
voyez nul reproche. J. Lacroix m'a encore
moins appris que vous et pour une raison
profonde : je n'ai jamais rien pu apprendre, je
n'ai jamais
rien su, j'en suis toujours là), mais
vous m'avez donné "les clés". Vous m'avez
appris à entrer en rapports avec un concept,
avec deux, à les combiner, les opposer'
, les unir,
les disjoindre, à
lesretourner comme
crêpes sur
poêle, et à les "servir", pour qu'ils soient comes-
tibles.
Ce/a, je
l'ai compris, à ma manière sûre-
ment, mais compris, car reconnu.11 y avait du
"jeu"dans
votre art, et c'es tsans doute pour
cela
que j'y ai reconnu quelque chose comme mon
bien à moi : une sorte de travail artisanal de la
matière-pensée avec des outils forgés à la main
— un traitementtout proche de celui que j'avais
appris de mon grand-père dans ses champs et
ses bois du Morvan quand il travaillait sa
matière-matière. Vous confirmiez et renforciez
en moi quelque chose comme une vieille ten-
dance matérialiste, issue de mes origines et de
mes rapports antérieurs au monde de la "cultu-
re", ma certitude pratique et mon salut. C'était
alors certitude et salut. Depuis, le salut est entré
dans l'évidence.
[...] »
Une autre lettre datant de 1974:
« [...]
Vous
dites que nos "pensées" sont
du tout au tout opposées, ce qui peut les unir,
mais que vous montrez du doute quand vous
énoncez les vôtres, moi pas — ce qui nous sé-
pare. Cela tient peut-être l'idée que ndus nous
faisons du "théâtre". C'est de bonne gûerre de
dire que je suis "dogmatique" : je laiee dire.
J'observe seulement que les philosophies qui
ont eu dans l'histoire le plus d'effets, cènes de
Spinoza, de Hegel, par exemple, étaient "dog-
matiques". Les "critiques" en ont eu moins
(sauf dans la tradition philosophique, qu'elles
ont gavées de leurs commentaires) : j'entends
des effets hors de la philosophie. Je crois que
« Mon univers
de pensée est
aboli.
Je ne puis
plus penser » •
c'est se faire une idée assez singulière de la
philosophie que de
vouloiryinscrire
la critique
ou le doute : il me semble qu'il n'y a que Dieu
(supposé que ce mot ait un sens), s'il parlait, qui
pourrait embrasser dans le "vrai" qu'il dirait
l'hypothèse de la "fausseté" de ses propos.
"Vous savez, je peux me tromper", ça ne peut
s'inscrire que
dans une philosophie de Dieu.
[...] Vous pouvez en conclure que je suis incoer-
ciblement
spinoziste, et vous aurez raison.
Je
sais vraiment très peu de chose en philosophie,
mais je crois du moins avoir compris, et
assez
bien compris que Spinoza est vraiment, de tous,
et sans comparaison, le plus
grand. »
En 1978, Louis fut soigné dans une clinique
psychiatrique du Vésinet. Je passais de longues
heures avec lui. Il était alors dans une sorte
d'angoisse métaphysique. Il guérit.
En 1980, il m'invita à déjeuner à l'Ecole
normale chez lui. Il avait le sentiment que
l'humanité allait entrer dans une crise sans
précédent. Je vis Hélène seule, elle me raconta
sa vie d'ouvrière pauvre. Elle me disait que les
catholiques comme les communistes demeu-
raient des
bourgeois,
n'allant jamais jusqu'au
don total d'eux-mêmes. Hélène et Louis
s'étaient unis pour se consacrer à l'Absolu,
abandonnant tout désir de carrière, tout hon-
neur humain. Ils étaient entrés en relations
étroites avec les Petites Sœurs du père de Fou-
cauld, qui avaient une maison à côté de l'Ecole
normale.
Un de nos derniers entretiens fut dramati-
que. Il vint chez moi avec Hélène pour me dire
qu'ils avaient tous deux l'impression que l'hu-
manité allait entrer dans une phase définitive,
qu'ils ne voyaient qu'un seul lieu où cette crise
pourrait se dénouer : ce lieu était Moscou ;
mais, au-delà de Moscou c'était Rome. Autre-
ment dit, ilsvoyaient le saint du monde dans un
entretien entre Rome et Moscou. Et Althusser
me demanda d'aller trouver Jean-Paul II pour
lui dire : «
Soyez cet homme qui franchit les
barrières ultimes, car vous
avez seul en ce
moment une autorité morale sur l'humanité. »
Althusser vint à Rome, où il eut un entretien
de plusieurs heures avec le cardinal Garrone,
auquel je l'avais recommandé. Celui-ci fit un
rapport à Jean-Paul II pour demander au pape
de recevoir Althusser. Je vis moi-même le
Saint-Père et il me dit : «
Je connais votre ami;
c'estavant tout un logicien qui va jusqu'au bout
de ses pensées. Volontiers je le recevrai. »
Le drame intervint le mois suivant. Je fis des
démarches, aidé par Bernard Billaud, directeur
de cabinet de Jacques Chirac à la mairie de
Paris, pour qu'Althusser, qui avait été soustrait
à la justice, étant considéré comme irresponsa-
ble, puisse obtenir de quitter l'hôpital Sainte-
Anne et être admis dans une clinique des envi-
rons de Paris. C'est ainsi qu'il fut soigné à
Sainte-Anne d'abord, puis dans une clinique
des environs de Paris appelée « les Eauxvives ».
Il m'avait écrit le 3 décembre 1978:
« Mon univers de pensée est aboli Je ne
puis plus penser. Pour parler le langage tala (1),
je vous demande votre prière. f...] »
Le médecin de Sainte-Anne devait me dire
que c'était par un délire d'amour qu'il avait été
entraîné à tuer celle qu'il aimait.
Y a-t-il d'ailleurs une si grande distance entre
un criminel et un saint ? François Mauriac et
Paul Claudel ne le pensaient pas. Il y a des
criminels qui sont des saints en puissance,
comme le bon larron. Il y a aussi des saints qui
savent que sans la grâce ils auraient pu devenir
des criminels. Thérèse de l'Enfant-Jésus était
de cet avis, et elle ne se jugeait pas différente de
l'assassin Pranzini qu'elle avait accompagné
en pensée à la guillo
tine.
Dans un de nos derniers entretiens, Althus-
ser me dit : «
Ecrivez l'histoire de votre vie.
Moi, j'ai écrit
deux cents
pages qui sont l'his-
toire de mes traumatismes épouvantables. »
me dit encore : « Je n'ai jamais
pu atteindre la
transparence. Alors j'ai pratiqué, comme Mal-
larmé, comme Alain, comme Heidegger,
robs-
curum per obscurius,
c'est-à-dire l'obscur à
travers le plus obscur. » ,
G.
(1) Allusion à l'époque où les étudiants catholiques
étaient appelés par les autres les «
talas »
(ceux qui vont
à la messe),
©
Robert
Laffon4
1988.
- 23-29 SEPTEMBRE 1988/121
1
/
1
100%