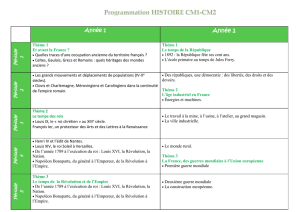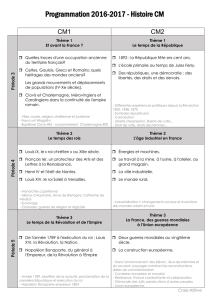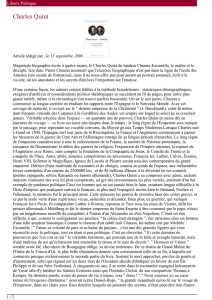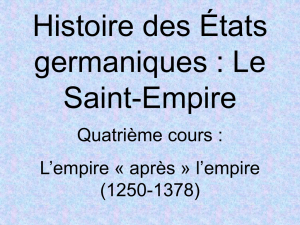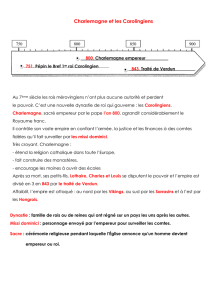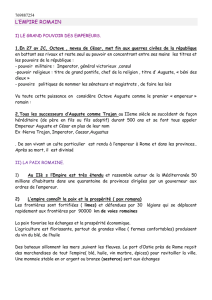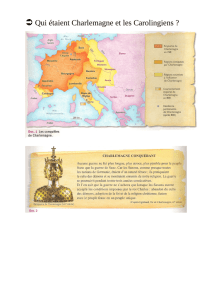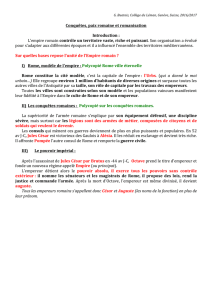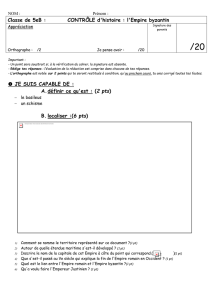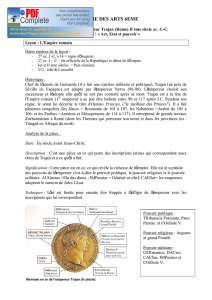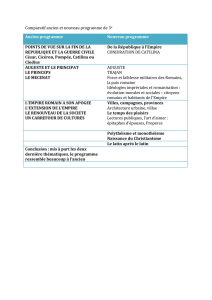Notes du cours

Histoire des États germaniques :
Le Saint-Empire
Quatrième cours :
L’empire « après » l’empire (1250-1378)
1 – Le point sur la situation en 1250
— La dynastie des Hohenstaufen ne s’éteint pas avec Frédéric II : en 1250, à la mort de ce denier, son fils
Conrad VI lui succéda, mais visiblement il n’eut pas envie de poursuivre la lutte contre la papauté. Il quitta
dès 1252 le territoire de l’Allemagne pour la Sicile, où il mourut deux ans plus tard.
— Un autre fils de Frédéric II fut ensuite couronné en 1258 roi de Sicile, mais il fut battu par Charles
d’Anjou en 1266, lequel s’empara du même souffle de la couronne sicilienne. Lorsque Conradin, petit-fils de
Frédéric II, qui avait tenté de reprendre la Sicile aux puissantes forces angevines, fut décapité sur ordre de
Charles en octobre 1268, la lignée dynastique directe des Hohenstaufen s’éteignit. À la grande joie de la
papauté.
— Avec l’extinction de cette troisième dynastie à être passée sur le trône impérial depuis la restauration
ottonienne du Xe siècle, c’est une page de l’histoire de l’empire, et avec elle de l’histoire germanique, qui est
tournée.
— Certes, l’empire ne disparait pas et survivra nominalement plus de 500 ans à la mort du dernier
Hohenstaufen. Mais il y a bien quelque chose de changé à partir de 1250 : plus aucun empereur ne disposera
d’un pouvoir comparable à ceux qui se succédèrent sur le trône de Charlemagne entre 938 et 1250. Et ce,
même si, comme on l’a vu, le pouvoir réel dont disposèrent ces hommes fut très variable d’un règne à l’autre.
— Pendant que, au cours de ces quelque 300 ans en Europe, plusieurs États sont parvenus à se consolider,
l’Empire n’y est pas parvenu, et ce n’est pas faute d’avoir essayé. Il convient de s’interroger sur les raisons de
cet échec.
— L’une des raisons les plus fréquemment évoquées dans l’historiographie traditionnelle tient à la
contingence et au hasard : la courte durée des lignées dynastiques. C’est en effet un élément important, car
dans une monarchie héréditaire, la continuité est une donnée fondamentale. D’abord sur le plan pratique, car
la passation du pouvoir de père en fils, en ligne directe, permet généralement d’éviter les guerres de
succession.
— D’autre part, la continuité dynastique permet aussi, souvent, la continuité des principes politiques qui
régissent la construction étatique. C’est le cas, par exemple, de la branche des Danilovitch qui régnèrent sur la
Moscovie pendant plus de 300 ans.
— À cet aspect pratique, il convient d’ajouter le caractère symbolique de la fonction royale : prétendant tenir
son pouvoir de Dieu, un roi assoie plus facilement sa légitimité par la voie héréditaire que par la voie
électorale, qui fait dépendre ce pouvoir d’une décision humaine.
— De sorte que, en effet, la succession de trois dynasties (plus un Welf) en trois siècles n’a pas permis aux
empereurs de consolider leur pouvoir, car chaque siècle, environ, il fallut recommencer la construction de la
légitimité, et ce, souvent après une période de forte contestation.
— La comparaison avec la France met en évidence ce rôle de la contingence : arrivé sur le trône par l’élection
d’Hugues Capet en 987, la dynastie capétienne profitera d’une continuité dynastique remarquable : d’Hugues
(987) à Jean le Posthume (1316), la règle de primogéniture mâle peut s’appliquer parfaitement.
— Plus de 300 ans ont ainsi permis à la dynastie capétienne de construire un pouvoir politique qui, bien qu’il
chancela à l’extinction des Capétiens directs, disposera de fondation assez solide pour qu’après la crise de

2
succession, le processus de consolidation étatique puisse reprendre. Ottoniens, Saliens et Hohenstaufen n’ont
pas disposé de ce délai.
— Cela étant, l’Angleterre n’a pas non plus été aussi choyée que la France dans le domaine, les Plantagenets
directs n’ayant disposé que d’un siècle et demi. Pourtant, et même si ici aussi les successions entraineront des
guerres, l’État anglais, puis britannique, poursuivra sa consolidation. De sorte que, aussi valable qu’elle soit,
cette explication ne peut rendre compte à elle seule de l’incapacité du monde germanique à se doter de
structures étatiques modernes et nationales avant le XVIIIe siècle. Il faut donc chercher ailleurs.
— La superficie du territoire à gouverner constitue un autre élément important : à une époque où les moyens
de communications et de transports sont très primitifs, il est difficile pour une autorité politique d’exercer son
pouvoir loin de l’endroit où elle se trouve. Or, l’empereur doit exercer cette autorité sur le nord de l’Italie, la
Germanie et la Bourgogne (et accessoirement la Sicile), soit une superficie de près d’un million de kilomètres
carrés. Forcément, quand l’Empereur est occupé en Italie, les territoires germains remuent.
— À cela il convient d’ajouter, conséquence de cette superficie, la grande diversité des populations que
l’empereur doit diriger. Ce n’est pas tant une question de langue (le latin étant la langue savante de toute
l’Europe à cette époque) qu’une question de traditions et de mode d’organisation.
— Peu de choses en commun entre l’Italie du Nord, déjà relativement urbanisée et dans les villes de laquelle
la bourgeoisie occupe des positions politiques importantes, et le royaume de Germanie, pauvre et agricole,
dans lequel le pouvoir est essentiellement entre les mains de seigneurs terriens. Il devient donc difficile
d’élaborer et d’appliquer des politiques communes à cet ensemble complexe.
— Cela étant, superficie et diversité sont pratiquement les conditions qui définissent l’idée d’empire :
d’autres empires plus vastes et encore plus complexes ont pu supporter l’épreuve du temps, comme la
dynastie Shang en Chine antique.
— C’est néanmoins un élément de l’idée impériale dans l’Europe médiévale qui constitue le trait distinctif et,
partant, explicatif de l’échec des dynasties germaniques à réussir en Germanie ce que d’autres dynasties
contemporaines ont pu réussir sur d’autres territoires : la confusion des pouvoirs temporels et spirituels,
conséquences de la prétention à l’universalité de l’idée impériale.
— Cette confusion a pour conséquence, on l’a vu, une lutte violente et permanente, à partir du XIe siècle,
avec la papauté. Occupés à cette lutte stérile, les empereurs n’ont eu d’autres choix que de laisser se
développer en Germanie des pouvoirs locaux forts, capables d’assurer l’ordre minimal d’une part, mais aussi
d’autre part et par voie de conséquence, de battre en brèche l’autorité impériale sur leurs terres. Cette
prétention à l’universalité a ainsi eu comme résultat paradoxal de favoriser, non pas l’unité de territoire, mais
au contraire son éclatement.
— Si encore l’empereur avait disposé de moyens matériels à la hauteur de ses prétentions. Mais au fil des
siècles, le domaine impérial a disparu, ne laissant à l’empereur que les revenus épisodiques qu’il obtient par
la confirmation des droits qu’il concède aux villes ou aux princes et les impôts perçus auprès des territoires
disposant de l’immédiateté. C’est peu et c’est surtout peu stable comme sources de revenus.
— De sorte que l’empereur doit compter sur ses domaines patrimoniaux, limités, pour étendre sa puissance
sur un domaine territorial qui est immense. Les Capétiens ont d’abord consolidé et étendu leur domaine et par
la suite seulement, prétendu avoir des droits sur l’ensemble de la France, lorsqu’ils ont eu les moyens de faire
valoir ceux-ci. En Germanie, le processus a été inversé.
— De sorte que pour ses projets impériaux, l’empereur doit compter sur la bonne volonté des princes
d’empire, qui n’ont pour leur part aucune envie de contribuer financièrement à l’établissement ou à la
consolidation d’un pouvoir qui aura pour conséquences la diminution et la disparition du leur.
— Alors ils mettent la main à la poche avec beaucoup de réticence et préfère choisir pour empereur un
homme disposant d’une richesse suffisante pour ses besoins personnels, mais insuffisante pour ses projets et
sa volonté d’étendre son pouvoir et de matérialiser sa puissance, qui reste pour l’essentiel symbolique.
— Peut-être aurait-il été plus sage pour l’empereur de renoncer lui-même à ses revendications en matière
religieuse, comme le firent les rois de France et d’Angleterre, mais il convient de rappeler que la prétention à
l’universalité des empereurs ne tenait pas qu’à la charge symbolique du titre, car il impliquait aussi des droits
sur le royaume d’Italie, cette Lombardie dont la richesse des villes était nécessaire pour compenser la
pauvreté des territoires du nord.
— Bien sûr, le Très-Chrétien, en France, avait aussi certaines prétentions religieuses, mais il n’entendait pas
d’abord se placer au-dessus de la papauté, même sur le territoire français : ce n’est qu’à l’époque de Philipe le

3
Bel que le conflit avec Rome dégénérera, mais à ce moment, la construction étatique royale sera déjà assez
forte pour que le conflit ne remette pas en question l’autorité du monarque.
— Cependant, on aurait tort de croire que la Germanie n’existe pas même en l’absence d’un État germanique
à proprement parler : malgré les distinctions et les spécificités de leurs langues, de leurs cultures et de leur
environnement politique et économique, les élites de Germanie commencent dès cette époque à se désigner
comme des habitants des Deutsche Lande, des terres de ceux qui parlent le diutsch, le tudesque, la langue du
peuple. L’institution du Reichfürstenstand illustre bien l’existence d’une sorte d’unité nationale.
— À côté de l’institution impériale et parallèlement à celle-ci, le siècle des Hohenstaufen a vu l’apparition de
pouvoirs locaux qui ont commencé, et vont poursuivre dans les siècles suivants, le développement sur leurs
territoires des éléments de l’administration étatique moderne.
— De sorte qu’autour des grands ensembles territoriaux, qui ne sont plus « ethniques », mais dynastiques, qui
ne seront plus à l’ouest mais à l’est, vont se mettre en place, en collaboration avec l’institution impériale qui
s’éteint peu à peu, des pouvoirs qui assureront la relève. Mais le processus sera long.
2 — Évolution politique
2.1 — Le Grand interrègne (1254-1273)
— En attendant, l’empire continue d’exister, même si pour les deux décennies suivantes, la chose n’est pas
évidente. Cette période est qualifiée de Grand interrègne dans l’historiographie, ou encore de Kaiserlos Zeit,
c’est-à-dire, d’époque sans empereur. Ce qui est en apparence paradoxal, car au cours de ces deux décennies
il y presque toujours au moins deux hommes pour se prétendre empereur...
— L’anti-empereur Guillaume de Hollande, couronné en 1247 du vivant de Frédéric II, s’éteint en 1256 et le
trône devient vacant. Il fallut trouver un remplaçant. L’intérêt historique de cette élection réside dans le fait
que l’on voit apparaître pour la première fois le collège électoral à peu près sous la forme qui sera codifiée un
siècle plus tard par Charles IV.
— Deux prétendants, dépensant des sommes importantes pour ce qui est encore la première responsabilité
politique de la chrétienté, furent élus par deux moitiés du collège électoral à quelques semaines d’intervalles.
Aucun des deux ne convenait au pape, qui suggéra le roi de Bohême Ottokar, lequel était rejeté par les
Grands de Germanie, car ce prince déjà très puissant aurait alors acquis un pouvoir écrasant.
— Dans l’ensemble, l’élite dirigeante se satisfaisait de cette situation, qui leur laissait les coudées franches
pour poursuivre les processus de consolidation de leurs pouvoirs sur leurs territoires respectifs. Plus encore,
cette vacance du pouvoir leur permit pendant deux décennies d’accroitre leurs possessions au détriment de
celles de l’empire.
— Les villes d’empire, au contraire, voyaient d’un très mauvais œil la situation, car elles se trouvaient ainsi
directement menacées par l’appétit des seigneurs. Afin d’assurer leur défense, certaines se constituèrent en
Ligue dès 1254.
— Autre conséquence du vide politique, la recrudescence des guerres privées que Saliens et Hohenstaufen
s’étaient employés à combattre, sans jamais parvenir à les éliminer. L’une des causes de l’accroissement des
troubles résidait dans la multiplication, au cours du siècle précédent, du recours par les empereurs, pour les
seconder dans la direction de l’État, à des officiers qui ne disposaient pas de domaines héréditaires et qui
étaient payés en terres.
— Dirigeant de minuscules seigneuries, réduits au chômage par l’effacement de l’État, ces chevaliers
vivaient de pillage et de rançonnage. Si les paysans étaient victimes, ce sont avant tout les villes qui en
souffraient, autre raison pour elle de tenter de s’organiser en dehors d’un cadre étatique qui semblait ne plus
exister.
— Les princes étrangers ne se privèrent pas non plus pour participer à la Curée : ce sont les Français,
particulièrement le prince d’Anjou, qui en profitèrent. Non content de s’être emparé de la Sicile, Charles
s’employait à asseoir son autorité sur le nord de l’Italie, pendant que le roi Philipe le Bel plaçait Lyon sous
son sceptre et faisait d’Otton IV de Bourgogne son vassal. De plus en plus, l’Empire se résumait à la
Germanie.

4
— À moyen et long termes, cette perte de contrôle des autres royaumes de la couronne fut sans doute
bénéfique aux États allemands, car leurs souverains durent ainsi se concentrer sur leurs propres terres qui
avaient bien pâti des ambitions impériales. Même sur le court terme, on peut croire que ces ingérences ont
joué un rôle dans la prise de conscience par les Allemands de leur identité.
2.2 — Le premier Habsbourg : Rodolphe (1273-1291)
— En 1272 lorsque s’éteint « l’empereur » Richard de Cornouailles, fils de Jean sans Terre, qui n’avait que
peu séjourné en Germanie, dont l’élection de 1257 n’avait pas conduit à un couronnement officiel et dont
l’autorité était contesté par Alphonse de Castille et par ceux des Grands qui le soutenait, le pape lui-même,
désireux de ne pas rester seul en charge de la chrétienté, fit pression pour les Grands parviennent à s’entendre
sur un successeur.
— Ainsi, après avoir œuvré pendant plus d’un siècle à affaiblir le pouvoir impérial, la Curie redécouvrait les
vertus de l’empire. L’ironie n’est cependant qu’apparente, car, menacé désormais par la dynastie angevine au
sud, le pape avait à nouveau besoin d’un contrepoids au nord.
— De même, l’échec des Croisades de Louis IX avait laissé les États latins d’Orient dans une situation
difficile et une nouvelle croisade était nécessaire. Or, qui d’autre qu’un empereur pouvait prétendre guider la
chrétienté?
— Écartant à nouveau Ottokar, les Grands choisirent un personnage surprenant pour succéder sur le trône aux
grands empereurs médiévaux : Rodolphe de Habsbourg devint alors roi des romains. Ce dernier n’était
aucunement lié aux dynasties précédentes et ne disposait pas d’une puissance matérielle qui fut menaçante
pour les princes. Son patrimoine n’était pas non plus insignifiant, ce qui semblait garantir que l’empereur
n’aurait pas recours aux « contributions » des grands trop fréquemment.
— De sorte que le 1er octobre 1273, avec le couronnement de Rodolphe, la famille Habsbourg fait son entrée
dans l’histoire allemande. Si à la fin du Moyen-âge les thuriféraires des Habsbourg parvinrent à faire
remonter l’origine de la famille jusqu’aux Romains, à l’époque de l’accession au trône de Rodolphe, les
généalogistes ne pouvaient remonter qu’au XIe siècle, en 1020, précisément.
— Le premier comte de Habsbourg semble s’être affublé du titre au début du XIIe siècle, alors qu’il régnait
sur un domaine de ce nom, fort modeste, dans la région de Zurich, en Suisse contemporaine. Peu à peu, les
possessions de la famille Habsbourg s’étendirent dans la région de l’Alsace, mais au moment de son
couronnement, Rodolphe n’était même pas prince d’empire.
— À la fois pieux (ce qui plaisait à Rome) et proche des Hohenstaufen (ce qui plaisait aux Grands), Rodolphe
accède au trône dans la cinquantaine déjà, ce qui était à la fois un gage de son expérience et offrait la
certitude qu’il ne serait pas empereur très longtemps.
— Modeste mais conscient de ses responsabilités, il employa son règne principalement à deux choses : la
paix intérieure et la consolidation des possessions de sa famille.
— C’est donc naturellement qu’il se tourna contre les chevaliers-brigands, qui avaient profité de l’interrègne
pour empiéter sur les biens d’empire, lesquels furent récupérés en recourant à la méthode forte, alors que de
nombreux châteaux forts appartenant à ces chevaliers furent capturés et détruits.
— Cette mise au pas attira sur le roi des Romains la sympathie des premières victimes des chevaliers : la
population des villes, qui lui fournirent les forces militaires et les sommes nécessaires à ce travail de policier.
De nombreuses villes en furent remerciées par l’obtention officielle de l’immédiateté et prirent le titre de
villes d’empire.
— Quant aux possessions familiales, il dû à l’arrogance d’Ottokar de Bohème la chance qui lui fut donnée
d’en accroitre l’étendue. Ce dernier ne considérant pas Rodolphe comme étant son seigneur légitime, refusa
de lui demander l’investiture de ses titres et en 1275, il fut mis au ban de l’empire. La guerre qui s’en suivit
fut favorable à Rodolphe et Ottokar dut s’avouer vaincu en 1276.
— Après une deuxième guerre en 1278 qui entraina la défaite et la mort d’Ottokar, son royaume fut dépecé et
si son fils Wenceslas conserva la Bohême, ses possessions autrichiennes furent en 1282 confiées aux fils de
Rodolphe. Cette date est historique : dès lors, la maison de Habsbourg s’établissait en Autriche.
— Ailleurs dans l’empire, Rodolphe reprit pied en Italie en renonçant à la Romagne, qu’il céda à la papauté,
alors qu’en Bourgogne la diplomatie dut s’appuyer sur la force pour permettre le rétablissement de l’autorité
impériale. Rodolphe crut pouvoir consolider son pouvoir en épousant la sœur du duc de Bourgogne (alors

5
âgée de 15 ans...), mais prise en étaux entre les prétentions de Philipe le Bel et celles d’Otton, duc de
Franche-Comté, la Bourgogne ne fut pas solidement rattachée à l’empire.
— D’ailleurs, le roi n’avait pas été couronné empereur : il avait songé à la couronne, mais l’occasion ne
s’était jamais présentée et les négociations avec la papauté n’avaient pu aboutir. Il mourut en 1291, sans avoir
pu ceindre la couronne impériale.
2.3 — Les Électeurs tout-puissants (1292-1313)
— Seul un empereur peut dans la tradition politique germanique désigner son successeur en le faisant élire roi
des Romains. Rodolphe n’en eut pas la possibilité et ne put conséquemment que recommander aux électeurs
de voter pour l’un de ses fils. Les cadets Hartmann et Rodolphe furent ainsi proposés, mais ils moururent
avant leur père. Quant à l’aîné, Albert, Rodolphe lui avait confié le domaine familial et comme il préférait
que les deux fonctions soient distinguées, il se garda de le recommander.
— De sorte qu’en 1292, les électeurs purent exercer leur droit de vote sans contraintes, d’autant qu’ils ne
voyaient pas d’un œil favorable la possibilité qu’en succédant à son père, Albert puisse permettre la
consolidation d’une nouvelle dynastie sur le trône.
— Sous les pressions de l’électeur archevêque de Cologne, qui obtint de son protégé des avantages
importants en matières fiscales et légales, le comte Adolphe de Nassau fut couronné le 24 juin 1292. Ce
dernier s’employa cependant rapidement à s’affranchir des contraintes, provoquant la grogne de ceux qui
l’avaient porté au pouvoir.
— Plus grave, aux yeux des Grands de Germanie, Adolphe « vendit » pour 60 000 marcs d’argent l’amitié
allemande à l’Angleterre d’Édouard 1er, alors en lutte avec la France de Philipe le Bel, avant de vendre à
nouveau cette amitié à la France pour 80 000 marcs... Cette vénalité du roi lui fut bien sûr reprochée et servit
de prétexte aux Grands que gênait déjà la rupture du contrat tacite qu’il avait conclu avec eux.
— De sorte que le 23 juin 1298, lors d’une assemblée princière tenue sous la protection d’Albert de
Habsbourg, Adolphe de Nassau fut déposé. S’ensuivit une guerre que remporta Albert, qui obtint la couronne
comme récompense de ses bons services.
— Les Grands avaient donc choisi de se débarrasser d’un roi trop autonome, au profit d’un autre, qui s’avéra
encore plus indépendant : Rodolphe n’avait guère les moyens de cette indépendance, alors qu’Albert, maître
des riches marches autrichiennes, disposait des ressources nécessaires pour mener la politique qu’il désirait :
accroitre sa puissance pour asseoir sa dynastie, quitte à céder des territoires de la Bourgogne à la France en
échange du soutien du Très Chrétien.
— L’opposition contre Albert se cristallisa autour de la question hollandaise, dont le Habsbourg désirait
s’emparer à la mort sans héritier de son maître, ce qui aurait fait du roi le maître du Rhin, de la Meuse et des
profitables péages qui leur sont associés. L’électeur de Cologne, première victime de cet accroissement de
puissance, fomenta donc en 1300 un complot auquel se joignirent trois autres Électeurs.
— Albert réagit promptement, d’abord en isolant politiquement les électeurs rebelles en s’appuyant sur les
autres princes, puis en les écrasant par la force l’un après l’autre. Dès 1302, la victoire d’Albert était
complète.
— La fronde vaincue, Albert voulut faire ce que son père n’avait pas pu faire, c’est-à-dire asseoir sa lignée.
Pour cela, il devait être couronné empereur, ce qui nécessitait de s’entendre avec le pape. Boniface VIII, qui
était déjà très remonté contre le fait qu’Albert avait été choisi sans qu’il fût consulté n’appréciait par les
bonnes relations du roi avec Philipe le Bel et exigea qu’il renie son entente avec le grand ennemi de la
papauté. Albert y consentit en août 1303, en vain : 2 mois plus tard, le pape mourrait sans que le
couronnement ait pu avoir lieu.
— Le reste de son règne, Albert le passa à étendre le patrimoine familial à l’est, du côté de la Bohême, mais
les succès qu’il y remporta d’abord n’eurent pas de suite, son fils Rodolphe n’ayant survécu que quelques
mois à son couronnement en tant que roi de Bohême. Quant au roi lui-même, il fut assassiné dans le château
familial de Habsbourg par un neveu en colère tenu à l’écart des fortunes de la famille.
— C’est donc un concours de circonstance qui permit aux Électeurs de reprendre leur rôle. Philipe le Bel,
dont la puissance était à ce moment sans égal sur le continent, proposa la candidature de son frère Charles de
Valois, mais les Électeurs, craignant justement cette puissance, choisirent plutôt Henri VII de Luxembourg, le
frère de l’électeur de Trêves, pour devenir le prochain roi des Romains, le 27 novembre 1308.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%