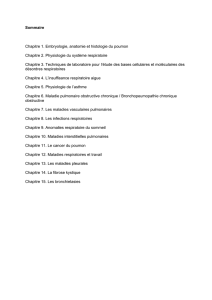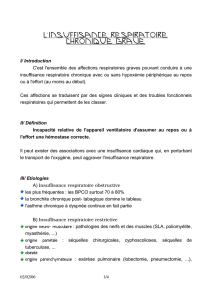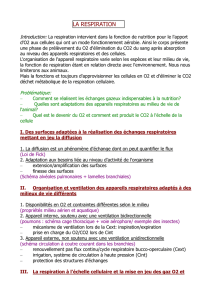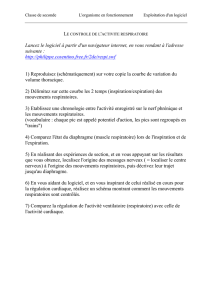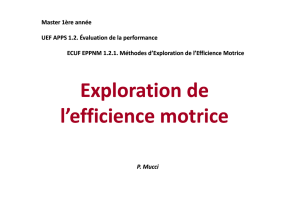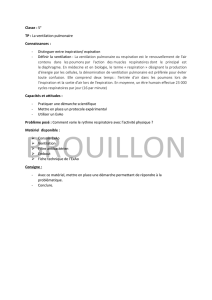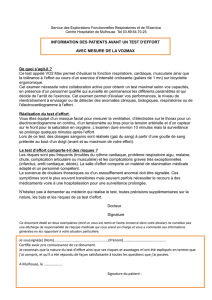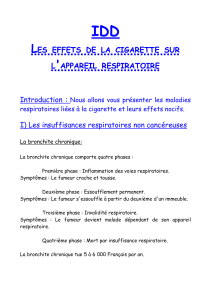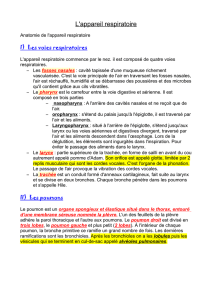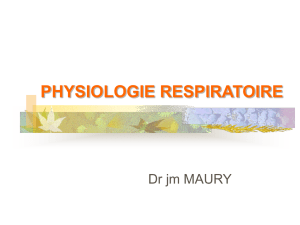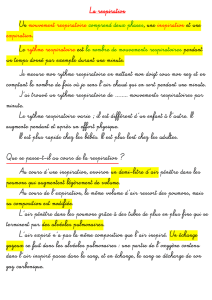(09-Insuffisance Respiratoire Chronique révisée 2007)

Question 254. Insuffisance respiratoire chronique
Module 12. Uro-Néphro-Pneumologie.
Service des maladies respiratoires et allergiques (Service Pr Lebargy)
1
Q
QU
UE
ES
ST
TI
IO
ON
N
2
25
54
4
L
LE
ES
S
I
IN
NS
SU
UF
FF
FI
IS
SA
AN
NC
CE
ES
S
R
RE
ES
SP
PI
IR
RA
AT
TO
OI
IR
RE
ES
S
C
CH
HR
RO
ON
NI
IQ
QU
UE
ES
S
M
Mo
od
du
ul
le
e
1
12
2.
.
U
Ur
ro
o-
-N
Né
ép
ph
hr
ro
o-
-P
Pn
ne
eu
um
mo
ol
lo
og
gi
ie
e
GENERALITES
Définition
L’insuffisance respiratoire chronique est définie par
l’incapacité du système respiratoire à assurer les
échanges gazeux (et donc l’oxygénation des tissus) au
repos ou à l’effort.
Pour le praticien le diagnostic s’appuie sur 2 critères
simples : la dyspnée d’effort ou de repos et l’hypoxémie
(diminution de la pression partielle en oxygène du sang
artériel) témoignant de l’altération des échanges gazeux.
Physiopathologie
L’appareil respiratoire a comme principale fonction de
permettre les échanges gazeux (O2 et CO2) entre
l’atmosphère et l’organisme. Trois grands processus
physiologiques sont nécessaires pour assurer cette
fonction : le contrôle nerveux de la respiration, la
ventilation qui assure le renouvellement des gaz
alvéolaires et l’hématose
L’hématose est l’ensemble des phénomènes
physiologiques permettant l’oxygénation du sang au
niveau pulmonaire.
• L’oxygène contenu dans l’air inspiré chemine dans
les voies aériennes (bronches, bronchioles) et atteint les
alvéoles pulmonaires. Il diffuse à travers la membrane
séparant les alvéoles et les capillaires pulmonaires
(figure 1A) et se fixe sur l’hémoglobine des globules
rouges (Figure 1B). Il est ensuite transporté vers les
tissus où il est utilisé comme source d’énergie.
• Le gaz carbonique, produit du métabolisme
tissulaire, emprunte le trajet inverse. Dissous dans le
plasma et les globules rouges, il diffuse vers l’alvéole
pulmonaire avant d’être éliminé dans l’air expiré
• Chez le sujet jeune sain, la mesure des gaz du sang
artériel en air ambiant donne les valeurs suivantes :
Pa02 = 90-100 mm Hg, PaC02 = 38-40 mm Hg, pH=
7,38-7,40.
Figure 1 : Schéma de l’hématose. (A) vue en
microscopie électronique de l’interface alvéolo-
capillaire, siège des échanges gazeux. Les astérisques
signalent la membrane alvéolo-capillaire. (B) Schéma
de la fixation de l’oxygène sur l’hémoglobine du globule
rouge
En pathologie, plusieurs mécanismes peuvent conduire
à un trouble de l’hématose avec pour conséquences
l’apparition d’une hypoxémie et d’une insuffisance
respiratoire chronique :
• une réduction de la surface d’échange soit par
destruction des alvéoles pulmonaires et des petits
vaisseaux contingents (emphysème pulmonaire) soit par
obstruction des vaisseaux pulmonaires (séquelles
d’embolie pulmonaire, hypertension artérielle
pulmonaire primitive)
• une inégalité de rapport ventilation–perfusion :
certains territoires pulmonaires sont correctement
perfusés mais mal ventilés en raison de l’obstruction des
bronchioles. Il en résulte un mélange de sang oxygéné
provenant des territoire perfusés-ventilés et de sang
veineux non oxygéné provenant des territoires perfusés
et mal ventilés (figure 2). Ce mécanisme semble
prédominant au cours des bronchopneumopathies
chroniques obstructives.
• un épaississement de la membrane alvéolo-capillaire
par déposition anormale de fibres de collagène (fibroses
pulmonaires diffuses primitives ou secondaires)
La ventilation est l’ensemble des phénomènes
mécaniques responsables des variations de pressions
intra-thoracique capables de générer les débits aériens
dans les voies aériennes.
Elle met en jeu les muscles respiratoires : à l’état
physiologique, l’inspiration est active. La contraction du
diaphragme, principal muscle inspiratoire, provoque une
diminution des pressions intra-pleurales et intra-
alvéolaires générant un flux aérien de la bouche vers les
alvéoles pulmonaires (Figure 3A). L’expiration est
passive par relâchement des muscles inspiratoires.
Alvéole
Capillaire
O2
O2+H
HbO
Globule rouge
B
Globules
Capillaire
Alvéole
A
*
*
*
*
*
*

Question 254. Insuffisance respiratoire chronique
Module 12. Uro-Néphro-Pneumologie.
Service des maladies respiratoires et allergiques (Service Pr Lebargy)
2
Le gradient de pression et le flux aérien s’inversent (Fig
3B).
Rapports
ventilation/perfusion homogènes
Inadéquation
ventilation/perfusion
Figure 2 : Mécanisme de l’hypoxémie par inégalité de
rapport ventilation-perfusion. (A) Le sang des
capillaires (sang bleu) s’enrichit en oxygène (sang
rouge) lorsqu’il circule dans les territoires
correctement ventilés. ( B) Le sang circulant dans les
territoires mal ventilés reste désaturé et se mélange au
sang oxygène provenant des territoires adjacents
ventilés –perfusés. Il en résulte un sang mêlé désaturé et
une hypoxémie.
En pathologie, certaines insuffisances respiratoires sont
liées à des altérations de la mécanique ventilatoire :
• Déformations thoraciques : cyphoscolioses,
séquelles de thoracoplastie ou de chirurgie délabrante.
• Atteinte des muscles respiratoires (séquelles de
poliomyélite, neuropathies, myopathies)
La traduction gazométrique de cette hypoventilation
alvéolaire est une hypoxémie associée à une
hypercapnie (> 45 mm Hg). Lorsque l'hypoventilation
alvéolaire est le seul mécanisme d'hypoxémie en cause,
la somme des gaz Pa O2 + Pa CO2 est > 120 mm Hg
Le contrôle nerveux de la ventilation
Les centres nerveux contrôlant la ventilation sont situés
dans le bulbe et la protubérance. Ils fonctionnent
comme de véritables oscillateurs organisés en réseaux
capables de créer un rythme respiratoire régulier faisant
alterner un temps inspiratoire et un temps expiratoire.
Ils sont régulés par l’intermédiaire de chémorécepteurs
(récepteurs centraux sensibles au pH et au CO2 et
récepteurs périphériques situés dans le glomus
carotidien, sensibles à l’hypoxémie). En pathologie,
certaines hypoventilations alvéolaires sont liées à la
faillite du contrôle nerveux de la ventilation.
Figure 3 : Schéma d’un modèle uni alvéolaire de la
ventilation : (A) l’inspiration est active : La contraction
du diaphragme entraîne une diminution des pressions
intrapleurales (Ppl) et intra alvéolaires (Palv). Il en
résulte un gradient de pression entre l’atmosphère (la
bouche) et l’alvéole générant un flux inspiratoire. (B)
L’expiration est passive : le relâchement du diaphragme
augmente la pression intrapleurale et donc la pression
intra alvéolaire. Il en résulte une inversion de gradient
et un flux expiratoire
Etiologies
On distingue les insuffisances respiratoires dont le
mécanisme initial est une perturbation des échanges
gazeux et celles dont le mécanisme est une altération de
la fonction ventilatoire du système thoraco-pulmonaire
(altération de la fonction pompe)
Normoxémie
pO2= 100 mm Hg
CO2 O2
O2
CO2
A
CO2 O2
Hypoxémie avec ou
sans hypercapnie
B
Ppl
Diaphragme
Palv
Inspiration
Gradient de
pression
Diaphragme
Palv
Expiration
Inversement
du gradient
de pression
Ppl
A
B

Question 254. Insuffisance respiratoire chronique
Module 12. Uro-Néphro-Pneumologie.
Service des maladies respiratoires et allergiques (Service Pr Lebargy)
3
IRC dues à une anomalie des échanges gazeux IRC dues à une anomalie de la fonction pompe du
système thoraco-pulmonaire
Shunts anatomiques
− shunts intracardiaques
− fistules artério-veineuses pulmonaires
Inégalités rapports ventilation perfusion
− BPCO
− Pneumopathies infiltrantes (fibroses
pulmonaires)
− Maladies vasculaires pulmonaires (coeur
pulmonaire chronique, Hypertension artérielles
pulmonaire)
Trouble de diffusion
− Oedèmes pulmonaires
− Fibroses pulmonaires
− Destruction de la surface d'échange (emphysème
pan-lobulaire)
Maladies du système nerveux central
− Accidents vasculaires cérébraux
− Tumeurs intracrâniennes
− Hypoventilation centrale
− Traumatisme médullaire cervical
Maladies neuro-musculaires :
− Maladies neurologiques (Sclérose Latérale
Amyotrophique, Sclérose en Plaques, Guillain
Barré)
− Myopathies (dégénératives, inflammatoires,
métaboliques)
Déformations thoraco-vertébrales :
− Cyphoscoliose
− Chirurgie délabrant le thorax
Maladies des voies aériennes et du poumon
− BPCO sévère
− Bronchectasies, mucoviscidose
Obésité majeure (IMC > 30kg/m2)
Atteintes pleurales :
− Pachypleurites
Ce tableau montre que certaines insuffisances
respiratoires relèvent de plusieurs mécanismes. C'est le
cas par exemple des BPCO : les anomalies du rapport
ventilation-perfusion prédominent initialement mais
secondairement sont associées à une faillite de la
fonction pompe.
L’exploration de la fonction respiratoire est une étape
importante du diagnostic. Elle permet d'apprécier la
fonction ventilatoire et de mieux préciser les
mécanismes de l'insuffisances respiratoire. Selon le
déficit ventilatoire on distingue (Tableau 1) :
Les insuffisances respiratoires chroniques
obstructives (IRCO) caractérisées par une réduction
des débits dans les voies aériennes sont la conséquence
d’affections des bronches, au premier rang desquelles
figurent les bronchopneumopathies chroniques
obstructives (BPCO). Les BPCO regroupent
• La bronchite chronique
• L’emphysème
• Les asthmes vieillis ou remodelés
Les insuffisances respiratoires chroniques
restrictives (IRCR) sont caractérisées par une
réduction harmonieuse de l’ensemble des volumes
pulmonaires tandis que les débits ne sont pas altérés.
Elles sont la conséquence des
• Atteintes pariétales : déformations thoraciques,
atteintes neuromusculaire, grandes obésités
• Atteintes pleurales : pachypleurites étendues
(épaississement pleuraux séquellaires de pleurésies
infectieuses ou inflammatoires)
• Atteintes pulmonaires : fibroses pulmonaires
primitives ou secondaires (silicoses, asbestoses, fibroses
médicamenteuses…)
Les insuffisances respiratoires mixtes associent une
réduction des débits dans les voies aériennes et une
diminution des volumes pulmonaires : elles sont
secondaires à des affections complexes telles que les
séquelles de tuberculose pulmonaire étendues,
silicose…
IRC Obstructive • Bronchite chronique obstructive
• Emphysèmes
• Asthme vieilli
IRC Restrictive • Déformations thoraciques
− Cyphoscoliose
− Chirurgie délabrante du thorax
• Maladies neuro-musculaires
− Traumatisme médullaire cervical
− Maladies neurologiques (SLA, SEP,
Guillain Barré)
− Myopathies (dégénératives,
inflammatoires, métaboliques)
• Les obésités morbides
• Atteintes pleurales : pachypleurites
• Atteintes pulmonaires : fibroses
pulmonaires
IRC Mixte • Séquelles tuberculeuses
• Silicose
Tableau 1 : Classification des insuffisances
respiratoires chroniques en fonction du profil
fonctionnel et des étiologies
En l'absence de déficit ventilatoire il est important de
rechercher (+++)
• Une insuffisance ventriculaire gauche
• Une affection vasculaire pulmonaire (Cœur
pulmonaire chronique secondaire à une embolie
pulmonaire ou une hypertension artérielle
pulmonaire primitive)

Question 254. Insuffisance respiratoire chronique
Module 12. Uro-Néphro-Pneumologie.
Service des maladies respiratoires et allergiques (Service Pr Lebargy)
4
RAPPEL CLINIQUE
La présentation clinique et l’évolution de la maladie
varie selon les étiologie et les mécanismes de
l’insuffisance respiratoire chronique
Les insuffisances respiratoires chroniques
obstructives
sont les plus fréquentes. Leur
présentation clinique et leur évolution sont stéréotypées
La dyspnée
La dyspnée est l’élément séméiologique constant du
tableau clinique. La dyspnée est définie comme une
perception douloureuse de la respiration.
• Au stade initial, la dyspnée n’apparaît que pour des
efforts importants. Elle fait suite à un long passé de
toux, d’expectoration muqueuse et d’épisodes de
surinfection bronchique.
• L’aggravation se fait progressivement sur plusieurs
années , la dyspnée survenant pour des efforts moindres
puis minimes (déplacements, toilette, parole).
• A un stade avancé de l’insuffisance respiratoire, le
patient présente une dyspnée de repos. Il existe une
bonne corrélation entre l’intensité de la dyspnée et la
gravité de l’insuffisance respiratoire conduisant le
clinicien à utiliser des échelles de dyspnée telles que
l’échelle CEE (tableau 2)
Stade 0 Absence de dyspnée quelque soit l’effort fourni
Stade 1 Dyspnée à l’effort physique important
Stade 2 Dyspnée à la montée d’un étage ou d’une
marche en côte à allure normale
Stade 3 Dyspnée à la marche sur terrain plat en suivant
quelqu’un de son âge
Stade 4 Dyspnée à la marche sur terrain plat à son propre
rythme
Stade 5 Dyspnée au moindre effort de la vie courante
Tableau 2
:
Stades de dyspnée en fonction de l’intensité
(CEE)
Les autres signes
• La cyanose : c’est une coloration bleutée des
muqueuses et des téguments. Elle traduit un taux
d’hémoglobine réduite (désaturée) dans le sang artériel
supérieur à 5 gr/100 ml. Elle survient à un stade avancé
de la maladie ou apparaît lors des exacerbations de
l’insuffisance respiratoire
• Les modifications ventilatoires s’observent
essentiellement dans les formes sévères des BPCO.
Elles sont caractérisées par
− une distension thoracique par augmentation du
diamètre antéropostérieur du thorax (déformation
thoracique en « tonneau »)
− un allongement du temps expiratoire de la
respiration avec pincement des lèvres pour générer
une contre pression dans les voies aériennes servant
à lutter contre le collapsus expiratoire des bronches
− La mise en jeu des muscles respiratoires
accessoires (sterno-cléido-mastoïdiens, intercostaux)
− L’hypertension artérielle pulmonaire est la
conséquence d’une vasoconstriction des artères
pulmonaires induite par l’hypoxémie chronique. Elle
se traduit par une turgescence des veines jugulaire,
une tachycardie, un éclat de B2 au foyer pulmonaire
et un souffle d’insuffisance tricuspidienne
Les complications
Les exacerbations constituent la principale complication
des BPCO. Elles sont définies comme des épisodes
d’aggravation aiguë ou subaiguë de l’insuffisance
respiratoire chronique. Elles peuvent conduire à une
détresse respiratoire aiguë par épuisement des muscles
respiratoires et mettre en jeu le pronostic vital. Les
infections bronchiques sont responsables de la plupart
de ces exacerbations
Le retentissement de hypoxémie chronique conduit au
développement d’une hypertension artérielle pulmonaire
avec pour conséquence l’insuffisance ventriculaire
droite. Les poussées d’œdème des membre inférieurs, la
tachycardie, la turgescence des jugulaires et
l’hépatomégalie en sont les principaux signes. L’HTAP
peut être mesurée par échographie cardiaque ou par
cathétérisme cardiaque droit.
Les insuffisances respiratoires restrictives
Les atteintes pariétales sont constituées par les
cyphoscolioses idiopathiques et les maladies neuro-
musculaires
• Les cyphoscolioses, lorsqu’elles sont sévères
peuvent se compliquer d’insuffisance respiratoire. Un
certain nombre de critères permettent de prédire cette
évolution avant même la survenue de ces complications
− la précocité d’apparition de la scoliose (âge < 5
ans),
− la longueur de la déformation
− le siège : un siège haut situé, cervical ou dorsal
haut est de plus mauvais pronostic
− l’importance de l’angulation
− une capacité vitale < 45%
La détérioration de l’état respiratoire se fait vers l’âge
de 40-50 ans, soit par une décompensation respiratoire
aiguë liée à un facteur déclenchant rompant l’équilibre,
soit de façon progressive (majoration de la dyspnée,
asthénie, somnolence diurne secondaire à des
perturbations du sommeil). En l’absence de ventilation
assistée, 80% des patients décèdent dans les deux ans
qui suivent l’apparition de l’hypoventilation alvéolaire
et du cœur pulmonaire chronique .
• Les maladies neuro-musculaires : il peut s’agir de :
− Lésions spinales presque toujours de nature post-
traumatiques. Lorsqu’elles siègent au dessus de C3,
elles entraînent une paralysie respiratoire complète
rendant le patient totalement dépendant de la
ventilation artificielle sur trachéotomie. Les lésions
de la moelle cervicale basse (entre C3 et C8)
entraînent une quadriplégie mais l’activité du
diaphragme et des scalènes persiste.

Question 254. Insuffisance respiratoire chronique
Module 12. Uro-Néphro-Pneumologie.
Service des maladies respiratoires et allergiques (Service Pr Lebargy)
5
− Les maladies neuro-musculaires diffuses sont très
diverses. Elles regroupent les maladies
dégénératives de la corne antérieure de la moelle
(sclérose latérale amyotrophique en particulier) et
les myopathies pour la plupart de nature génétique.
Chaque étiologie imprime ses nuances au tableau
clinique et évolutif.
La sclérose latérale amyotrophique est une maladie
de l’adulte. Elles se traduit au début par une
faiblesse musculaire. Les fasciculations et
l’amyotrophie des muscles de la main et de la langue
sont évocateurs. Ultérieurement le déficit musculaire
s’étend aux autres groupes musculaires : l’atteinte
des muscles respiratoires conduit en quelques mois
ou quelques années à une insuffisance respiratoire.
L’atteinte des nerfs crâniens est responsable de
troubles de déglutition à l’origine de fausses routes
alimentaires précipitant les complications
respiratoires
Les myopathies sont d’évolution plus insidieuse et
débutent en général dans l’enfance. La plus
fréquente est la dystrophie musculaire de Duchenne
de Boulogne. Elle atteint les enfants de sexe
masculin. Les premiers signes apparaissent vers
l’âge de 2 à 3 ans, la marche est perdue entre 10 et
12 ans et les troubles respiratoires surviennent à
partir de l’âge de 12 ans. En l’absence de traitement,
le décès par insuffisance respiratoire ou cardiaque
survient vers l’âge de 20 ans.
Le syndrome hypoventilation-obésité (SHO) (+++)
• Définition : insuffisance respiratoire chronique
hypercapnique (PaCO2 > 45 mm Hg) survenant
chez un patient obèse (IMC > 30kg/m2) en dehors
de toute autre pathologie. En cas de BPCO
associée, on parle de syndrome de chevauchement
("overlap" syndrome). Fréquence : 30% chez les
sujets ayant un IMC > 35 kg/m2 et 50% chez ceux
ayant un IMC > 50kg/m2. Chez les obèses, la
mortalité est plus élevée en cas d'hypercanie.
• Physiopathologie : la masse graisseuse provoque
une augmentation de charge et donc de travail
respiratoire. Or les muscles ne sont pas capables de
compenser cette augmentation de charge car la
masse graisseuse (notamment la masse abdominale
en position couchée) entraîne des modifications
géométriques du diaphragme. Il en résulte une
altération de la fonction des muscles respiratoires
et une hypoventilation ()
L'augmentation de la masse graisseuse entraîne une
augmentation de production de leptine par le tissu
adipeux (la leptine théoriquement exerce une
activation du centre de la satiété conduisant à la
réduction de la prise alimentaire). Chez le rat obèse
génétiquement modifié pour la leptine (ob-/ob-)
(ces rats ne produisent pas de leptine et sont
obèses), on voit apparaître une hypoventilation
alvéolaire ( PaCO2). L'administration de leptine
exogène corrige l'hypoventilation alvéolaire en
stimulant les centres respiratoires. On peut donc
déduire de ce modèle expérimental que chez le
sujet obèse, il existe d'une part une résistance des
chémorécepteurs à la leptine (les taux sériques de
leptine sont élevés mais ne corrigent pas
l'hypoventilation) et d'autre part une diminution de
la sensibilité des chémorécepteurs à la PaCO2 ()
• Le traitement fait appel à des mesures diététiques
associées à une prise en charge psychologique, le
traitement des facteurs de risques associés (arrêt du
tabac, équilibre du diabète, traitement de
l'hypertension artérielle…) et une ventilation non
invasive habituellement à deux niveaux de pression.
Les atteintes pleurales
Elles sont moins fréquentes actuellement. Elles
correspondent à des séquelles étendues de pleurésies
infectieuses ou d’hémothorax. L’épaississement et la
rigidité de la plèvre entraînent une gêne à l’expansion
pulmonaire lors de l’inspiration dont témoigne le
syndrome restrictif identifié par les explorations
fonctionnelles respiratoires.
Les atteintes pulmonaires
Elles sont représentées par les fibroses pulmonaires.
Selon l’étiologie incriminée, on distingue
• les fibroses secondaires : elles peuvent être d’origine
iatrogène (traitement par amiodarone, antiseptique
urinaire, chimiothérapies anticancéreuses ou
radiothérapie) ou secondaires à une exposition
professionnelle à l’amiante. Enfin certaines fibroses
sont associées à des maladies de système (polyarthrite
rhumatoïde, sclérodermie…)
• les fibroses primitives ou idiopathiques sans cause
identifiée. Elles surviennent entre 50 et 60 ans, avec une
prédominance masculine. Le premier symptôme est une
toux sèche, quinteuse résistant au traitement.
Progressivement le tableau se complète par une dyspnée
d’effort s’aggravant en quelques années. Le scanner
thoracique permet d’affirmer le diagnostic en montrant
une rétraction pulmonaire et un épaississement des
espaces interstitiels. L’évolution se fait vers
l’aggravation du syndrome restrictif et la majoration de
l’hypoxémie d’effort puis de repos. La médiane de
survie est en moyenne de 5 ans à partir du diagnostic.
LES TRAITEMENTS
INSTRUMENTAUX DE L’I R C
L’oxygénothérapie de longue durée (OLD)
Généralités
L’oxygénothérapie consiste à enrichir l’air inspiré en
oxygène afin de corriger l’hypoxémie. Le bénéfice de
l’OLD a été démontré et résumé dans le tableau 3
Les sources d’oxygène
Il existe 3 grandes sources d’oxygène : l’oxygène
gazeux, le concentrateur et l’oxygène liquide.
• L’oxygène gazeux est comprimé à 200 bars dans
un
cylindre en fonte ou en aluminium (encore appelé
bouteille ou obus). La contenance des obus est de 0,4, 1
et 3 m3. L’autonomie en oxygène dépend de la
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%