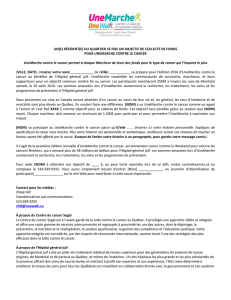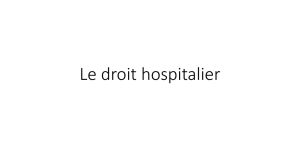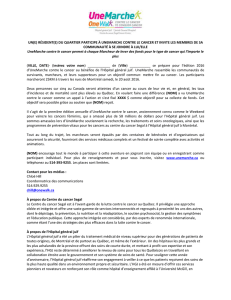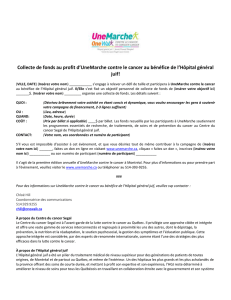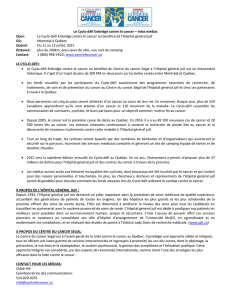l`ancien quartier juif de budapest

L’ANCIEN QUARTIER JUIF DE BUDAPEST
LE DÉVELOPPEMENT HISTORIQUE
ET
LA SITUATION ACTUELLE
Avant de commencer ma présentation sur l’évolution du quartier juif historique de Budapest,
je dois vous dire quelque mots sur Budapest en général, afin que les termes que je vais utiliser
soient compréhensibles même pour ceux qui ne connaissent pas cette ville et son histoire.
Tout d’abord, il faut se rendre compte du fait que la ville portant le nom de Budapest n’existe
que depuis 1873, c’est-à-dire, depuis l’année où trois villes historiques, Pest, Buda et Óbuda,
situées des deux côtés du Danube, étaient unifiées afin de créer une nouvelle capitale pour la
Hongrie – alors en plein développement. Au commencement du 19ème siècle, l’arrondissement
que, aujourd’hui, nous appelons « l’ancien quartier juif de Budapest », était une banlieue de la
ville de Pest, sur le côté droit du Danube. Aujourd’hui c’est l’un des plus anciens quartiers de
Budapest, avec les quartiers historiques du Château de Buda et de la Cité de Pest ; en même
temps c’est l’un des quartiers les plus riches en valeurs architecturales et culturelles.
L’habitat juif, le plus ancien, médiéval, de la ville, se situait de l’autre côté du Danube,
à Buda, dans le quartier du Château. Cependant, de cet ancien habitat juif il ne reste qu’une
synagogue privée dans une maison bourgeoise médiévale – fonctionnant aujourd’hui en tant
que musée. En outre nous avons connaissance de l’existence des ruines souterraines de deux
autres synagogues, dont on parle beaucoup de l’excavation et de la présentation.
Le quartier du Château est d’origine médiévale – non seulement la structure de ses
rues et de ses parcelles date du Moyen Age, mais aussi un bon nombre de ses maisons,
mélangées aux maisons baroques et classicistes.
La Cité de Pest est également d’origine médiévale – un fait qui est reflété surtout dans
la structure de ses rues et de ses parcelles. Cependant, les immeubles actuels, tout comme
celui du quartier juif, datent plutôt du 19ème siècle.
La structure des rues et des parcelles de l’ancien quartier juif de Pest ne date pas du
Moyen Age ; elle s’est développée d’une manière organique, sans réglementation, pendant le
18ème siècle. Les rues à l’intérieur du quartier sont souvent déterminées par des maisons ou des
rangées de maisons classicistes-romanticistes de la première moitié du 19ème siècle. C’est dans
ce quartier que, vers la deuxième moitié du 19ème siècle, se sont développés l’habitat et le
centre commercial de l’une des plus grandes communautés juives de l’Europe. C’est ici, qu’à
cette époque, ont été construites les institutions les plus importantes de la vie religieuse,
administrative, sociale et culturelle de la communauté juive : des synagogues, des bâtiments
culturels et administratifs.
1

La singularité et l’importance du quartier sont données, outre ses rues variées, parfois
au tracé irrégulier, et ses rangées de maisons du 19ème siècle, par l’enchantement oriental des
synagogues, le dédale des passages, l’architecture art nouveau remarquable et, par-dessus
tout, par le mélange créé par tous ces facteurs. Cet ensemble architectural et culturel malgré
les destructions récentes, est considéré comme une entité unique en Europe.
Le quartier abrite toujours une communauté juive vivante. La présence de la
communauté est permanente, sans aucune interruption, depuis presque deux siècles, malgré sa
diminution tragique pendant la guerre et après par l’émigration subséquente. La beauté de ses
synagogues, la variété de ses rues, son atmosphère caractéristique, les vastes cours et jardins
si rares au centre ville, les bâtiments classicistes et art nouveau, portant la trace des mains des
plus grands architectes hongrois, rendent ce lieu attirant et exceptionnel.
Le quartier est également un lieu de mémoire historique. Avant la deuxième guerre
mondiale, la plus grande partie de la communauté juive de la capitale – constituant à cette
époque un cinquième de la population de Budapest – habitait ici. C’était dans ce quartier que,
en décembre 1944, le ghetto de Budapest fut constitué. Contrairement aux communautés
juives d’autres villes d’Europe centrale, malgré les souffrances infligées et les assassinats, la
vie de la plupart des juifs entassés ici fut épargnée. Au dernier moment même les maisons et
les rues du quartier ont échappé à la destruction totale. Ainsi, dans ce lieu, ce ne sont pas
seulement les monuments officiels, mais chaque bâtiment, chaque pierre même qui
constituent un lieu de mémoire.
Cependant, tout ce qui a échappé aux destructions de la guerre est aujourd’hui en
danger.
On fait détruire en un rythme toujours croissant les maisons d’habitation du quartier, et
on altère le caractère de ses rues. Avec les bâtiments disparaissent leurs habitants, les
habitudes quotidiennes, les traditions historiques, les lieux de mémoire, les témoignages. A la
place des précieux bâtiments historiques on monte de nouvelles constructions
disproportionnées et sans valeur. Les nouveaux immeubles, même après des années
d’existence, sont quasi vides, ainsi que la plupart des parkings souterrains.
En l’an 2002 une grande partie de l’ancien quartier juif était déclarée « zone tampon »
du Boulevard Andrássy, faisant partie du patrimoine mondial culturel ; en tant que tel, ce
quartier est censé être protégé par l’UNESCO et par la loi internationale. D’une manière
paradoxale, cette protection n’a fait qu'accélérer le processus de destruction.
Au printemps de 2004, voyant la démolition insensée, ainsi que le volume et la
médiocrité inacceptables des nouveaux bâtiments, un mouvement de citoyens s’est lancé pour
sauver le quartier. Suite à l’initiative de l’Association ÓVÁS!, l’Office de la Protection du
Patrimoine Culturel a déclaré le territoire de l’ancien quartier juif de Pest « zone d’importance
patrimoniale » ; qui plus est, en 2005, l’Office a déclaré « monument historique » 51
bâtiments, parmi lesquels se trouvaient des maisons déjà destinées à la démolition.
Cependant, malgré ces interventions, la situation n’a fait que s’aggraver, en sorte que,
à présent, presque 40 pourcent des îlots intérieurs du 19ème siècle sont touchés, leur place étant
2

occupée par des nouvelles maisons de type cité de banlieue. Récemment la destruction a
atteint même les maisons classées « monuments historiques ». C’est le cas, par exemple, au
lieu le plus important et le plus fréquenté par les touristes, en proximité de la grande
synagogue de la rue Dohány, où d’abord le conseil municipal, puis même l’Office de la
Protection du Patrimoine Culturel, ont donné la permission de démolir les ailes intérieures des
deux monuments historiques, afin de donner lieu à la construction d’un ensemble
d’immeubles de type HLM.
Les démolitions visent principalement des maisons d’habitation. Parmi ces derniers,
un bon nombre relève des types architecturaux appartenant, d’une manière caractéristique et
exclusive, à ce quartier. Toutes les maisons ne sont pas des monuments extraordinaires, mais
chacune est remarquable du point de vue architectural, chacune fait partie intégrante du
paysage et de la vie urbains du quartier. Leurs histoires s’entrelacent – à travers celles de leurs
propriétaires et de leurs habitants – avec celles, plus générales, des citoyens et de la
communauté juive de Pest, dont ce quartier est devenu le domicile. Ce n’est que l’ensemble
de ces rangées de maisons et de ce paysage urbain, qui saurait fournir l’arrière-fond naturel
des bâtiments exceptionnels, des synagogues et des monuments historiques, ainsi que la
continuité, l’authenticité historique, l’atmosphère et l’enchantement du quartier.
L’histoire du développement et de la construction du quartier
La période de développement urbain spontané (18ème siècle)
Au 17ème siècle, cette partie de la ville de Pest (à savoir le territoire délimité par le présent
boulevard Károly, l’avenue Andrássy, le Grand Boulevard et l’avenue Rákóczi), n’était pas
encore construite. Sa partie intérieure était couverte par des jardins, et sa partie extérieure, par
des terres arables et des fermes.
La construction du quartier a commencé au début du 18ème siècle, d’une manière
spontanée. A cette époque, la ville de Pest, occupant une surface très limitée, entourée par un
mur médiéval, s’avérait de plus en plus étroite pour ses citoyens, dont le nombre et la richesse
allait croissant. Ainsi, le quartier des jardins est devenu un lieu de construction favori, de sorte
qu’à la fin du 18ème siècle ce quartier est devenu la plus grande banlieue de Pest. En 1777, le
territoire, jusque là simple faubourg, a reçu le nom « Terézváros » (Theresienstadt,
Thérèseville). En 1806 le nombre des habitants des « jardins » a presque atteint celui des
habitants de la Cité.
Le quartier des jardins était d’abord uniquement articulé par d’étroits sentiers
longitudinaux ; l’un de ces sentiers est devenu la rue principale du quartier, c’est-à-dire la rue
Király. Afin de procurer un meilleur accès aux terrains à construire, des rues transversales
furent créées ; ce fut d’après cette structure que le morcellement et l’allocation des terrains à
3

construire ont été complétés entre les années 1733–77. A cette époque s’est formée la majorité
des rues longitudinales et transversales, et c’est aussi de cette époque que datent les noms,
d’une grande partie des rues, invoquant le temps des jardins.
Le développement urbain spontané, commencé au début du 18ème a duré pendant
presqu’un siècle. Le réseau organique des rues étroites de tracé irrégulier, les croisements des
rues souvent décalés ou en forme de T, la grande variété des terrains construits, parfois très
larges, parfois très étroits, la variation des parcelles, plus irrégulières et grandes au centre,
plus petites et régulières plus loin, assignées aux ouvriers des terres, tous formés au 18ème
siècle, détermine même aujourd’hui la structure urbaine du quartier.
Les débuts du développement urbain réglementé et de l’embourgeoisement,
l’établissement de la communauté juive (1805–1873)
Le premier plan d’aménagement urbain de la ville de Pest a été établi par János Hild en 1805.
Ce plan a également inclu notre quartier, alors déjà appelé Thérèseville. En suivant ce plan, de
nouvelles rues transversales furent ouvertes et le tracé de la rue Dohány s’est formé. La
maison de la famille Orczy était déjà là, au début de la rue Király, qui bientôt devint le
bâtiment symbolique du quartier commercial juif. Également, l’église catholique romaine de
la paroisse de Thérèseville était présente, marquant la limite ultérieure du quartier. A cette
époque, la rue Gyár – aujourd’hui place Franz Liszt – marquait les limites du terrain construit.
En 1837 Thérèseville est déjà le quartier le plus populeux et le plus encombré de la
ville de Pest. Auprès de maisons en rez-de-chaussées, des maisons bourgeoises avec étages
étaient également bâties. Cependant, l’inondation de l’an 1838 a fait un dégât immense;
pratiquement la moitié des maisons furent démolies. Après l’inondation, des travaux de
reconstruction ont commencé avec un grand élan. Les maisons basses ont été remplacées par
des maisons à un, deux, ou trois étages, en forme de « L » ou « U ». Les bâtisseurs étaient
surtout des bourgeois récemment enrichis, notamment des manufacturiers venant d’Autriche,
d’Allemagne et de Moravie, des commerçants « grecs » (ce mot signifiant en Hongrie les
orthodoxes, c’est à dire, des Grecs, des Serbes, des Macédoniens, des Roumains et des
Valaches des Balkans), arméniens et juifs. Tous ces nouveaux venus ne pouvaient pas avoir
des terrains à construire dans la zone à l’intérieur des murs ; quant aux juifs, il n’avaient
même pas le droit de construire dans la cité. Les projets de ces nouveaux immeubles étaient
réalisés par les plus célèbres architectes et constructeurs de l’époque.
Tous les immeubles résidentiels classicistes, romanticistes ou historisants, qu’on peut
voir ou – malheureusement – on pouvait voir jusqu’à ces derniers temps dans le quartier,
étaient, pour la plupart, construits lors de l'aménagement après l’inondation, entre 1838 et
1875. Entre temps au centre du quartier encombré et peuplé de manière dense, sans espace
ouvert, un bloc d’immeubles était démoli, pour former une place publique– c’est la place
Klauzál actuelle.
4

Parallèlement avec l’intensification de l’embourgeoisement l’établissement et
l’expansion des juifs a commencé. Le fait que le quartier juif de l’époque s’est formé ici en
dehors des murs de la ville, n’était nullement fortuit. Jusqu’à l’édit de tolérance de Joseph II,
Empereur d’Autriche et Roi de la Hongrie, promulgué en 1783, les juifs n’avaient pas le droit
de franchir les murs de la ville. Avant l’édit de tolérance, même la fréquentation des environs
de la ville était interdite au juifs, à l’exception des occasions, notamment celle des foires
annuelles, auxquelles les hôteliers et les commerçants juifs avaient la permission de
participer. La foire annuelle était tenue à la place de la Nouvelle Foire (Új Vásártér),
aujourd’hui place Erzsébet. A l’angle extrême de la place de la foire, en dehors des murs, à la
partie nord-ouest de ce qui est, de nos jours, la place Madách, en face de la rue Király, s’est
formée la Foire des Juifs.
Ce n'est qu’en 1786 que la ville a donné permission, pour la première fois, à des juifs
de prendre domicile dans la ville de Pest. Étant donné que jusqu’à la promulgation de la loi
no. 29 de l’an 1840 les juifs n’avaient pas le droit de posséder des propriétés immobilières
privées, ils vivaient dans des appartements loués, louant également leurs maisons de prières.
Ce fut naturel qu’ils aient commencé à s’établir aux environs de la Foire, le long de la rue
Király et, puis, dans les rues transversales de cette rue. Au début, ils ne pouvaient louer des
chambres que dans la maison d’Orczy qui, à cette époque, comptait comme le plus grand
immeuble de la ville. Bientôt, cette maison est devenue le premier point de repère, la
« porte de débarquement » des juifs arrivant dans la grande ville de Pest pour essayer d’y
fonder leurs existences. Dans cet immense immeuble à deux cours, au style rococo, se sont
installés graduellement toutes les institutions et tous les services nécessaires à la vie juive.
Les commerçants juifs ont ouvert leurs magasins auprès de la maison d’Orczy, tout au
long de la rue Király ; ils menaient leurs négociations dans les cafés des deux premières
maisons de la rue, à savoir dans le Café Herzl et le Café Orczy. Bientôt, non seulement la rue
Király, mais tout le quartier a évolué en un important quartier commerçant. A la moitié du
19ème siècle, le quartier juif s’étendait du boulevard Károly jusqu’à l'église de Thérèseville.
La communauté juive en gagnant de nouvelles lois de liberté, allait en s’accroissant, se
fortifiant et bientôt en se divisant en plusieurs branches de la religion, construisait deux
synagogues, en dehors de celles louées dans la maison Orczy devenues trop étroites. Ce sont
les représentants de la vie religieuse du quartier juif, qui déterminent le caractère du quartier
jusqu’à nos jours. Ils ont donc construits d’abord la synagogue de la rue Dohány (1859,
Ludwig Förster) pour la communauté néologue (conservatrice), et, puis, celle de la rue
Rumbach Sebestyén (1872, Otto Wagner) pour la communauté status quo ante. Les solutions
architecturales exceptionnelles des deux synagogues ont octroyé un enchantement oriental au
quartier. C’est également de cette époque que datent les premiers passages à travers des ilôts,
qui constituaient très vite tout un dédale. Ces passages ont servi non seulement l’extension de
la vie commerciale, mais aussi leur rôle étaient souvent de donner un accès plus caché et plus
rapide aux synagogues.
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%