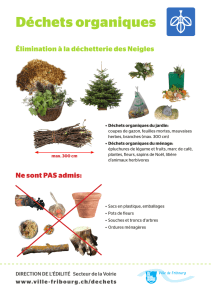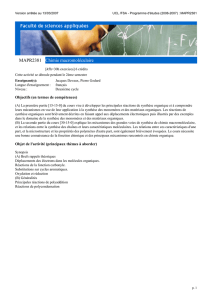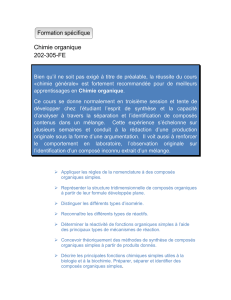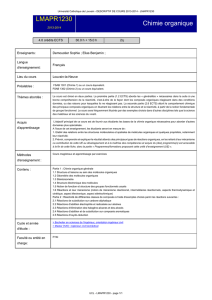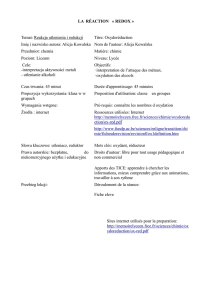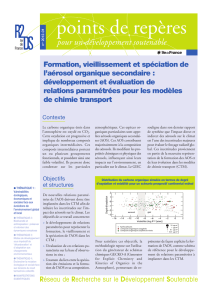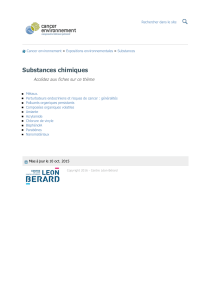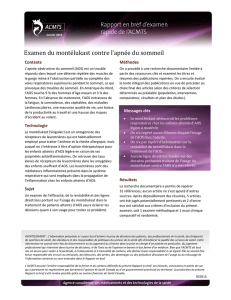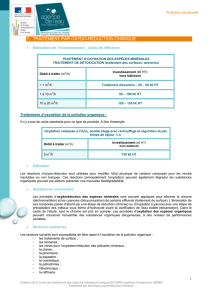Formation d`aérosols organiques secondaires lors de l

JIQA 2008 7-8 février 2008
Formation d’aérosols organiques secondaires lors de
l’oxydation de composés organiques biogéniques
N. Visez1, V. Riffault1 et A. Tomas1
1 Ecole des Mines de Douai, Département Chimie et Environnement, 941 rue Charles Bourseul, BP
10838, 59508 Douai cedex, France
L’émission d’un composé organique gazeux dans l’atmosphère est suivie, à plus ou
moins long terme, de son élimination par des phénomènes hétérogènes
(adsorption/absorption), par photodissociation ou par des réactions d’oxydation
(principalement avec l’ozone et les radicaux OH et NO3). Les produits de l’oxydation
de certains composés organiques peuvent aboutir à la formation d’aérosols
organiques secondaires (AOS). Ces particules ultra fines (de quelques nanomètres à
moins d’un micromètre) influent sur le bilan radiatif de l’atmosphère, sur la chimie
atmosphérique et sont potentiellement toxiques.
Les mécanismes de formation des AOS sont complexes et encore relativement mal
connus. L’apport de connaissances dans ce domaine est essentiel pour prédire les
quantités émises et leurs compositions et ainsi estimer leurs effets sur
l’environnement et la santé. Ces enjeux sont d’autant plus pressants que les
concentrations atmosphériques en AOS pourraient plus que doubler d’ici une
centaine d’année [1].
Dans ce sens, des travaux ont été engagés récemment au département Chimie et
Environnement de l’Ecole des Mines de Douai. Le dispositif expérimental (réacteur à
écoulement) sera décrit ainsi que les techniques analytiques employées pour
l’analyse des phases gazeuse et particulaire. Ce réacteur permet de mettre en
contact différents réactifs gazeux avec des oxydants (OH, O3 ou NOx) pour étudier la
réactivité (vitesses de réaction, mécanismes de formation des AOS…) en fonction de
différents paramètres tels que le temps de contact, la température, le degré
d’humidité ou la présence initiale de particules inorganiques.
La réaction d’ozonolyse de l’alpha-pinène (C10H16) étant largement documentée, elle
sera utilisée dans ces travaux comme réaction modèle.
Référence :
[1] Tsigaridisa et Kanakidou, Atmos. Environ. 2007, 41, 4682-4692
1
/
1
100%