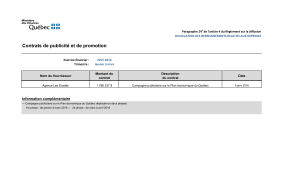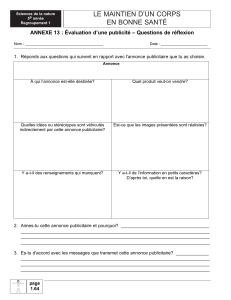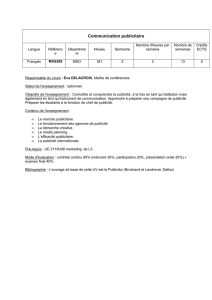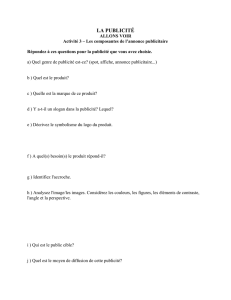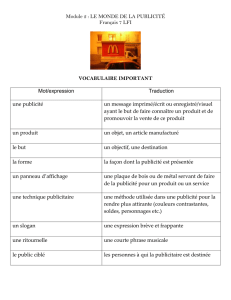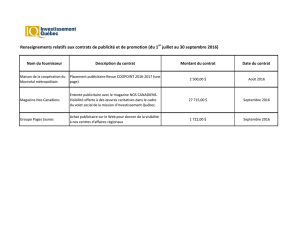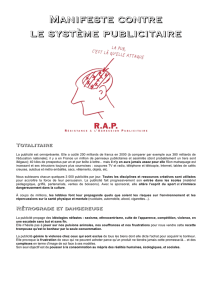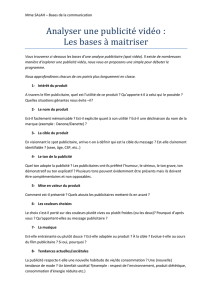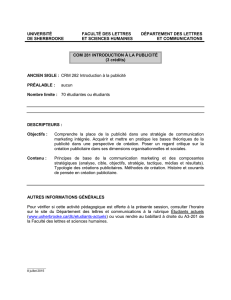ON ACHETE BIEN LES CERVEAUX

1
ON ACHETE BIEN LES CERVEAUX
Par Marie Benilde - 6 mars 2007
Les liens des régies publicitaires avec les neurosciences prouvent que la fabrication de
"cerveaux humains disponibles" chers à Patrick Le Lay, le président de TF1, est devenue une
réalité des médias. Une idéologie est à l’oeuvre: elle vise à nous rendre étrangers à nous-mêmes
pour faire de nous des cibles normées en fonction d’intérêts marketing.
Je suis l’auteur d’un livre dont vous n’entendrez probablement jamais parler dans vos journaux, à la
télévision ou même à la radio. Son nom ? On achète bien les cerveaux (édition Raisons d’agir,
2007). Il ne s’agit pas d’un opuscule tendancieux ou d’un brûlot d’extrême gauche ou d’extrême
droite. Simplement, c’est un livre qui prétend apporter une analyse critique sur un phénomène qui
rythme notre quotidien : l’omniprésence massive de la publicité et ses conséquences sur les médias.
Le titre fait bien sûr référence à la phrase prononcée en 2004 par Patrick Le Lay, le PDG de TF1, sur
le « temps de cerveau humain disponible » que le patron de la chaîne s’enorgueillit de vendre à
Coca-Cola. Je suis allée enquêter dans le cœur même de la machinerie publicitaire de la Une. Et ce
dont je me suis aperçue, c’est que la commercialisation du cerveau du téléspectateur n’est pas un
phantasme ou un abus de langage. C’est le reflet de la plus stricte vérité si l’on en croit les propos de
neurologues qui travaillent aujourd’hui pour les principaux médias, dont TF1, sur l’impact de la
publicité dans la mémoire.
Le temps n’est plus où l’on se contentait de tests et de post-tests pour prouver l’efficacité des
messages publicitaires. Face à des nouveaux médias comme Google ou Yahoo, qui proposent à
l’annonceur de payer pour chaque contact transformé en trafic et de suivre le client à la trace, les
grands médias cherchent à montrer qu’ils arrivent à pénétrer l’inconscient des consommateurs. A
l’instar des grands annonceurs américains, ils ont confié à une société spécialiste des sciences
cognitives, Impact Mémoire, le soin d’explorer ce que le cerveau retient dans la communication
publicitaire. Pour cela, les « neuromarketers » ont recours à une machine uniquement utilisée jusqu’à
présent à des fins médicales, pour détecter les tumeurs par exemple : l’imagerie à résonance
magnétique (IRM). Que disent les expériences menées en laboratoires ? Que la zone du cerveau
réactive aux images publicitaires, le cortex préfrontal médian, est associée à l’image de soi et à la
connaissance intime qu’on a de soi-même (c’est la région cérébrale qui est affectée lorsqu’il y a des
troubles de schizophrénie par exemple). En activant le cortex préfrontal médian, les neuromarketers
cherchent donc à réussir l’alchimie parfaite : l’opération qui consiste à transformer tout amour de soi
en tant que soi - le narcissisme - en amour de soi en tant qu’autre - une cible publicitaire. La
publicité vise donc à nous rendre en quelque sorte étrangers à nous-mêmes pour modeler en nous des
comportements normatifs qui épousent les intérêts des firmes commerciales.
On le sait depuis Jean Baudrillard et John Kenneth Galbraith, la société de consommation ne peut
exister sans son corollaire publicitaire. Car seule la publicité crée dans les têtes une urgence
fantasmatique et pavlovienne sans laquelle il n’est pas de tension consumériste : c’est parce que je
suis sans cesse sollicité par un univers euphorisant, rempli de symboles de bonheur, que je tends vers
la jouissance de l’acquisition matérielle. De cette tension naît un désir structurant dans la mesure où
il permet à l’individu d’exister en tant qu’homo consumans. Adhérer aux valeurs de l’imagerie
publicitaire - « On vous doit plus que la lumière », « Vous n’irez plus chez nous par hasard »,
« Parce que je le vaux bien » -, c’est communier aux nouvelles icônes des temps modernes. Il s’agit
de prendre corps dans l’espace collectif, de se transfigurer dans une identité à la fois plurielle et,
puisqu’elle s’adresse à moi en tant que cible, singulière. L’essayiste François Brune parle d’une
« volonté de saisie intégrale de l’individu dans ce qu’il a d’anonyme ». D’où un principe clé de la
domestication des esprits : chacun cherche à se ressembler en tant que tribu consommatrice. C’est en
effet parce que je renonce à mon appartenance à une identité universelle pour m’inscrire dans une
fonctionnalité « tribalisée » que j’abdique de ma citoyenneté au profit d’un label de consommateur
tel que l’entend l’ordre marchand. Ce faisant, la publicité permet la mutation d’une société de classes
vers autant de cibles qu’il y a d’intérêts et de positions économiques à défendre. Elle vise la

2
reproduction et la permanence de stéréotypes inhérents à tout message établi en fonction d’un statut
supposé sur l’échelle sociale.
Seulement, puis-je réellement me retrouver dans cette incessante musique d’ambiance que je n’ai pas
sollicitée ? Comme l’a montré Bernard Stiegler dans De la misère symbolique (éditions Galilée,
2004), « on ne peut s’aimer soi-même qu’à partir du savoir intime que l’on a de sa propre
singularité ». Or les techniques marketing, parce qu’elles me donnent à entendre et à voir des sons et
des images identiques à celles de mon voisin, me construisent une histoire qui est semblable à celle
de mes congénères. Comme tel, c’est bien à un effondrement de la conscience individuelle et à une
dissolution du désir que nous conduit l’idéologie publicitaire : « Mon passé étant de moins en moins
différent de celui des autres parce que mon passé se constitue de plus en plus dans les images et les
sons que les médias déversent dans ma conscience, mais aussi dans les objets et les rapports aux
objets que ces images me conduisent à consommer, il perd sa singularité, c’est-à-dire que je me
perds comme singularité ».( De la misère symbolique, op. cit. p. 26). Selon Bernard Stiegler, le règne
hégémonique du marché entraîne inexorablement la ruine d’un « narcissisme primordial » en ce sens
qu’il induit un « conditionnement esthétique » qui est aussi une « misère libidinale et affective ». En
s’identifiant à la cible publicitaire à laquelle il est supposé appartenir, le consommateur consent par
là même à la dissolution de son désir individuel dans un « nous » artificiel créé pour les besoins
d’édification du marché des classes dominantes.
De ce conditionnement va naître une nouvelle socialité phantasmatique qui amène le consommateur
à se sentir déterminé beaucoup moins par son groupe de classe, son origine sociale, que par des
aspirations collectives véhiculées par les médias. Ce n’est d’ailleurs pas tant des emblèmes
statutaires que cherche à promouvoir la publicité que des rapports imaginaires qui permettent à
l’individu d’exister virtuellement dans le regard de ses contemporains. Tout est prétendument
accessible, y compris le luxe, puisque je ne suis plus prisonnier de mon statut mais libéré par ma
consommation. A la vieille division archaïque entre dominants et dominés doivent venir se substituer
des communautés de désirs susceptibles de reconstruire un « nous entièrement fabriqué par le
produit ou le service » comme dit Stiegler.
L’ homo economicus est en quelque sorte consommé par ce qu’il consomme. Il se jette à corps perdu
dans l’addiction consumériste, non pas tant dans une course éperdue à l’avoir, comme on le croit
souvent, mais pour être. Car le bonheur publicitaire apporte une forme de plénitude fugace dans une
société privée de repères politiques et esthétiques. Après la fin proclamée des idéologies et
l’avènement d’une classe moyenne de plus en plus compromise par des tensions inégalitaires, il
structure notre être de façon rituelle en permettant la transfiguration d’un « je » devenu anarchique,
incontrôlé, en un « nous -cible » standardisé et resocialisé.
Créée en 1836 pour aider les journaux à mieux se vendre aux masses populaires, la publicité
s’impose aujourd’hui comme le mode de financement principal, voire exclusif, des médias à l’ère
numérique. Le consommateur accepte avec insouciance cette manne providentielle qui lui permet
d’accéder à des contenus. Mais en connaît-il vraiment le prix ? Information altérée au profit
d’intérêts économiques, positionnements éditoriaux déterminés par les perspectives de recettes des
annonceurs, campagnes véhiculant des stéréotypes sociaux... Parce qu’elle structure de façon
incontestée notre inconscient collectif, la publicité est devenue un vecteur non plus seulement de
revenus mais de sens... Les médias tendent à se transformer en zélés prédateurs d’une clientèle-proie
pour le compte de leurs principaux clients. Des neurosciences au travestissement des contenus, tout
est mis en place pour parvenir à cet objectif. Ce livre se propose d’étudier comment l’instrument
économique d’une démocratisation de l’information s’est peu à peu mué en outil politique d’une
domination économique.
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=20266
On achète bien les cerveaux. Médias et publicité, par Marie Bénilde, Raisons d’Agir, 15
février 2006, 6 euros, isbn : 978-2-912107-31-2.
1
/
2
100%