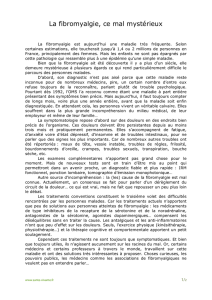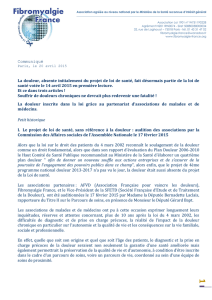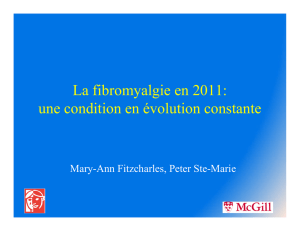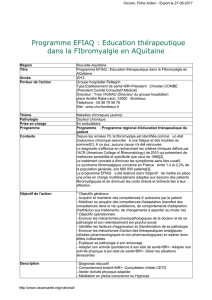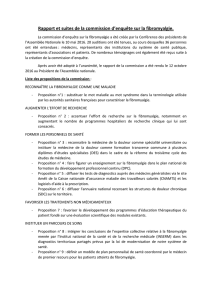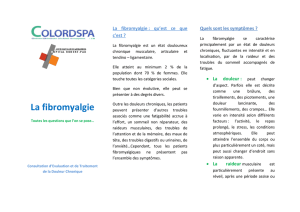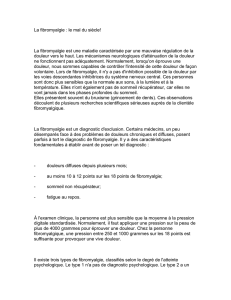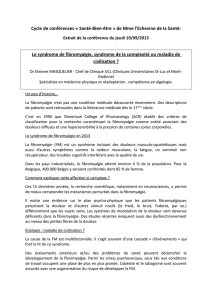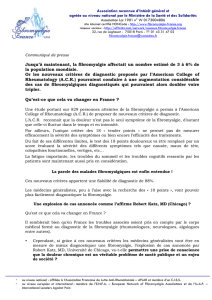Enquête directe auprès de 1993 patients fibromyalgiques

Dr M.C. JASSON - Avril 2007
1
MIEUX CONNAÎTRE ET DIAGNOSTIQUER LA FIBROMYALGIE
PAR L’ETUDE DE LA SYMPTOMATOLOGIE CLINIQUE
ENQUETE DIRECTE AUPRES DE 1993 PATIENTS FIBROMYALGIQUES
Dr Marie-Claire JASSON
Chef de Service honoraire d’Anesthésie-Réanimation
du Centre Hospitalier de Saint-Germain-en-Laye (78)
RESUME - La symptomatologie clinique de la fibromyalgie est encore insuffisamment connue. Une
enquête épidémiologique anonyme a été effectuée auprès de 1993 patients fibromyalgiques (dont 91 % de
cas féminins). Elle a mis en évidence certains points particuliers. Il existe notamment une longue période
d’errance médicale (de 2 à 15 ans et plus), durant laquelle les patients peuvent consulter jusqu’à
10 médecins et plus. D’autre part, dans 85 % des cas, il ressort que les patients ont présenté des signes
précurseurs, jusqu’alors non étudiés, avant la fibromyalgie déclarée. Dès la période d’état, on constate une
aggravation de ces signes, en plus des symptômes connus (douleurs, fatigue et troubles du sommeil) et
d’autres signes collatéraux. On note en outre une association fréquente (dans 45 % des cas) de symptômes
du Syndrome Sec de Gougerot Sjögren. Il existe un grave retentissement sur la vie familiale et socio-
professionnelle. Les thérapeutiques médicamenteuses sont décevantes, on obtient quelques succès avec les
thérapeutiques non médicamenteuses et la réadaptation fonctionnelle. Enfin, il s’avère que le profil
psychologique des patients fibromyalgiques est plus positif que généralement admis.
PRESENTATION DE LA MALADIE ET DE L’ENQUETE
La fibromyalgie, maladie douloureuse, chronique et invalidante, touche de larges tranches d’âge de la
population, féminine surtout. Sa fréquence est importante (de 1 à 2 %). Elle se caractérise par des douleurs
musculo-tendineuses diffuses, associées à une fatigue et à de nombreux symptômes collatéraux affectant
diverses fonctions, cités dans les publications, mais mal connus du corps médical.
Bien qu’officiellement classée par l’Organisation Mondiale de la Santé (n° M 79.0) depuis 1992,
la fibromyalgie est encore considérée dans notre pays avec réserve.
Cette méconnaissance, le scepticisme - et parfois le rejet - du corps médical conduisent à une situation
complexe, car le seul examen vraiment caractéristique est la recherche des points musculo-tendineux
douloureux (test de l’American College of Rheumatology) ; les malades ne présentent pas de perturbations
physico-chimiques ou d’examens médico-techniques caractéristiques. Pour ces raisons, on observe souvent
une inflation de bilans lourds, d’interventions chirurgicales inutiles, de traitements inappropriés.
Le diagnostic est donc soit retardé (parfois de plusieurs années), soit erroné, soit tourné à tort vers la
psychiatrie. De plus, il n’existe pas de thérapeutiques vraiment efficaces actuellement, seulement des
palliatifs.
Dans le but d’améliorer les connaissances cliniques sur la fibromyalgie, et donc la prise en
charge, une enquête épidémiologique massive a été menée entre 2001 et 2005 par le Dr Marie-
Claire Jasson, Chef de Service honoraire d’Anesthésie-Réanimation, directement auprès de
fibromyalgiques tous diagnostiqués par un médecin (1993 cas). Ces patients ont été recrutés soit
grâce à des médecins rhumatologues, soit avec l’active collaboration des associations de
fibromyalgiques sur l’ensemble du territoire métropolitain, soit à la suite d’informations diffusées
par les médias.
Issu d’une collaboration entre médecins et malades, un questionnaire long et détaillé
(327 réponses « à cocher ») a été conçu afin d’établir des statistiques sur les fibromyalgiques en
France actuellement. Il permet de mettre en évidence : les caractères socio-démographiques, les
habitudes de vie, les antécédent médico-chirurgicaux, l’activité physique, les signes « précurseurs »
(non recherchés, mais souvent évidents), le nombre de praticiens consultés, l’établissement du
diagnostic, l’état des patients, les résultats des traitements médicamenteux et non médicamenteux,
les répercussions (souvent très importantes) sur la vie professionnelle et familiale, l’évolution de la
maladie, les difficultés de la prise en charge médico-sociale.

Dr M.C. JASSON - Avril 2007
2
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
De 10 à 19 ans
De 20 à 29 ans
De 30 à 39 ans
De 40 à 49 ans
De 50 à 59 ans
De 60 à 69 ans
De 70 à 79 ans
De 80 à 89 ans
CRITERES GENERAUX
Les patients sont en majorité de sexe féminin (1811 femmes, soit 91 %), en minorité de sexe
masculin (177 hommes, soit 9 %), sur 1988 réponses.
La répartition géographique des patients montre que l’enquête couvre le territoire
métropolitain de façon homogène, avec en moyenne 3.7 % de réponses par région.
On note toutefois un nombre plus important dans le quart Nord Ouest (Bretagne,
Normandie, Pays de Loire, Ile de France, Centre) : sur 1921 répondants, 856 soit 44.6 %. La
prévalence des réponses en Pays de Loire est probablement due à l’investissement particulier des
CHU et des associations de fibromyalgiques, notamment dans la diffusion de l’enquête. Les autres
patients se répartissent comme suit : dans le quart Nord Est (Picardie, Nord Pas de Calais,
Champagne Ardennes, Lorraine, Alsace, Franche-Comté, Bourgogne), 433 patients, soit 22.5 %.
Dans le quart Sud Ouest (Poitou Charentes, Aquitaine, Midi Pyrénées, Languedoc Roussillon,
Limousin, Auvergne), 388 patients, soit 20.2 %. Dans le quart Sud Est (Rhône Alpes, Provence
Alpes Côte d’Azur, Corse), 244 patients, soit 12.7 %.
La pyramide des âges (au moment de la majorité des réponses à l’enquête, arrêté à fin 2003)
a été établie sur 9 tranches d’âge. Sur 1972 répondants, on note une majorité de réponses
concernant la tranche d’âge de 50 à 59 ans, avec un pic entre 53 et 55 ans (311 cas, soit 15.8 %).
Certains cas familiaux existent (3 %). D’autres cas sont probables, au dire de la famille, chez
les ascendants ou chez des parents proches.
TABLEAU - Fibromyalgie : pyramide des âges par tranche de 10 ans
A B C D E F G H
- Non précisé : 21 (1.1 %) sur 1993 cas au total -
La situation actuelle des patient se répartit comme suit (sur 1993 cas) :
34 % (679 cas) sont en invalidité ou en arrêt de travail
32 % (628 cas) sont actifs
18 % (363 cas) sont retraités
9 % (184 cas) sont chômeurs
1 % (23 cas) sont étudiants ou élèves
6 % (116 cas) non précisé.
On note la plus forte proportion de patients reconnus dans l’incapacité de travailler en
raison de leur fibromyalgie.
Colonne
Tranche d’âge Nombre de cas
sur 1972 répondants
Pourcentage
De 0 à 9 ans 0 0 %
A De 10 à 19 ans 5 0.3 %
B De 20 à 29 ans 37 1.9 %
C De 30 à 39 ans 147 7.4 %
D De 40 à 49 ans 487 24.7 %
E De 50 à 59 ans 917 46.5 %
F De 60 à 69 ans 267 13.5 %
G De 70 à 79 ans 102 5.2 %
H De 80 à 89 ans 10 0.5 %
Total 1972 100 %

Dr M.C. JASSON - Avril 2007
3
L’origine socio-professionnelle des patients se répartit comme suit (sur 1993 cas) :
37 % (733 cas) sont employés (y compris personnels de services)
21 % (426 cas) sont cadres moyens ou techniciens
9 % (181 cas) sont cadres supérieurs ou enseignants
6 % (111 cas) sont ouvriers (y compris salariés agricoles)
9 % (176 cas) sont sans profession
18 % (366 cas) ont d’autres professions ou non précisé.
La durée de la maladie est évaluée sur quatre périodes :
32 % (638 cas) ont la fibromyalgie (déclarée) depuis moins de 5 ans
26 % (518 cas) l’ont depuis plus de 5 ans
17 % (337 cas) l’ont depuis plus de 10 ans
25 % (494 cas) l’ont depuis plus de 15 ans.
ANTECEDENTS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX
La proportion des antécédents médicaux et chirurgicaux ne semble pas très différente de
celle de la population. On note cependant une certaine prévalence des antécédents
rhumatologiques (995 cas sur 1993, soit 50 %), digestifs (897 cas, soit 45 %), urinaires (590 cas, soit
30 %), dépressifs (786 cas, soit 39 %).
Certains de ces antécédents déclarés étaient peut-être déjà des signes « précurseurs » de la
fibromyalgie, signalés dans la presque totalité des cas (85 %). D’autre part, le nombre de
« dépressifs » comprend peut-être le très grand nombre de diagnostics de « dépression » posés en
général en premier devant le consultant fibromyalgique, parfois des années auparavant.
SIGNES PRECURSEURS DE LA FIBROMYALGIE
Un des objectifs principaux de cette enquête épidémiologique est de mettre en évidence ces
troubles inconfortables, mais non vraiment douloureux, ressentis par les répondants avant
l’apparition de la fibromyalgie déclarée (qui, elle, se caractérise par des douleurs importantes, de la
fatigue et d’autres symptômes associés). Ces « patraqueries » sont très rarement signalés au
médecin par le patient.
Ces signes, non recherchés actuellement lors de l’interrogatoire des patients, sont pourtant
présents dans plus de 85 % des cas ; le questionnaire a été établi par un médecin en collaboration
avec des fibromyalgiques. C’est pourquoi il semble indispensable de préciser le caractère et la
fréquence de l’ensemble de ces signes précurseurs (voir tableau ci-dessous), car ces troubles ont pu
induire, durant l’errance médicale, des diagnostics erronés.
Ces signes persisteront, aggravés, et accompagneront la fibromyalgie déclarée. Leur étude
peut permettre au médecin de poser plus rapidement un diagnostic de fibromyalgie, car ils sont
ressentis parfois pendant des années avant le déclenchement des douleurs proprement dites de la
fibromyalgie déclarée.

Dr M.C. JASSON - Avril 2007
4
0
100
200
300
400
De 0 à 2 ans
De 2 à 5 ans
De 5 à 10 ans
De 10 à 15 ans
De 15 à 20 ans
De 20 à 30 ans
De 30 à 40 ans
De 40 à 50 ans
Plus de 50 ans
TABLEAU - Fibromyalgie : nombre d’années de signes précurseurs avant la fibromyalgie déclarée
A B C D E F G H I
- Non précisé : 274 (13.7 %) sur 1993 cas au total -
TABLEAU - Fibromyalgie : descriptif des signes précurseurs
Description des signes précurseurs
Nombre
de cas
(sur 1993)
Pourcentage
Courbatures « exagérées » en intensité, en durée après un effort
inhabituel, même modéré (activité sportive, jardinage…) 1682 84 %
Sensation de fatigue musculaire non justifiée
Aux jambes en montant un escalier
En se coiffant, bras en l’air
Gestes répétitifs professionnels ou ménagers
1703
1575
1732
85 %
79 %
87 %
Fatigue anormale des jambes à la marche, en bicyclette 1493 75 %
Sensations douloureuses ou désagréables à la pression brève des
muscles durant 5 à 10 secondes (muscles intercostaux sous la douche,
cou, épaules, membres, face)
1598 80 %
Inconfort, douleur au niveau des fesses (sur un siège dur, sur une selle
de bicyclette, durant un long parcours en voiture ou en train) 1651 83 %
Inconfort au niveau des pieds, sans anomalies (toutes les chaussures
font mal)
1213 61 %
Station debout immobile rapidement pénible 1748 88 %
Intolérance au froid (frilosité inhabituelle, pieds et mains « glacés ») 1615 81 %
Intolérance à la chaleur (fatigue intense en été, épisodes fréquents de
chaleur intense et généralisée, chaleur « à l’intérieur du corps »,
modification de l’habillement)
1219 61 %
Troubles digestifs
Brûlures gastriques
Reflux gastro-oesophagien acide
Eructations après les repas
Ballonnements, côlon irritable
Diarrhée ou constipation
Troubles de l’appétit
Amaigrissement
1013
923
536
1447
1408
675
340
51 %
46 %
27 %
73 %
71 %
34 %
17 %
Vessie irritable, besoin impérieux d’uriner 1067 54 %
Fourmillements (apparition plus tardive) généralisés ou localisés,
avec chaleur locale 1278 64 %
Impatience dans les membres 1222 61 %
Troubles du sommeil
Difficultés d’endormissement
Réveils fréquents
Réveil matinal pénible avec augmentation des signes
Sommeil non réparateur
Somnolence gênante dans la journée
1284
1506
1570
1645
1154
64 %
76 %
79 %
83 %
58 %
Colonne
Nombre d’années
de signes précurseurs
Nombre de cas
sur 1719 répondants
Pourcentage
A De 0 à 2 ans 341 19.8 %
B De 2 à 5 ans 382 22.2 %
C De 5 à 10 ans 372 21.6 %
D De 10 à 15 ans 184 10.7 %
E De 15 à 20 ans 153 8.9 %
F De 20 à 30 ans 179 10.4 %
G De 30 à 40 ans 76 4.4 %
H De 40 à 50 ans 25 1.5 %
I Plus de 50 ans 7 0.5 %
TOTAL 1719 100 %

Dr M.C. JASSON - Avril 2007
5
PERIODE D’ETAT DE LA FIBROMYALGIE
Cette période est caractérisée principalement par l’apparition des douleurs, raideurs et de la
fatigue.
Les douleurs sont pratiquement toujours généralisées, mais avec certaines localisations plus
marquées :
dans 75 % des cas (1503), surtout au niveau du cou, des épaules et des bras
dans 67 % des cas (1339), surtout au niveau du bassin et des jambes
dans 38 % des cas (757), au niveau de la face : articulation maxillaire, crispations
dans 33 % des cas (659), « mal à toutes les dents » principalement le matin, signe curieusement
assez particulier à la fibromyalgie.
Les douleurs peuvent aussi être erratiques et totalement imprévisibles.
S’y ajoutent, dans 74 % des cas (1479) des élancements brefs et violents durant quelques
secondes, en sus des douleurs de base « n’importe où, n’importe quand », signe également
particulier, très bien décrit par les fibromyalgiques.
Les caractéristiques des douleurs sont multiples :
dans 66 % des cas (1317), elles sont franches
dans 84 % des cas (1683), il s’agit de raideurs douloureuses
dans 46 % des cas (909), de fourmillements
dans 61 % des cas (1215), de pesanteur
dans 69 % des cas (1370), de sensations de brûlure
dans 42 % des cas (842), de sensations de broiement
dans 32 % des cas (645), de sensations de pulsation.
On notera que les réponses sont multiples.
Les douleurs et raideurs matinales sont lentes à céder dans 74 % des cas (1473 cas). Elles
diminuent en période d’activité modérée, mais peuvent augmenter après un repos prolongé dans
46 % des cas (914 cas).
Leur périodicité reste très variable dans la journée, dans la semaine, par crises plus aigues
selon la météo dans 51 % des cas (1014 cas).
Lors de la période d’état sont également recherchés, exclusivement par un médecin, les
points sensibles musculo-tendineux de la fibromyalgie, établis selon les critères de l’A.C.R.
(American College of Rheumatology). Dans le cadre de l’enquête, sur 1993 cas :
Dans 87 % des cas (1743), ils ont été recherchés : ils sont alors douloureux dans 97 % des cas (1690),
et non douloureux dans 1 % des cas (23) ; non précisé dans 2 % des cas.
Dans 9 % des cas (189), ils n’ont pas été recherchés ; non précisé dans 4 % des cas.
Dans les cas douteux, les points sensibles sont-ils non douloureux, ou non remarqués par le
patient lors de l’examen, ou non recherchés de façon efficace ?
La fatigue, autre caractéristique de la fibromyalgie, fait l’objet de réponses multiples.
Concernant sa périodicité :
dans 73 % des cas (1447), elle est continuelle
dans 37 % des cas (732), elle se manifeste par crises dans la journée
dans 26 % des cas (510), par crises de quelques jours.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%