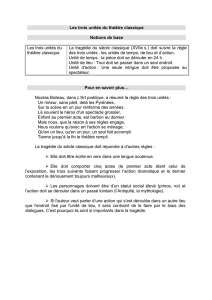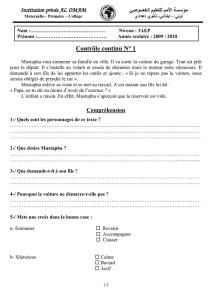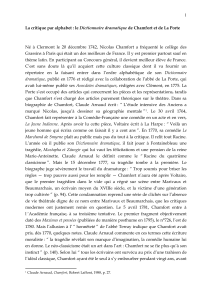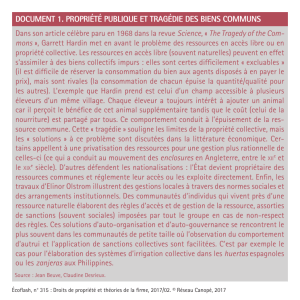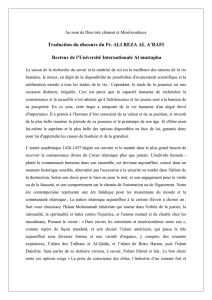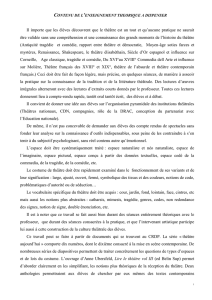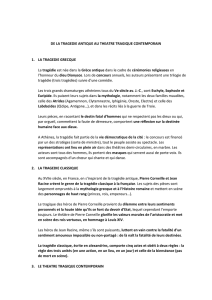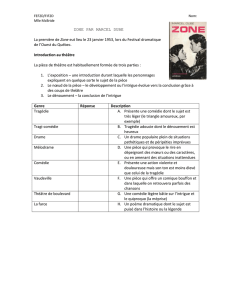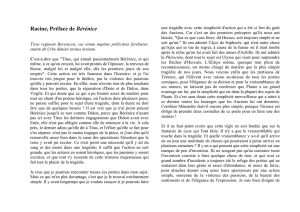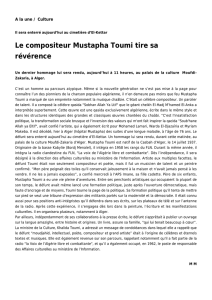La figure du « turc généreux » dans le théâtre de - UMR Lire

La figure du « turc généreux » dans le théâtre de Chamforti
« La vraie Turquie d’Europe, c’est la France » affirme Chamfort dans Produits de la
civilisation perfectionnéeii. Si l’Afrique demeure, dans une large mesure, terra incognita de la
philosophie des Lumièresiii, tel n’est pas le cas de l’Orient musulman voisin, et en particulier
de l’Empire ottoman, qui fascine la France absolutiste dès le règne de Louis XIViv au moins
autant qu’il l’effraie (les guerres ottomanes ne sont pas si lointaines, puisque le siège de
Vienne remonte seulement à 1683 et que la piraterie barbaresque prospère pour longtemps
encore tout autour du bassin méditerranéen, attisant une des grandes peurs récurrentes de
l’Âge classiquev). Les efforts de Colbert pour commercer avec la Sublime Portevi, les
ambassades réciproques, ou encore les récits de voyage se succèdent. Négociants,
scientifiques, ambassadeurs, administrateurs, militaires ou encore simples voyageursvii,
concourent à rapporter ou faire connaître toutes sortes de textesviii et d’objets destinés à
alimenter les cabinets de curiosités, mais aussi à produire un vaste corpus de textes à la valeur
et à la fiabilité variables, qui participent d’une certaine forme d’imaginaire oriental dans
l’opinion cultivée et nourrissent la fiction littéraireix. « La science des langues orientales et les
voyages qui ont été faits ont appris qu’il y a de la valeur et de la politesse partout », écrit
Lamarre dans son Histoire […] des Maures (1708), montrant le mélange de relativisme et
d’ethnocentrisme qui préside à la vision occidentale de l’Orient à la fin du XVIIe et tout au
cours du XVIIIe siècles. Révélateur des contradictions (c’est déjà le principe du Persan des
Lettres persanes de Montesquieu ou du Siamois des Amusements sérieux et comiques de
Dufresny), mais surtout des potentialités d’une Europe éclairée, le « Levant » (c’est seulement
au XIXe siècle que la région prendra l’appellation d’« Orient ») est à l’époque de mieux en
mieux connu, grâce aux contributions, parfois sujettes à caution, de Tavernier, Bernier,
Chardin et, surtout, Galland.
Dans le même temps, on assiste à une mutation importante dans l’histoire culturelle,
qui passe par la vulgarisation du discours savant (premier orientalisme des sciences
religieuses), relayé et amplifié par les arts. Dans la seconde moitié du règne de Louis XIV,
Lettres édifiantes et curieuses de missionnaires jésuites, relations de voyagex, souvent
richement illustréesxi, et travaux à caractère historique, tels que L’Histoire de l’Empire
ottoman de Dimitri Cantemir, prince de Moldavie (traduit de l’anglais par Prévost en 1740),
apportent un second souffle au mythe orientaliste, profondément enraciné dans l’inconscient
culturel occidental. Ainsi de contributions essentielles comme la Bibliothèque orientale
(1697) de Barthélemy d’Herbelot : elle est l’indice d’un recentrement sur l’Orient islamique,
envisagé depuis les origines arabes jusqu’aux civilisations turque, persane ou encore,
mongole, nettement distincte de la Chine, du Japon et d’une grande partie de l’Asie Mineure,
et marque un intérêt nouveau pour un monde arabo-musulman enfin considéré comme
cohérent, à défaut d’être dépouillé de stéréotypes. Boulainvilliers et sa Vie de Mahomed avec
des réflexions sur la religion mahométane, & les coutumes des musulmans (1730) peut à bon
droit être considéré comme une exception à la règle, dans la mesure où sa représentation
tranche nettement avec la vision dualiste inspirée par le christianisme que l’on trouve parfois
chez d’Herbelot (double face, à la fois « ingénieuse » et « sanguinaire », de la civilisation
arabo-persane, dont il offre pourtant par ailleurs une perception fine et informée)xii et s’inscrit
très tôt dans une forme de réhabilitation des Arabes, considérés pour leurs qualités morales.
Rompant avec cette ambivalence traditionnelle de la figure mauresque ou barbaresque, il
propose ainsi un contre-modèle de civilisation, l’associant aux valeurs de l’homme et de la
nature, lui donnant ses lettres de noblesse dans la hiérarchie implicite de l’esprit des peuples.
L’esprit des Lumières, en s’affranchissant progressivement d’une haine de l’islam qui
remonte aux croisades et à l’invasion mauresque, longtemps entretenue par la propagande

ecclésiastique, développe ainsi, à la faveur du recul de la menace musulmane sur le territoire
européen, dès la fin du XVIIe siècle, un regard nouveau, empreint de curiosité et
d’appréhension mêlées, sur ce monde arabe méconnu, et en particulier sur l’empire ottoman.
Ainsi de Richard Simon qui dresse, dans son Histoire critique de la créance et des coutumes
des Nations du Levant (1694), chapitre XV, un exposé « de la créance et des coutumes des
Mahométans », « afin que ceux qui voyagent en Levant se défassent de quantité de préjugés
contre cette religion » ; mais aussi, des récits de voyages, tels que Le Voyage de l’Arabie
heureuse, par l’océan oriental, fait par les français pour la première fois dans les années
1708, 1709, 1710 (1716) de Jean de La Roque ; ou encore, des traductions du Coran, qui se
démarquent nettement de la propagande cléricale à l’encontre du Prophète et de la religion
musulmane ; sans compter l’adaptation « belle infidèle » de contes orientaux des Mille et Une
Nuits par Antoine Galland, imprimés en français entre 1704 et 1717 (date de publication des
volumes XI et XII)xiii, constamment réédités ensuite, contribuant à créer, dans l’Europe
entière, la vogue du « conte arabe » et, à travers elle, la diffusion des traditions de la culture
orale populaire des conteurs au sein de la République des lettres.
Pendant que les ouvrages d’histoire et d’érudition se multiplient au sujet de l’islam, et
qu’un certain nombre d’écrits politiques persistent à prendre cette religion perçue comme
concurrente et même, adversaire du Christianisme pour contre-modèle répulsif, non sans
certaines ambiguïtésxiv, émerge donc progressivement un mouvement contraire des idées et
des représentations : bien souvent, on rend justice à une tolérance musulmane qui accable de
sa magnanimité le fanatisme chrétien, comme dans L’Essai sur les mœurs où Voltaire loue la
tolérance du règne des Turcs et réhabilite en partie au moins leurs croyances, en vertu de leur
incitation à la paix des religions (on pense également, bien entendu, au scandale de son
Mahomet). Certains vont même, comme le marquis Boyer d’Argens dans ses Lettres juives
(1736), jusqu’à voir dans l’islam modéré une forme de religion naturelle proche du déisme et
partant, compatible avec l’esprit des Lumières.
Le courant « orientaliste », envisagé sur le double plan scientifique et artistique, dont
on place généralement la naissance à la fin du XVIIe siècle et l’épanouissement au cours du
XVIIIe sièclexv, relève d’enjeux idéologiques majeurs auxquels le théâtre de Chamfort, dont il
est question ici, n’échappe qu’en partie : il participe, sous les formes d’un « orientalisme
latent » et d’un « orientalisme manifeste », d’une construction socioculturelle spéculaire qui
en dit plus long sur la cohérence d’un regard projeté par l’Occident sur cet ailleurs
fantasmatique que sur la situation historique effective de cette aire géographique et
culturellexvi. Il est donc, à proprement parler, un élément à part entière du dispositif de
représentation, de discours, de savoir, autrement dit une projection imaginaire collective,
historiquement datée et idéologiquement construite qu’il convient aujourd’hui de réexaminer
à nouveaux frais... Forme privilégiée d’un regard indirect sur soi, il permet de construire
tantôt des modèles projectifs (terre de toutes les voluptés, véritable paradis sensuel, même si
le plus souvent déceptif, de Crébillonxvii et du courant libertin), tantôt répulsifs (sérail impur
du despotisme selon Montesquieu et un certain courant de la philosophie politiquexviii ; mythe
du bédouin…). Ainsi, la matière orientale est-elle prise dans une série de contradictions
inéluctables et de représentations contradictoires : Orient-miroir qui nous renvoie notre image
inversée ou déformée de nous-mêmes, altérité de proximité, constitutive d’une certaine
identité nationale, étape fondamentale dans la naissance de la conscience occidentale, à
travers un double mouvement contradictoire de dépréciation (territoire de tous les maléfices,
fascination perverse pour la flagellation et les châtiments corporels) et d’appréciation tantôt
religieuse (le paradis est situé en Orient, terre du Sauveur) tantôt païenne, voire franchement
paillarde (terre de tous les délices, de toutes les rêveries érotiques)… l’Orient, cet empire du
centre, situé à mi chemin entre les Indes orientales et les Indes occidentales, si loin et si
proche à la fois de l’Europe avec laquelle il a eu, pendant longtemps, destin lié, apporte bien

malgré lui une contribution majeure à la volonté de puissance et à l’ethnocentrisme
occidentaux.
L’empire ottoman occupe une place de choix dans une telle configuration à la fois
scientifique, esthétique et idéologique. En 1770, moment de la création du Marchand de
Smyrne, la Turquie ottomane retrouve un regain d’actualité : elle est en proie aux pressions
internes des revendications autonomistes (Égypte puis Syrie) et externes (Autriche, Russie).
L’islam est précisément, au temps des Lumières, essentiellement associé à l’Empire ottoman,
qui domine le monde arabe et la Mer Méditerranée dans la vision européenne. Un des points
de cristallisation de cet imaginaire, véhiculé et relayé dans la culture populaire par l’Église
est, précisément, le topos récurrent des pirates barbaresquesxix qui réduisent en esclavage les
chrétiens et les forcent à se convertir sous la menace, à mourir ou à alimenter les marchés
d’esclaves de l’Afrique du Nordxx. On reconnaît là, trait pour trait, le fond du Marchand de
Smyrne. Un autre topos récurrent est celui de l’itinérance : souvent associé à l’imaginaire
fantasmatique de la razzia, du fanatisme et du nomadisme, le peuple des Bédouins est en effet
considéré par une grande partie des hommes de Lettres du siècle des Lumières comme
l’envers du monde civilisé, particulièrement dans l’Histoire naturelle de Buffon et dans
l’Encyclopédiexxi.
Ici comme ailleurs, la littérature de voyage évolue progressivement de la perspective
symbolique du voyage initiatique à la construction d’un véritable discours de savoir, sinon
anthropologique, du moins ethnographique, dont les présupposés idéologiques sont lourds de
signification. Antoine Galland, dans Smyrne ancienne et moderne (1678) et dans Voyage au
Levant, montre très bien ce changement de regard, entre érudition et ethnographie, qu’il est
bien à même de développer, grâce à sa connaissance approfondie des langues parlées dans la
région (grec moderne, arabe, persan, turc)xxii. La quatrième partie de son manuscrit, Smyrne
ancienne et moderne, est particulièrement significative. Il y établit, à l’aide d’aphorismes, une
analyse comparée des mœurs et coutumes des Turcs et des Européens, envisagées sous des
angles divers et réparties en rubriques : l’habillement, les pratiques alimentaires, les femmes,
la literie, l’équitation, les pratiques culturelles, l’enseignement, les chiens, les jardins, les
voyages, les pratiques de la vie quotidienne, le calendrier, les pratiques mortuaires, la justice,
le souverain, la médecine, la musique, la maison ou encore, l’armée… On peut lire, au seuil
de ce relevé méticuleux des « aphorismes ou […] mœurs des Turcs comparées à celles des
Français », un avertissement explicite quant à la disposition d’esprit de l’auteur : « Vous
verrez les mœurs et les façons de faire de cette nation opposées aux nôtres, article par article,
et vous serez étonnés comment les hommes peuvent avoir si peu de ressemblance les uns aux
autres ».
Le théâtre de Chamfort est emblématique à la fois des idées reçues de la littérature
viatique concernant l’empire ottoman et de la volonté de les dépasser, en partie au moins.
Aussi bien dans Mustapha et Zéangir que, de façon plus complexe, dans Le Marchand de
Smyrne, il joue sur ces stéréotypes de l’esprit des peuples, sans pour autant y échapper
totalement, révélant par l’écriture les ambivalences du motif oriental, mais aussi l’émergence
d’une figure nouvelle dans le théâtre et la pensée des Lumières : celle du « généreux
musulman ».
Sébastien Roch Nicolas, dit Chamfort (1741-1794) est aujourd’hui connu comme le
dernier des moralistes français du siècle des Lumières, auteur de maximes et de discours sur
Molière et La Fontaine qui lui valurent un siège à l’Académie françaisexxiii. Mais on a oublié
que cet auteur, saluée par Albert Camus et Jean Cocteau pour sa modernité, a également été
l’un des dramaturges les plus célèbres de son temps, offrant notamment à la Comédie-
Française deux de ses plus gros succès, très souvent repris pendant la Révolution française,
dont il sera pourtant la victime – il se suicidera, pour ne pas tomber aux mains de plus
radicaux que lui. Du moraliste, ce théâtre a conservé à la fois l’acuité d’un regard critique

sans concession et la précision d’une écriture sans fioritures d’une grande précision, tout en
développant une dramaturgie à la fois représentative de son temps et d’une grande originalité.
Dans la droite ligne de la refonte du « genre dramatique sérieux » dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle, ce théâtre met en scène une forme nouvelle de sensibilité et interroge avec force
les grandes questions sociales, politiques et philosophiques de son temps : état de nature,
injustice sociale, statut de la femme, esclavage, gouvernement juste, contact entre
civilisations, place de l’argent dans les rapports sociaux…
Chamfort est bien loin de partager les solides certitudes d’un Occident peu enclin à
s’appliquer les préceptes qu’il prétend imposer au monde. Ainsi, dans Le Marchand de
Smyrne, fait-il dire à Kaled, marchand d’esclaves européens : « Que veut-il donc dire ? Ne
vendez-vous pas des Nègres ? Eh bien ! moi, je vous vends… N’est-ce pas la même chose ? Il
n’y a jamais que la différence du blanc au noir » (scène VIII). Dans Mustapha et Zéangir,
c’est de la bouche du Sultan ottoman Soliman lui-même que vient la satire à peine voilée et le
procédé d’ironie visant les abus de la monarchie absolue occidentale, qui résonne comme un
précepte de philosophie politique et une mise en garde, en comparaison du despotisme
oriental :
Monarques des chrétiens, que je vous porte envie !
Moins craints et plus chéris, vous êtes plus heureux.
Vous voyez de vos lois vos peuples amoureux
Joindre un plus doux hommage à leur obéissance ;
Ou, si quelque coupable a besoin d’indulgence,
Vos cœurs à la pitié peuvent s’abandonner ;
Et, sans effroi du moins, vous pouvez pardonner.
(Acte IV, scène 3)
L’empire ottoman est donc bien placée au cœur de l’œuvre dramatique du moraliste,
puisqu’il lui consacre deux de ses trois principales pièces, une comédie, Le Marchand de
Smyrne (1770) et une tragédie, Mustapha et Zéangir (1776), qui amplifie la figure du « turc
généreux » déjà éprouvée dans la pièce précédente. Les deux œuvres participent d’un même
projet indissociablement esthétique et idéologique, qui lui-même fait écho aux écrits du
moraliste, publiés à titre posthume.
Le marchand de Smyrne, ou l’émergence de la figure du « turc généreux »
C’est la plus « moliéresque » des œuvres de Chamfort. L’auteur vient d’écrire son
Éloge de Molière et partant, se positionner dans le champ littéraire, en régler ses comptes avec
la comédie classique, dans une optique très rousseauiste, dénonçant le mélange des
conditions, l’absence de « toute morale » et de « toute sensibilité » de la jeunesse, mais aussi
son conformisme (ce « souci d’être comme tout le monde »)xxiv. Sa comédie programmatique
se situe clairement dans une forme de néo-classicisme dont il espère tirer avantage et qui lui
vaudra effectivement, mais un peu plus tard, lorsqu’il reprendra le filon orientaliste dans sa
tragédie de 1777, Mustapha et Zéangir, d’être comparé à Racine, avant de renoncer au
théâtre : « Prenons exemple sur les héros et les génies du XVIIe siècle. Luttons contre le
déclin du caractère et la civilisation de l’instant. Rendons notre siècle majeur si nous ne
voulons finir en auteurs mineurs »… Particulièrement occupé, mais conscient de l’importance
de sa tentative, il diffère, pour la réaliser, un projet de tragédie (peut-être l’embryon de
Mustapha et Zéangir, qui relève, sur un autre mode, du même type de « turquerie » et fait
pleurer Marie-Antoinette mais aussi le Roi)xxv, confiant non sans provocation à Thomas, qui
lui conseille de terminer plutôt sa tragédie, qu’« il est doux de devenir immortel en riant ». Si
La Jeune Indienne, pièce sensible, l’avait fait connaître à 31 ans, il attend maintenant la

consécration du Marchand de Smyrne, son pendant comique. Écrite en quelques mois, la
pièce est en effet couronnée de succès, mais s’attire les foudres de la critique littéraire. C’est
pourtant l’occasion pour l’auteur d’affiner sa dramaturgie et de prendre position non
seulement par rapport à l’héritage classique, avec lequel il rompt en partie, mais encore par
rapport à la refondation en cours du genre dramatique sérieux, avec lequel il marque ses
distances, tout en subissant son influence.
La première entrée des Indes galantes de Fuzelier, sur une musique de Jean-Philippe
Rameau (1735), s’intitule Le Turc généreuxxxvi. Elle s’inspire d’une histoire racontée dans le
Mercure de Francexxvii, mais innove dans la manière de présenter au public occidental l’image
du souverain mahométan. Abandonnant le stéréotype du sultan qui règne férocement sur un
sérail de prisonnières arrachées à leur famille par les corsaires et livrées aux désirs d’un
maître inhumain, Fuzelier présente une des premières figures de turc généreux, comme le sera
plus tard le sultan de Mozart dans L’Enlèvement au sérail. Chamfort, sur le même mode, et
dans la lignée du dernier épisode de l’histoire de Zéïla, traitée par Dorat, s’inspire aussi du
récit de la vieille qui, dans Candide, de Voltaire, raconte ses tribulations d’esclave, vendue à
Alexandrie, puis à Smyrne et enfin à Constantinople. Smyrne est réputée à l’époque comme la
plaque tournante d’un fructueux commerce, port de mouillage des corsaires qui ont pour
habitude de se débarrasser des conquêtes et prises de guerre de la course sans craindre les
poursuites.
Le Marchand de Smyrne raconte, sur fond de trafic d’esclaves, de piraterie, de récits
de voyages et d’aventures, dans le décor exotique d’un Moyen-Orient fort en vogue, la façon
dont un riche musulman sauver de l’esclavage, par une succession de hasards heureux, un
jeune aristocrate chrétien qui lui avait précisément rendu le même service dans des
circonstances similaires quelque temps auparavant, cependant que sa femme sauve, dans les
mêmes conditions, l’amante du jeune homme. Une façon d’analyser les relations entre
civilisations orientale et européenne, musulmane et chrétienne, et de militer en faveur de
l’assistance mutuelle des peuples et de la solidarité des hommes, au-delà des différences
sociales et culturelles.
La pièce mérite sa longue carrière théâtrale, notamment à l’époque révolutionnaire, sur
la scène patriotique du Théâtre de la République, dominé par Talma et Dugazon. L’Orient sert
habilement de couverture à une satire mordante qui touche au racisme et aux inégalités
sociales. La bonté, la tolérance religieuse et la reconnaissance servent de ressort à l’intrigue,
pudiquement recouverte d’un voile d’exotisme fort au goût du jour et dans l’esprit du temps.
L’esclavage est ouvertement mis en cause, et avec lui le honteux commerce que certains font
de leurs semblables. Sous l’aimable badinage d’une comédie spirituelle et joliment écrite
surgissent quelques idées fortes dont la moindre n’est pas celle qu’exprime le marchand
d’esclaves devant la réprobation du Français : « Que veut-il donc dire ? Ne vendez-vous pas
des nègres ? Eh bien ! moi, je vous vends. N’est-ce pas la même chose ? Il n’y a jamais que la
différence du blanc au noir ! » (Scène 8).
Écrite en prose, avec plus de légèreté et de liberté que La Jeune Indienne, la pièce
permet à l’auteur une plus grande audace d’expression et des plaisanteries plus faciles, sur un
rythme rapide et dans un style aphoristique qui rappelle l’art de la formule du moraliste. Il
exerce sa verve satirique non seulement sur la société occidentale qui tolère le commerce des
noirs, mais sur d’autres formes d’esclavage, y compris celui imposé à la condition féminine,
qui faisait déjà l’objet de La Jeune Indienne. Au passage il égratigne, sans grande originalité,
mais avec bonhomie et dans une atmosphère de jubilation légère, les Allemands, les Anglais,
la noblesse, les médecins, les savants ou encore, les juges, dans la plus pure tradition de la
comédie épisodique.
Chamfort lui-même, dans son Dictionnaire dramatique, donne de sa pièce le synopsis
suivant :
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%